Source: The Conversation – France (in French) – By Léo Rosell, Ater, Université Paris Dauphine – PSL
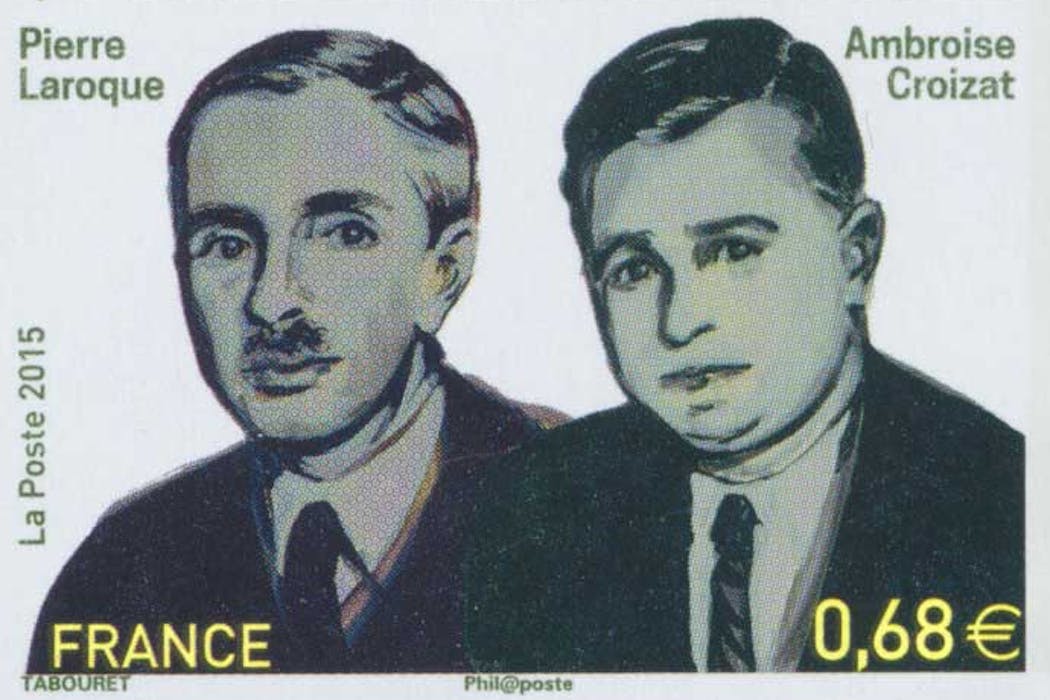
Créée en 1945, la Sécurité sociale répondait à un objectif ambitieux : mettre les Français à l’abri du besoin et instaurer un ordre social nouveau. Fruit d’un compromis entre l’État et le mouvement ouvrier, cette institution a profondément façonné la solidarité sociale en France. Retour sur l’histoire d’un système révolutionnaire, aujourd’hui confronté à des défis de gouvernance et de légitimité.
Cet article est publié en partenariat avec Mermoz, la revue du Cercle des économistes dont le dont le numéro 8 a pour thème « Notre modèle social, un chef-d’œuvre en péril »..
La Sécurité sociale fête ses quatre-vingts ans. Née en 1945, dans un pays où tout est à reconstruire, cette institution sociale affiche alors l’ambition de créer un « ordre social nouveau ». La Sécurité sociale vise à mettre l’ensemble de la population « à l’abri du besoin » et à la libérer de « la peur du lendemain ».
À la Libération, la solidarité en armes exprimée dans la Résistance devait, en quelque sorte, se transcrire dans une solidarité sociale. Cette idée caractérise le compromis institutionnel à l’origine de la Sécurité sociale, entre un État social émancipateur et un mouvement ouvrier puissant et organisé. Dans les décennies suivantes, la démocratie sociale originelle disparaît progressivement, d’abord au profit d’un paritarisme plus favorable au patronat, puis dans le sens d’une gouvernance reprise en main par l’État.
Une longue histoire
Commençons par rappeler que tout ne s’est pas créé en 1945. Le plan français de sécurité sociale est le fruit d’un processus qui s’inscrit dans le temps long, et l’on peut en faire remonter les origines philosophiques à la Révolution française, un moment important de « laïcisation de la charité religieuse » qui avait cours depuis le Moyen Âge et sous l’Ancien Régime. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 pose ainsi pour la première fois le principe selon lequel « les secours publics sont une dette sacrée » de la nation. Après la chute des robespierristes, qui portaient cette aspiration, les expérimentations en matière de secours publics disparaissent.
Commence alors un XIXe siècle marqué par le refus de l’État d’intervenir directement dans les affaires économiques et sociales, mais aussi par le retour de la charité assistancielle. En parallèle, deux traditions se développent en matière de protection sociale : d’une part, une conception républicaine, qui revendique une solidarité nationale, et d’autre part, une tradition ouvrière, qui repose sur l’entraide collective au sein des caisses de secours mutuels et qui est attachée à une gestion par les travailleurs eux-mêmes. La fin du siècle est quant à elle marquée par le développement d’une philosophie, le solidarisme, inspirée de l’œuvre de Léon Bourgeois. Ce courant de pensée postule que la société doit être organisée autour de la solidarité nationale. Il inspire la « nébuleuse réformatrice » à l’origine de l’État social, à travers les premières lois sur les accidents du travail en 1898, sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910 ou encore sur les assurances sociales en 1928-1930.
Mais ces anciennes législations sont imparfaites, car elles ne couvrent que les salariés les plus pauvres, elles dispensent des prestations jugées insuffisantes et on y adhère selon le principe de la « liberté d’affiliation ». Cela signifie que le système compte une multiplicité de caisses, d’origine patronale, mutualiste, confessionnelle, syndicale ou départementale, dont l’efficacité est inégale. Compte tenu de ce bilan critique, le programme du Conseil national de la résistance (CNR), adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944, entend réformer cette ancienne législation, à travers « un plan complet de sécurité sociale ». Le Gouvernement provisoire de la République française va donc s’y atteler, une fois le territoire national libéré.
Une réforme révolutionnaire
Ce contexte a permis la réalisation d’une « réforme révolutionnaire ». La Sécurité sociale repose sur des mesures prises par le pouvoir politique : elle s’est construite à partir d’ordonnances, comme celles du 4 et du 19 octobre 1945 portant création de la Sécurité sociale, sur des lois, comme celle du 22 mai 1946 portant généralisation de la Sécurité sociale, ou encore sur de nombreux décrets. En revanche, elle n’en est pas moins révolutionnaire par sa portée, par son ambition, celle de créer un « ordre social nouveau », pour reprendre une expression du haut fonctionnaire Pierre Laroque, elle-même déjà présente chez Jean Jaurès. Le 23 mars 1945, Laroque proclame :
« C’est une révolution qu’il faut faire et c’est une révolution que nous ferons ! »
À lire aussi :
Mesurer le non-recours pour éviter de dépenser « un pognon de dingue »
Si le rôle de l’institution est incarné par Pierre Laroque, premier directeur de la Sécurité sociale, celui du mouvement ouvrier l’est par Ambroise Croizat. Ancien ouvrier dès l’âge de treize ans, dirigeant de la Fédération des métaux de la Confédération générale du travail (CGT) et député communiste sous le Front populaire, Ambroise Croizat devient président de la commission du travail et des affaires sociales de l’Assemblée consultative provisoire à la Libération, puis ministre du travail et de la sécurité sociale, du 21 novembre 1945 au 4 mai 1947.
Avec Pierre Laroque, ils mettent en œuvre le régime général de la Sécurité sociale, qui repose sur quatre principes fondamentaux. Tout d’abord, il doit s’agir d’un régime universel : l’ensemble de la population, de la naissance à la mort, doit bénéficier de la Sécurité sociale. De plus, le millier de caisses qui existaient du temps des assurances sociales est remplacé par un système obligatoire reposant sur une seule caisse primaire par département, une caisse régionale et une caisse nationale, prenant en charge l’ensemble des risques sociaux.
Le financement par la cotisation sociale constitue le troisième principe. Renvoyant à la formule « de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins », ce mode de financement par répartition permet au budget de la Sécurité sociale d’être autonome et donc de ne pas dépendre des arbitrages budgétaires de l’État. Enfin, le quatrième principe, sans doute le plus original, renvoie à la démocratie sociale : les caisses de la Sécurité sociale sont gérées « par les intéressés eux-mêmes ».
Des oppositions diverses
De nombreuses oppositions vont tenter de retarder, voire d’empêcher, cette réalisation. Dans les milieux patronaux d’abord, hostiles vis-à-vis de la cotisation patronale, de la caisse unique et de la gestion des caisses par les travailleurs. La Mutualité et les assurances privées craignent de perdre le rôle qu’elles avaient dans les anciennes assurances sociales. Les médecins libéraux ont peur d’être « fonctionnarisés » et de perdre leur liberté d’exercice, tandis que les cadres n’ont pas envie d’être associés au même régime que les salariés. Face à ces obstacles, Croizat et Laroque font preuve de pragmatisme, en donnant partiellement satisfaction à la Mutualité, ou encore aux cadres, avec la création d’un régime complémentaire, l’Agirc. Les artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs obtiennent la mise en place de régimes particuliers.
Entre 1945-1967, la gestion des caisses de la Sécurité sociale est donc organisée selon le principe de la démocratie sociale, en reconnaissant un pouvoir syndical fort. En effet, les conseils d’administration des caisses sont composés à 75 % par des représentants des salariés et à 25 % par ceux du patronat. Ces administrateurs sont d’abord désignés selon le principe de la représentativité syndicale. Le syndicat chrétien de la CFTC refuse alors de participer à la mise en œuvre du régime général car il perd la gestion de ses anciennes caisses confessionnelles, mais aussi parce qu’il craint de subir l’hégémonie de la CGT. Les militants cégétistes disposent de fait d’un quasi-monopole dans la mise en œuvre du régime général sur le terrain.
La Sécurité sociale à la française n’est donc pas un système étatique. Sur le plan juridique, les caisses primaires et régionales sont de droit privé, tandis que la caisse nationale est un établissement public à caractère administratif. L’État, à travers le ministère du travail et de la sécurité sociale – et la direction de la Sécurité sociale qui en dépend –, voit son pouvoir limité à certaines prérogatives, qui restent importantes : en plus du pouvoir normatif, qui s’exprime par la fixation du taux de cotisation et du montant des prestations, l’État dispose aussi d’une fonction de contrôle sur l’activité des caisses.
Une gestion ouvrière fragilisée
Au cours de l’année 1947, le changement de contexte politique a des conséquences directes sur la Sécurité sociale. Le 24 avril 1947, des « élections sociales » sont instaurées pour renforcer sa dimension démocratique et donnent lieu à une véritable campagne politique. La CGT obtient environ 60 % des voix, la CFTC 26 % et la Mutualité 10 %. Le 4 mai, les communistes sont exclus du gouvernement. L’entrée dans la logique de la guerre froide fragilise la gestion ouvrière de la Sécurité sociale, en particulier à la suite de la scission syndicale entre la CGT et Force ouvrière.
En 1958, l’instauration de la Ve République permet à l’État d’intervenir plus directement. Les ordonnances Debré instaurent la nomination des directeurs de caisses par l’exécutif, et non plus leur élection par les conseils d’administration. En 1960, les pouvoirs des directeurs augmentent, au détriment de ceux des conseils d’administration. Au cours de la même année, le corps de l’Inspection générale de la Sécurité sociale est créé, de même que le Centre d’études supérieures de la Sécurité sociale – devenue l’EN3S en 2004 –, participant à la professionnalisation du personnel des caisses.
À partir de 1967, la démocratie sociale disparaît, au profit d’un nouveau principe, le paritarisme. Instauré par les ordonnances Jeanneney, le paritarisme repose en théorie sur un partage du pouvoir entre partenaires sociaux, à parts égales entre syndicats de salariés et patrons. Dans les faits, ce nouveau mode de gestion renforce le pouvoir du patronat, qui joue de la division syndicale. De même, les élections sociales sont supprimées, et la caisse unique est divisée en quatre branches autonomes, chacune présidée par un haut fonctionnaire.
Tout se passe comme si le compromis de 1945 entre l’État social et les syndicats ouvriers s’était renversé au profit d’une nouvelle alliance entre la « technocratie » et le patronat. En tout cas, l’ensemble de ces mesures répond aux revendications du Conseil national du patronat français (CNPF).
La crise de l’État-providence
Les années 1980-1990 voient s’imposer un autre discours, celui sur la « crise de l’État-providence ». Un État réformateur, avec à sa tête le socialiste François Mitterrand depuis 1981, réalise certes la promesse d’une retraite à 60 ans et celle de restaurer les élections sociales. Mais l’affaiblissement des syndicats et le « tournant de la rigueur » de 1983 consacrent l’objectif de réduction des dépenses publiques, partagé par tous les gouvernements successifs.
L’instauration de la contribution sociale généralisée (CSG) en 1990-1991 participe quant à elle de la fiscalisation du financement de la Sécurité sociale, au détriment de la cotisation sociale, ce qui justifie politiquement une intervention accrue de l’État.
Une parlementarisation de la gestion de la Sécurité sociale se développe ainsi entre 1996 et 2004. Le rôle du Parlement et l’influence des directives européennes en matière budgétaire et réglementaire se traduisent par plusieurs mesures prises en 1996 : l’instauration par ordonnances d’une loi de financement de la Sécurité sociale votée chaque année, la suppression définitive des élections sociales et la création de deux outils de gouvernance budgétaire, l’objectif national des dépenses de l’Assurance maladie (Ondam) et la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades). En 2000, c’est au tour du Conseil d’orientation des retraites (COR) d’être créé.
Néomanagement et logique comptable
Enfin, depuis 2004, s’est imposée une gouvernance managériale, fortement inspirée du « nouveau management public ». Cette évolution est symbolisée par la réforme de l’assurance-maladie et celle de l’hôpital public, avec l’instauration de la tarification à l’activité (T2A). Les différentes branches sont désormais gérées par des directeurs généraux aux pouvoirs élargis, tandis que des Conventions d’objectifs et de gestion (COG) sont contractées tous les quatre ans entre l’État et les branches, puis déclinées au niveau des caisses.
Une logique comptable de définition d’objectifs et d’évaluation des résultats s’impose donc devant l’exigence de répondre à des besoins et de garantir l’accès aux droits des bénéficiaires. Cette gouvernance managériale parvient parfois à mener des réformes impopulaires, comme la réforme des retraites de 2023 passée via l’usage de l’article 49.3 de la Constitution et le détournement d’un PLFSS rectificatif. Néanmoins, se pose dès lors la question du consentement populaire à ce mode de gestion, qui fragilise une institution centrale du pacte social républicain.
Les commémorations du 80e anniversaire de la Sécurité sociale ont ainsi été propices à la remise en cause d’une gouvernance, dénoncée comme étant antidémocratique, y compris parfois au sein même des élites de l’État social. Certains appellent à renouer avec les ambitions portées, en son temps, par Pierre Laroque, leur illustre prédécesseur, notamment en termes de démocratie sociale.
Cet article est publié en partenariat avec Mermoz, la revue du Cercle des économistes dont le numéro 8 a pour objet « Notre modèle social, un chef-d’œuvre en péril ». Vous pourrez y lire d’autres contributions.
Le titre et les intertitres sont de la rédaction de The Conversation France.
![]()
Léo Rosell ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Sécurité sociale, un compromis institutionnel bien français – https://theconversation.com/securite-sociale-un-compromis-institutionnel-bien-francais-268673
