Source: The Conversation – in French – By Elisa Chelle, Professeure des universités en science politique, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Par ses mesures, par son langage, par sa remise en cause régulière de fondements de la démocratie américaine que l’on croyait intangibles, Donald Trump suscite souvent un rejet si viscéral que toute tentative d’analyse dépassionnée peut susciter le soupçon : en expliquant froidement les ressorts du trumpisme et de ses victoires électorales, ne banalise-t-on pas un phénomène profondément dangereux ? De la même façon, il arrive parfois que la remise en cause de l’idée selon laquelle le populisme trumpien aurait déjà précipité les États-Unis dans un autoritarisme débridé soit assimilée à une volonté de minorer les méfaits de l’actuel locataire de la Maison Blanche. Ce double défi – expliquer le trumpisme et mesurer son impact réel à ce stade – est brillamment relevé par Élisa Chelle, professeure des universités en science politique à l’Université de Nanterre, dans La Démocratie à l’épreuve du populisme. Les leçons du trumpisme, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Extraits de l’introduction.
Tous mes amis américains sont Démocrates. La campagne présidentielle de 2024 ? Ils l’ont traversée avec anxiété. Jusqu’au 5 novembre qui fut, pour eux, un jour de sidération. Comment un homme politique aussi « menteur », « vulgaire », « raciste » et « misogyne » pouvait-il revenir au pouvoir ? Pas de démonstration de force, pas de coup d’État : la démocratie des urnes avait parlé. Immédiatement s’est posée une question : comment réagir ? Fallait-il s’indigner, manifester, quitter le pays ?
Mes amis français sont, eux aussi, tous Démocrates. Quand bien même ils n’ont jamais vécu aux États-Unis ou subi les conséquences d’une présidence Trump, ils s’emportèrent en dénonçant l’« agaçant ploutocrate », l’« ennemi de la science », le « destructeur de l’État de droit »… Lorsque je leur ai confié écrire ce livre, avec une visée plus analytique que militante, voulant dépasser les effets d’annonce, l’un d’entre eux m’a demandé, quelque peu goguenard : « Tu ne serais pas devenue trumpiste ? »
Les résistances institutionnelles révèlent la force de la démocratie à l’épreuve du populisme. Séparer les pouvoirs : pas de credo plus vénéré dans ce régime. Depuis 1787, des attributions substantielles s’attachent à la présidence, au Congrès, à la Cour suprême, aux États fédérés ou à la justice. Certes, la frontière entre chacune de ces institutions reste objet de débats sinon de conflits. Mais aucune d’entre elles n’est au-dessus de la mêlée. En fonction des équilibres en place, des questions traitées ou de circonstances favorables, c’est l’une qui va tenter d’utiliser ou d’instrumentaliser l’autre.
C’est ce qui fait toute la spécificité de la démocratie américaine : elle est traversée par des forces en concurrence. L’État n’est pas neutre. Il est façonné par les intérêts partisans. Cette plasticité des pouvoirs est mise au service d’une société ouverte et égalitaire, mais la liberté qu’elle offre peut être soumise à des logiques de puissance. Les attaques contre les institutions américaines conduites par Donald Trump en témoignent. Peut-on pour autant parler d’une fuite en avant autoritaire ? ou d’une menace planant sur la Constitution ? Le battage médiatique, qui s’en tient aux effets d’annonce, en nourrit l’accusation. En prétendant lutter contre les « deux ennemis intérieurs » (l’immigré clandestin et le militant de gauche), la droite radicale ferait basculer le pays hors du cercle de la démocratie. Un projet qui aurait pour effet d’abîmer les fondements de la République.
Il est urgent d’interroger la réalité d’une telle inquiétude. Si une forme de privatisation du jeu politique est en cours, les contre-pouvoirs restent actifs. On le verra tout au long de ce livre : l’administration déploie sa force d’inertie ; les institutions judiciaires multiplient les suspensions et les interdictions ; les élus se rebellent contre des politiques jugées injustes. Si la démocratie est un régime de conflictualité, les États-Unis restent fidèles à leur histoire. Le pluralisme y demeure vivant. Et les médias échappent à toute unanimité de surface, de celles qui caractérisent les États autoritaires ou dictatoriaux.
La polarisation des opinions s’est accrue et la confrontation prend des traits toujours plus marqués. Mais faut-il en conclure qu’une « guerre civile » déchire le pays ? L’excès des mots nuit ici à l’analyse véritable de la situation. Après tout, le consensus n’est un horizon que pour quelques esprits éclairés. Il n’a jamais constitué un principe de gouvernement.
Depuis l’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump en 2016, puis sa réélection triomphale, l’Europe observe avec inquiétude les soubresauts de la démocratie américaine. Cette attention fiévreuse a des raisons précises. Les États-Unis sont perçus comme un laboratoire grandeur nature des mutations qui affectent l’ensemble des démocraties occidentales. Le trumpisme n’est pas un accident de l’Histoire. Il est la manifestation paroxystique de tendances lourdes qui traversent l’Atlantique : défiance envers les élites, nostalgie d’un âge d’or, instrumentalisation des peurs identitaires, retour du nationalisme, voire du nativisme… en un mot, du populisme.
Le populisme américain défie frontalement les règles du jeu politique établies. Il interroge les fondements mêmes de la représentation politique. Il teste les limites de la démocratie. Son expression se nourrit des paradoxes propres à la délégation électorale. Le peuple, théoriquement souverain, a peu de prise sur les décisions qui l’affectent au quotidien. Donald Trump entend lui donner sa revanche en brisant l’obstacle qui en fait un « spectateur de sa destinée » ou la « proie d’un monde qui change ». Sa recette est de prétendre faire primer la volonté sur les institutions, l’autorité sur le compromis, la politique sur le droit.
Cette mutation profonde dans l’art de gouverner transforme chaque procédure judiciaire en forum médiatique, chaque contrainte juridique en opportunité de victimisation. Donald Trump a démontré qu’il était possible de mobiliser le suffrage universel contre la démocratie. Oubliée l’accusation d’« élection volée », lors de sa défaite face au Démocrate Joe Biden en 2020 : les primaires l’ont propulsé vers la victoire présidentielle la plus nette depuis Barack Obama en 2012, voire depuis 1988 pour un Républicain. Accablé par de multiples affaires judiciaires – allant de la plainte pour viol à la fraude électorale, sans négliger son rôle dans l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021 –, le milliardaire a finalement obtenu l’onction démocratique. Il l’a emporté avec 2,3 millions de voix d’avance et 312 grands électeurs contre 226 à son adversaire démocrate Kamala Harris.
La gauche aurait-elle perdu de vue, dans cette élection, l’« Américain ordinaire » ? Par rapport à 2020, ce sont 6 millions d’électeurs démocrates qui ne se sont pas déplacés. Tandis que le candidat républicain, lui, a renforcé son soutien dans des catégories sociales réputées peu favorables à son camp (Afro-Américains, Hispaniques…). L’inflation et la question de l’immigration ont manifestement été sous-estimées par l’équipe de Kamala Harris. Elles ont largement pesé sur l’orientation des préférences. Les causes démocrates – écologie, défense des minorités, antiracisme – ont d’abord séduit les électeurs urbains les plus éduqués. Mais pour les deux tiers de l’électorat dépourvus de diplôme universitaire, elles furent un repoussoir.
Pour faire leur aggiornamento, les Démocrates devront comprendre ce qui s’est passé, analyser les clés du succès populiste et surtout y apporter une réponse. Trump n’a pas seulement excellé dans un art oratoire accrochant les milieux populaires, avec ses « incohérences » et ses « contradictions » dénoncées par le camp démocrate. Il a su conduire une politique de présence, sinon d’incarnation, qui fait désormais écho aux formes d’adulation propagées via les réseaux sociaux. Face à des adversaires peu offensifs sur l’inflation, le candidat populiste défend un « chauvinisme de la prospérité ». Du mineur de charbon de Virginie-Occidentale à l’étudiant afro-américain de Géorgie, en passant par la famille hispanique du Texas, ses mots d’ordre ont su capter l’attention d’un électorat déçu, déclassé, ou tout simplement exaspéré.
Cette stratégie de conquête des classes populaires a incité les Républicains à défendre un credo protectionniste. Les promesses de taxes douanières et de réindustrialisation résumées dans le slogan « America first » ont redonné espoir à une majorité d’électeurs. Or ces enjeux ont fait oublier les anathèmes lancés par les Démocrates contre l’« extrémiste » Donald Trump. Le « danger » qu’il représenterait pour la démocratie n’a pas été pris au sérieux. Comme si ses propos les plus outranciers n’avaient guère d’effet sur ces segments de l’opinion.
En 2016, le candidat à la Maison Blanche avait déclaré vouloir faire emprisonner son adversaire Hillary Clinton. Il s’était engagé à abroger la grande loi santé d’Obama, à se retirer de l’accord de libre-échange nord-américain, ou à en finir avec le droit du sol. Autant d’annonces tonitruantes qui ont marqué la campagne électorale mais qui n’ont pas été suivies d’effet. Celles lancées en 2024 – terminer la guerre en Ukraine en vingt-quatre heures, baisser les impôts ou encore expulser massivement les migrants en situation irrégulière – ne sont pas moins clivantes. À leur tour, elles seront mises à l’épreuve des faits et de la réalité du pouvoir.
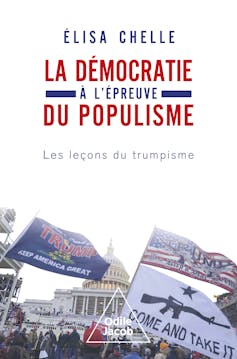
Ce livre veut le montrer : le 47e président n’est pas une anomalie qu’il suffirait d’évacuer pour retrouver le cours « normal » d’une histoire séculaire. Il traduit un changement profond des formes de représentation et de mobilisation électives. C’est pourquoi il faut saisir les conditions structurelles de cette arrivée au pouvoir. En somme, répondre à la question : pourquoi des millions d’Américains ont-ils pu voir en lui un recours légitime ? Non pas pour excuser ou cautionner, mais pour s’essayer à expliquer les raisons d’un succès. Un exercice qui suppose de ne pas s’effrayer devant des nuances ou des faits. À rebours du temps des médias, tentons de démêler ce qui relève de l’écume des jours et ce qui a vocation à rester. Saintes colères et polémiques stériles détournent trop souvent le regard des résistances institutionnelles et des compromis passés sous silence. La politique est faite de mises en scène mais aussi de coulisses. Allons voir ce qui s’y passe.
Avec le retour du tribun populiste à la Maison Blanche, les institutions américaines font face à un test décisif. Vont-elles absorber, affaiblir ou annihiler un programme politique qui se veut en rupture avec deux siècles de tradition démocratique ? Observer le résultat de cette secousse, c’est anticiper l’avenir européen. À l’heure où la France se prépare à l’après-Macron, les forces antisystème n’ont jamais été aussi puissantes. Elles se tiennent aujourd’hui aux portes du pouvoir. Le régime politique français, avec son semi-présidentialisme et son scrutin majoritaire à deux tours, résistera-t-il à la tentation populiste ? L’expérience américaine nous enseigne que cette transformation ne constitue pas seulement un péril. Elle est aussi une opportunité de renouvellement démocratique pour l’Europe tout entière si les partis politiques savent se montrer à la hauteur.
![]()
Elisa Chelle a reçu des financements de l’Institut universitaire de France.
– ref. Comprendre le populisme trumpiste, au-delà des anathèmes et des invectives – https://theconversation.com/comprendre-le-populisme-trumpiste-au-dela-des-anathemes-et-des-invectives-263937
