Source: The Conversation – in French – By Catherine Guaspare, Sociologue, Ingénieure d’études, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Dans un contexte où la production scientifique est soumise à des pressions multiples, où les théories pseudoscientifiques circulent sur les réseaux sociaux, l’intégrité scientifique apparaît plus que jamais comme l’un des piliers de la confiance dans la science. Nous vous proposons de découvrir les conclusions de l’ouvrage L’intégrité scientifique. Sociologie des bonnes pratiques, de Catherine Guaspare et Michel Dubois aux éditions PUF, en 2025.
L’intégrité scientifique est une priorité institutionnelle qui fait consensus. Par-delà la détection et le traitement des méconduites scientifiques, la plupart des organismes d’enseignement supérieur et de recherche partagent aujourd’hui un même objectif de promouvoir une culture des bonnes pratiques de recherche.
Il est tentant d’inscrire cette culture dans une perspective historique : la priorité accordée aujourd’hui à l’intégrité n’étant qu’un moment dans une histoire plus longue, celle des régulations qui s’exercent sur les conduites scientifiques. Montgomery et Oliver ont par exemple proposé de distinguer trois grandes périodes dans l’histoire de ces régulations : la période antérieure aux années 1970 caractérisée par l’autorégulation de la communauté scientifique, la période des années 1970-1990 caractérisée par l’importance accordée à la détection et la prévention des fraudes scientifiques et, depuis les années 1990 et la création de l’Office of Research Integrity, première agence fédérale américaine chargée de l’enquête et de la prévention des manquements à l’intégrité dans la recherche biomédicale financée sur fonds publics, la période de l’intégrité scientifique et de la promotion des bonnes pratiques.
Cette mise en récit historique de l’intégrité peut sans doute avoir une valeur heuristique, mais comme tous les grands récits, celui-ci se heurte aux faits. Elle laisse croire que la communauté scientifique, jusque dans les années 1970, aurait été capable de définir et de faire appliquer par elle-même les normes et les valeurs de la recherche. Pourtant, la régulation qui s’exerce par exemple sur la recherche biomédicale est très largement antérieure aux années 1970, puisqu’elle prend forme dès l’après-Seconde Guerre mondiale avec le Code de Nuremberg (1947), se renforce avec la Déclaration d’Helsinki (1964) et s’institutionnalise progressivement à travers les comités d’éthique et les dispositifs juridiques de protection des personnes.
Elle laisse ensuite penser que la détection des fraudes scientifiques comme la promotion des bonnes pratiques seraient autant de reculs pour l’autonomie de la communauté scientifique. Mais, à y regarder de plus près, les transformations institutionnelles – l’adoption de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche en 2015, la création de l’Office français de l’intégrité scientifique en 2017, l’entrée de l’intégrité dans la loi en 2020 –, sont le plus souvent portées par des représentants de la communauté scientifique. Et ce qui peut paraître, de loin, une injonction du politique faite au scientifique relève fréquemment de l’auto-saisine, directe ou indirecte, de la communauté scientifique. L’entrée en politique de l’intégrité scientifique démontre la capacité d’une partie limitée de la communauté scientifique à saisir des fenêtres d’opportunité politique. À l’évidence, pour la France, la période 2015-2017 a été l’une de ces fenêtres, où, à la faveur d’une affaire retentissante de méconduite scientifique au CNRS en 2015, du rapport porté par Pierre Corvol en 2016, de la lettre circulaire de Thierry Mandon en 2017, ces questions passent d’un débat professionnel à un objet de politique publique structuré.
Enfin, ce récit historique de l’intégrité semble suggérer qu’à la culture institutionnelle de détection des fraudes scientifiques, caractéristique des années 1970-1990, viendrait désormais se substituer une culture, plus positive, des bonnes pratiques et de la recherche responsable. Certes, l’innovation et la recherche responsables sont autant de mots-clés désormais incontournables pour les grandes institutions scientifiques, mais la question de la détection des méconduites demeure plus que jamais d’actualité, et ce d’autant qu’il s’est opéré ces dernières années un déplacement de la détection des fraudes scientifiques vers celle des pratiques discutables. La question de la qualification des méconduites scientifiques comme celle de leur mesure n’ont jamais été autant d’actualité.
Si le sociologue ne peut que gagner à ne pas s’improviser historien des sciences, il ne peut toutefois rester aveugle face aux grandes transformations des sciences et des techniques. En particulier, la communauté scientifique du XXIᵉ siècle est clairement différente de celle du siècle dernier. Dans son rapport 2021, l’Unesco rappelait qu’entre 2014 et 2018 le nombre de chercheurs a augmenté trois fois plus vite que la population mondiale, avec un total de plus de huit millions de chercheurs en équivalent temps plein à travers le monde.
Cette densification de la communauté scientifique n’est pas sans enjeu pour l’intégrité scientifique. Avec une communauté de plus en plus vaste, il faut non seulement être en mesure de parler d’une même voix, normaliser les guides et les chartes, mais s’assurer que cette voix soit entendue par tous. Même si l’institutionnalisation de l’intégrité est allée de pair avec une forme d’internationalisation, tous les pays ne sont pas en mesure de créer les structures et les rôles que nous avons eu l’occasion de décrire.
Par ailleurs, la croissance de la communauté scientifique s’accompagne mécaniquement d’une augmentation du volume des publications scientifiques qui met à mal les mécanismes traditionnels de contrôle. D’où d’ailleurs le développement d’alternatives au mécanisme de contrôle par les pairs. On a beaucoup parlé de la vague de publications liées à la crise de la Covid-19, mais la vague souterraine, peut-être moins perceptible pour le grand public, est plus structurelle : toujours selon les données de l’Unesco, entre 2015 et 2019, la production mondiale de publications scientifiques a augmenté de 21 %. Qui aujourd’hui est capable de garantir la fiabilité d’un tel volume de publications ?
Qui dit enfin accroissement du volume de la communauté scientifique, dit potentiellement densification des réseaux de collaborations internationales, à l’intérieur desquels les chercheurs comme les équipes de recherche sont autant d’associés rivaux. La multiplication des collaborations internationales suppose de pouvoir mutualiser les efforts et de s’assurer de la qualité de la contribution de chacun comme de sa reconnaissance. Nous avons eu l’occasion de souligner l’importance de considérer les sentiments de justice et d’injustice éprouvés par les scientifiques dans la survenue des méconduites scientifiques : une contribution ignorée, un compétiteur qui se voit récompensé tout en s’écartant des bonnes pratiques, des institutions scientifiques qui interdisent d’un côté ce qu’elles récompensent de l’autre, etc., autant de situations qui nourrissent ces sentiments.
Par ailleurs, la multiplication des collaborations, dans un contexte où les ressources (financements, postes, distinctions, etc.) sont par principe contraintes, implique également des logiques de mise en concurrence qui peuvent être vécues comme autant d’incitations à prendre des raccourcis.
Outre la transformation démographique de la communauté scientifique, le sociologue des sciences ne peut ignorer l’évolution des modalités d’exercice du travail scientifique à l’ère numérique. La « datafication » de la science, à l’œuvre depuis la fin du XXᵉ siècle, correspond tout autant à l’augmentation du volume des données numériques de la recherche qu’à l’importance prise par les infrastructures technologiques indispensables pour leur traitement, leur stockage et leur diffusion. L’accessibilité et la diffusion rapide des données de la recherche, au nom de la science ouverte, ouvrent des perspectives inédites pour les collaborations scientifiques. Elles créent une redistribution des rôles et des expertises dans ces collaborations, avec un poids croissant accordé à l’ingénierie des données.
Mais, là encore, cette évolution technologique engendre des défis majeurs en termes d’intégrité scientifique. L’édition scientifique en ligne a vu naître un marché en ligne des revues prédatrices qui acceptent, moyennant paiement, des articles sans les évaluer réellement. Si les outils de l’intelligence artificielle s’ajoutent aux instruments traditionnels des équipes de recherche, des structures commerciales clandestines, les « paper mill » ou usines à papier, détournent ces outils numériques pour fabriquer et vendre des articles scientifiques frauduleux à des auteurs en quête de publications. Si l’immatérialité des données numériques permet une circulation accélérée des résultats de recherche, comme on a pu le voir durant la crise de la Covid-19, elle rend également possibles des manipulations de plus en plus sophistiquées. Ces transformations structurelles créent une demande inédite de vigilance à laquelle viennent répondre, chacun à leur manière, l’évaluation postpublication comme ceux que l’on appelle parfois les nouveaux détectives de la science et qui traquent en ligne les anomalies dans les articles publiés (images dupliquées, données incohérentes, plagiat) et ce faisant contribuent à la mise en lumière de fraudes ou de pratiques douteuses.
À lire aussi :
Ces détectives qui traquent les fraudes scientifiques : conversation avec Guillaume Cabanac
Plus fondamentalement, cette montée en puissance des données numériques de la recherche engendre des tensions inédites entre l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche. À l’occasion d’un entretien, un physicien, travaillant quotidiennement à partir des téraoctets de données générés par un accélérateur de particules, nous faisait remarquer, avec une pointe d’ironie, qu’il comprenait sans difficulté l’impératif institutionnel d’archiver, au nom de l’intégrité scientifique, l’intégralité de ses données sur des serveurs, mais que ce stockage systématique d’un volume toujours croissant de données entrait directement en contradiction avec l’éthique environnementale de la recherche prônée par ailleurs par son établissement. Intégrité scientifique ou éthique de la recherche ? Faut-il choisir ?
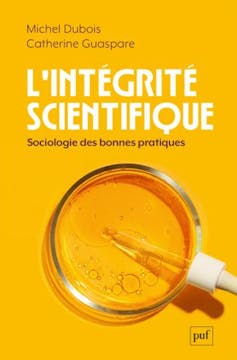
On touche du doigt ici la diversité des dilemmes auxquels sont quotidiennement confrontés les scientifiques dans l’exercice de leurs activités. La science à l’ère numérique évolue dans un équilibre délicat entre l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche. Et l’un des enjeux actuels est sans doute de parvenir à maximiser les bénéfices des technologies numériques tout en minimisant leurs impacts négatifs. D’où la nécessité pour les institutions de recherche de promouvoir une culture de l’intégrité qui puisse dépasser la simple exigence de conformité aux bonnes pratiques, en intégrant les valeurs de responsabilité sociale auxquelles aspire, comme le montrent nos enquêtes, une part croissante de la communauté scientifique.
Le texte a été très légèrement remanié pour pouvoir être lu indépendamment du reste de l’ouvrage en accord avec les auteurs.
![]()
Catherine Guaspare et Michel Dubois sont les auteurs du livre L’intégrité scientifique dont cet article est tiré.
Michel Dubois a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche (ANR). Il est directeur de l’Office français de l’intégrité scientifique depuis septembre 2025.
– ref. Qu’est-ce que l’intégrité scientifique aujourd’hui ? – https://theconversation.com/quest-ce-que-lintegrite-scientifique-aujourdhui-273594
