Source: The Conversation – in French – By Marguerite Xenopoulos, Professor and Canada Research Chair in Global Change of Freshwater Ecosystems, Trent University
Il y a cinquante ans, l’hiver ne se contentait pas de visiter les Grands Lacs, il s’y installait. Si l’on clignait des yeux trop lentement, nos cils gelaient. Après une tempête de neige de janvier, au bord du lac Supérieur, tout était blanc et immobile, sauf le lac. Le vent l’avait balayé, révélant des fissures dans la glace qui craquaient.
À Noël, la baie de Saginaw, sur le lac Huron, est habituellement gelée et la glace est suffisamment épaisse pour permettre aux camions de circuler. Des cabanes de pêcheurs ponctuent l’horizon comme de petites villes en bois. Les gens sortent leurs tarières et leurs appâts avant l’aube, et leurs thermos de café noir fument dans le froid.
À l’hiver 2019-2020, la glace ne s’est jamais formée.
L’air humide et gris était légèrement au-dessus de zéro. Le sol était boueux. Les enfants tentaient de faire de la luge sur l’herbe sèche. Les entreprises de location de cabanes sont restées fermées, et les habitants se demandaient si c’était le nouveau visage de l’hiver.
Les conséquences environnementales et sociales du réchauffement hivernal ont un impact sur les lacs du monde entier. Malgré ces signes évidents, la plupart des activités d’observation des Grands Lacs ont lieu pendant les périodes chaudes et calmes.
En tant que professeurs spécialisés dans la recherche sur l’hiver et de membres du Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs de la Commission mixte internationale, nous avons élaboré des recommandations fondées sur des données probantes à l’intention des décideurs politiques du Canada et des États-Unis concernant les priorités et la coordination en matière de qualité de l’eau. Pour renforcer la coopération internationale, nous recommandons de mettre en place une surveillance hivernale afin de mieux comprendre les facteurs affectant les lacs.
À lire aussi :
Le rôle invisible des eaux souterraines dans le soutien des lacs
Syndrome du réchauffement hivernal
La région des Grands Lacs est touchée par le « syndrome du réchauffement hivernal », caractérisé par une hausse de la température de l’eau de surface, plus particulièrement pendant la saison froide.
Les hivers y sont de plus en plus chauds et humides, et la couverture glacielle maximale annuelle diminue considérablement. Les conditions hivernales sont également de plus en plus courtes, avec une réduction d’environ deux semaines par décennie depuis 1995.
Dans la région des Grands Lacs, les entreprises, les touristes et les quelque 35 millions d’habitants subissent les effets du réchauffement hivernal tout au long de l’année. Les changements saisonniers entraînent une augmentation du ruissellement des nutriments, favorisant la prolifération d’algues qui gâchent les journées d’été à la plage.
La modification des réseaux alimentaires affecte des espèces importantes sur les plans commercial et culturel, comme le grand corégone. La diminution de la couverture glacielle rend les loisirs et les transports moins sûrs, transformant ainsi l’identité et la culture de la région.
L’hiver, la saison la moins étudiée
Nous risquons de perdre l’hiver dans la région des Grands Lacs avant d’avoir pleinement compris son influence sur l’écosystème et les communautés. Notre analyse des publications récentes montre que l’hiver est peu étudié.
Les chercheurs ont une connaissance limitée des processus physiques, biologiques et biogéochimiques en jeu. Toute modification de ces processus peut avoir des répercussions sur la qualité de l’eau, l’écosystème, la santé humaine, ainsi que sur le bien-être social, culturel et économique de la région. Toutefois, il est difficile de comprendre ces phénomènes sans disposer des données nécessaires.
En vertu de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, les agences canadiennes et américaines surveillent les indicateurs de santé et la qualité de l’eau. L’accord fixe des objectifs pour la qualité de l’eau des Grands Lacs, notamment en ce qui concerne la potabilité, ainsi que la sécurité pour les loisirs et la consommation de poissons et d’espèces sauvages. Cependant, les efforts actuels se concentrent sur les mois chauds.
À lire aussi :
Les lacs ne dorment pas en hiver ! Au contraire, il y a un monde qui vit sous la glace
Étendre la recherche à l’hiver permettrait de combler d’importantes lacunes dans les données. Des études ponctuelles ont déjà montré que l’hiver requiert un suivi systématique. En 2022, une douzaine d’universités et d’agences canadiennes et américaines ont prélevé des échantillons sous la glace dans tout le bassin, dans le cadre du projet Great Lakes Winter Grab.
Les équipes se sont déplacées à pied ou en motoneige et ont percé la glace afin de recueillir des informations sur la vie lacustre et la qualité de l’eau dans les cinq Grands Lacs.
Il en a résulté la création d’un réseau hivernal des Grands Lacs composé d’universitaires et de chercheurs gouvernementaux, afin de mieux comprendre la rapidité avec laquelle les conditions hivernales changent et d’améliorer le partage des données, la coordination des ressources et l’échange de connaissances.
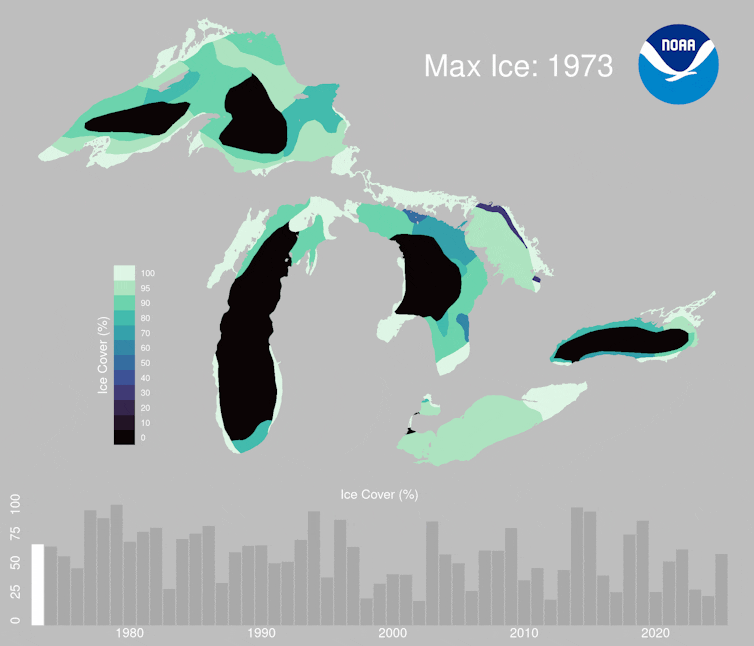
(NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory)
Impacts sur les communautés
Les hivers plus chauds entraînent une hausse des noyades en raison de l’instabilité de la glace. Le ruissellement accru des nutriments favorise la prolifération d’algues nocives et complique le traitement de l’eau potable.
La réduction de la couverture de glace peut prolonger la saison de navigation, mais elle nuit au secteur de la pêche, qui représente 5,1 milliards de dollars américains, par la modification des habitats, l’augmentation des espèces envahissantes et la dégradation de la qualité de l’eau.
À lire aussi :
Les microplastiques contaminent les Grands Lacs. Il faut diminuer la production et la consommation de plastique
L’hiver façonne également l’identité culturelle et les loisirs. Qu’il s’agisse de sorties en raquette ou de patinage sur les lacs gelés, les sports hivernaux laissent de beaux souvenirs aux habitants et aux touristes de la région. La disparition de ces activités pourrait éroder les liens communautaires, les traditions et les moyens de subsistance.
Les changements des conditions hivernales menacent également les traditions et les pratiques culturelles des peuples autochtones. Pour beaucoup d’entre eux, le lien avec leurs terres ancestrales s’exprime à travers la chasse, la pêche, la cueillette et l’agriculture.
La diminution de la quantité totale de neige et l’augmentation de la fréquence des cycles de gel et de dégel entraînent notamment une perte de nutriments dans le sol et peuvent modifier le calendrier saisonnier ainsi que la disponibilité d’espèces végétales importantes sur le plan culturel. L’instabilité de la glace restreint les possibilités de pêche et de transmission des compétences, de la langue et des pratiques culturelles aux générations futures.

(Paul Glyshaw/NOAA)
Recherche scientifique hivernale dans la région des Grands Lacs
La collecte de données par temps froids pose des défis logistiques. Les scientifiques ont besoin d’équipements spécialisés, de personnel qualifié et d’approches coordonnées pour réaliser des observations sûres et efficaces. Le développement de la recherche hivernale dans les Grands Lacs requiert davantage de ressources.
Notre récent rapport met en lumière les lacunes dans les connaissances relatives aux processus hivernaux, aux impacts socio-économiques et culturels des conditions changeantes, ainsi qu’aux moyens de renforcer la science hivernale dans cette région.
Le rapport souligne également les limites infrastructurelles et recommande davantage de formations pour permettre aux scientifiques de travailler en toute sécurité dans des conditions climatiques rigoureuses, à l’image de l’atelier de formation du Réseau de limnologie hivernale de 2024. Une gestion améliorée et un meilleur partage des données sont nécessaires pour maximiser la valeur des informations recueillies.
La science hivernale des Grands Lacs est en plein essor, mais il est essentiel d’accroître les capacités et la coordination pour suivre le rythme des changements qui affectent non seulement les écosystèmes, mais aussi les communautés. Le développement de la science hivernale permettra de préserver la santé et le bien-être des personnes qui vivent, travaillent et se divertissent dans le bassin des Grands Lacs.
![]()
Marguerite Xenopoulos reçoit un financement des Chaires de recherche du Canada et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.
Michael R. Twiss est affilié à l’Association internationale pour la recherche sur les Grands Lacs.
– ref. Les hivers pourraient disparaître de la région des Grands Lacs – https://theconversation.com/les-hivers-pourraient-disparaitre-de-la-region-des-grands-lacs-267790
