Source: The Conversation – in French – By Vivien Barrière, Maître de conférences en histoire ancienne et archéologie, CY Cergy Paris Université

Musée National du Danemark, Copenhague, CC BY-SA
Alors que l’Europe s’est longtemps pensée depuis la lumière méditerranéenne, foyer auto-proclamé de la démocratie et de la civilisation, le Nord est resté dans l’ombre, relégué aux marges du récit historique. Dans leur imposante somme Les Mondes du Nord : De la Préhistoire à l’âge viking, qui vient de paraître aux éditions Tallandier, les historiens Vivien Barrière, Stéphane Coviaux, Alban Gautier et Anne Lehoërff prennent cette vision à contre-pied et nous proposent une enquête sans précédent au-delà du 50e parallèle. En plaçant les peuples et les terres nordiques au centre de leur analyse, ils braquent toute la lumière sur la riche histoire du Nord jusqu’à la fin du premier millénaire.
Aux environs de l’an mille, l’abbé anglo-saxon Ælfric d’Eynsham écrit ces mots à propos de son pays, l’île de Grande-Bretagne :
« Cette terre n’est pas aussi forte en vigueur ici, sur le bord extérieur de l’étendue de la terre, qu’elle ne l’est au milieu, dans des terres fortes en vigueur. »
La formule, frappante, interroge. Pourquoi donc un Anglais du début du XIe siècle aurait-il l’impression de vivre « au bord du monde » ? Pourquoi regarde-t-il son île comme reléguée à l’extrémité d’un univers habité dont le centre est bien plus au sud, sur les rives de la Méditerranée ? Et pourquoi le fait d’habiter une terre aussi excentrée et septentrionale serait-il un signe de faiblesse, voire d’infériorité ? Serait-ce l’expression d’une vision du monde propre à Ælfric ?
Assurément non.
Un siècle et demi plus tard, l’auteur de la Passion de saint Olaf, sans doute l’archevêque de Nidaros, Eystein Erlendsson, évoque, en un prélude inspiré, l’histoire de la Norvège, « cette très vaste contrée située au nord, bordée au sud par la Dacie », dont les habitants, longtemps asservis par l’aquilon – autrement dit le paganisme –, venaient d’en être libérés par « le doux vent du sud » que Dieu avait fait souffler en ces contrées lointaines.
Cette façon de se représenter le monde a en réalité une longue histoire. Portée par des géographes grecs, romains, arabes ou européens, reprise avec le développement des études historiques au XIXe siècle, elle fait de la Méditerranée la matrice de toute civilisation, le cœur, l’omphalos, une sorte de repère à partir duquel s’est construit un récit reléguant toutes les régions avoisinantes au rang de marges. À regarder l’Europe à travers une carte où le Nord magnétique est conventionnellement en haut et la Méditerranée « au milieu », l’esprit finit par intégrer que c’est sous cet angle que l’histoire doit être pensée.
Les Nords aux marges d’une histoire européenne centrée sur la Méditerranée
Dès lors, les Nords européens, plus pauvres et moins peuplés, apparaissent seconds, voire arriérés face au cœur méditerranéen des civilisations. La puissance de cette représentation est telle qu’un Anglais comme Ælfric ou qu’un Norvégien comme Eystein l’ont intériorisée ; et ce n’est que tardivement, avec la Réforme, la révolution industrielle et surtout l’éclatante prospérité des pays nordiques contemporains, que cette relégation s’est peu à peu renversée, faisant du Nord une direction dotée de connotations positives et des terres septentrionales des régions porteuses de progrès, motrices dans l’histoire humaine.
Par conséquent, écrire l’histoire de l’Europe, singulièrement dans ses périodes anciennes, a très souvent consisté à reproduire la marginalisation du Nord en mettant les sociétés méridionales au cœur du récit et des analyses. Tout au plus faisait-il irruption, de temps en temps, sous forme de bandes de pillards et de barbares dont on cherchait au mieux à élucider l’origine : des Cimbres et Teutons aux vikings en passant par les « grandes invasions », tout se passe comme si les peuples du Nord n’avaient accès à la « grande histoire » que lorsque certains de leurs représentants franchissaient le 50e parallèle de latitude nord. Les Européens du Nord ont pourtant une histoire qui ne se résume pas à cette vision réductrice. Retournons donc la carte.
En déplaçant le regard et en choisissant sciemment une géographie qui place les mers septentrionales au centre, quelle histoire écrit-on ?
Déplacer le regard
Tel est le point de départ de cet ouvrage rédigé par quatre auteurs : relever le défi d’une approche différente, qui se concentre sur des sociétés qui ont, elles aussi, une histoire pleine, riche, entière et non de « seconde zone ». Cette position, autant au sens géographique qu’intellectuel du terme, pourrait sembler artificielle. Elle ne l’est pas plus que celle qui consiste à reléguer les Nords au point de les exclure, sciemment ou non.
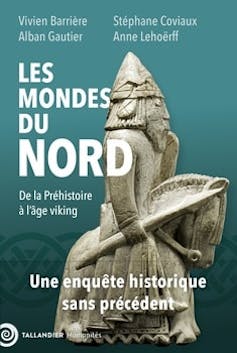
CC BY
Centrer l’attention sur « les Nords européens », c’est donc repousser la Méditerranée au bord de la carte, faire apparaître le Sud uniquement lorsque c’est nécessaire, comme une périphérie. Ainsi, au long des pages qui suivent, l’ombre de Rome – la Rome impériale des Césars puis celle, chrétienne, des papes – planera à plusieurs reprises sur « nos » Nords, mais elle restera le plus souvent en marge : Rome sera le nom d’un acteur certes influent, mais lointain, intervenant activement ou plus discrètement, sans que ces interventions soient vues comme les seules et uniques causes de développements dont les dynamiques sont d’abord à chercher dans les Nords eux-mêmes.
Où commencent, où s’arrêtent les Nords ? Imposer à l’étude un cadre géographique rigide et immuable sans aucune fluctuation sur plus de dix mille siècles n’aurait guère de sens. Si leur limite méridionale s’établit autour du 50e parallèle, traversant de part en part la grande plaine nord-européenne qui va des confins de l’Ukraine et de la Biélorussie jusqu’à la Picardie et, plus à l’ouest, à la Grande-Bretagne, il importe toutefois, selon les moments de l’histoire, d’élargir la focale.
En dépit de ces nécessaires fluctuations, le cœur du propos reste centré sur les régions qui bordent deux grandes mers, deux autres Méditerranées autour desquelles les échanges et les circulations n’ont cessé de façonner l’histoire depuis la formation de cet ensemble maritime au VIIe millénaire avant notre ère : la mer du Nord (avec la Manche) et la Baltique.
La mer du Nord et la mer Baltique
La première est une aire ouverte, propice au commerce, aux communications et à toutes les circulations, et ce, jusqu’à aujourd’hui. Rotterdam, qui n’est plus que le huitième port du monde en tonnage, reste le premier port européen : avec les trois suivants que sont Anvers, Hambourg et Amsterdam, il ouvre sur la mer du Nord. Celle-ci communique en effet avec l’Atlantique Nord par trois voies et passages larges et aisément praticables. On trouve d’abord la mer de Norvège : ouvrant sur un Nord plus extrême, elle donne accès aux régions polaires. Puis, le couloir formé par un chapelet d’archipels – Orcades, Shetland, Féroé – mène vers l’Islande et, au-delà, vers le Groenland et l’Amérique : on dira comment les vikings, à partir du IXe siècle, ont été les premiers à l’emprunter régulièrement. Enfin, au sud-ouest, le pas de Calais est un détroit relativement large (33 km au plus étroit). Cela explique sans doute pourquoi, à l’exception de Rome, nulle puissance n’a jamais contrôlé durablement ses deux rives ni été en mesure de limiter les circulations : la Manche, par conséquent, est à maints égards un prolongement de la mer du Nord, et leurs histoires sont étroitement liées.
La Baltique est au contraire une mer fermée. De nos jours, alors même que les classements incluent plusieurs ports de mers fermées comme la Méditerranée et la mer Noire, aucun des cinquante premiers ports mondiaux n’est situé sur ses rives. Des seuils de hauts-fonds divisent cette mer peu profonde en bassins, comme la baie de Lübeck, le golfe de Riga, le golfe de Finlande ou le golfe de Botnie. Sa seule ouverture est à l’ouest, où elle communique avec l’ensemble Kattegat/Skagerrak et avec la mer du Nord. À cette charnière entre deux mers, plus de 400 îles danoises dessinent un labyrinthe de passages maritimes – les principaux étant le Sund (ou Øresund), le Grand Belt et le Petit Belt –, tous assez étroits pour qu’on ait pu récemment y construire des ponts. L’accès est donc bien plus facile à contrôler qu’aux autres extrémités de la mer du Nord. Même si la Suède a pris possession au XVIIe siècle de la rive orientale du Sund, on est ici au cœur de ce qui a constitué, dès l’âge viking, la puissance des rois de Danemark.
Une cartographie de plus de dix mille siècles d’histoire
Quitte à faire le choix de l’immensité, autant relever également le défi de la très longue durée.
Les dernières recherches le permettent, en dessinant la possibilité d’une cartographie des temps les plus anciens, dans ces Nords dont l’histoire s’ouvre, comme celle de toute l’humanité, en Afrique. Les lignées humaines fossiles atteignent ces régions au climat hostile il y a 800 000 ans, et Homo sapiens ne s’y installe définitivement qu’au gré de la fonte progressive des glaciers, à partir de – 21 000/– 20 000.
Son histoire s’inscrit alors dans un paysage très différent de celui d’aujourd’hui.
Les mers que l’on connaît n’existent qu’en partie, tandis que d’immenses terres, depuis englouties, sont habitées : le « Doggerland ». À partir de 6500 avant notre ère environ, les Nords sont, globalement, ceux du monde contemporain. La naissance du monde agricole (le Néolithique) y est plurielle. Au cours des périodes suivantes (Âge du bronze, Âge du fer), les hommes y sont très mobiles.
C’est à partir de la fin de l’Âge du fer que l’on commence à identifier de manière plus précise les langues et les cultures des populations, qu’elles soient celtiques, germaniques, baltes, slaves ou finno-ougriennes. Ces groupes humains circulent, s’établissent, se rencontrent, échangent, sans que jamais les frontières entre eux soient durablement fixées. Viennent ensuite les Romains puis, dès le début du Moyen Âge, les Francs, qui se veulent leurs successeurs : les uns et les autres se font notamment les propagateurs du christianisme, dont l’empreinte marque durablement les mondes du Nord.
Dès lors, ceux-ci en viennent, surtout à partir du XIIe siècle, à ressembler à maints égards aux autres régions d’Europe : mêmes systèmes de gouvernement, même paysage religieux, même culture latine, mêmes façons d’écrire l’histoire des peuples et de leurs dirigeants. C’est là que se terminera notre histoire, car nous regardons d’abord les premiers temps qui ont fait l’originalité de ces espaces.
C’est donc l’histoire de Nords préhistoriques, anciens et médiévaux, toujours profondément singuliers bien que jamais séparés du reste du continent, que nous retraçons dans ce livre.
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Les Mondes du Nord, au cœur de l’histoire européenne – https://theconversation.com/les-mondes-du-nord-au-coeur-de-lhistoire-europeenne-268725
