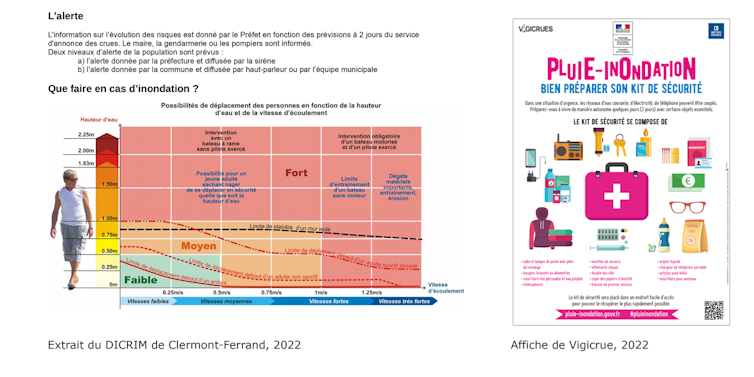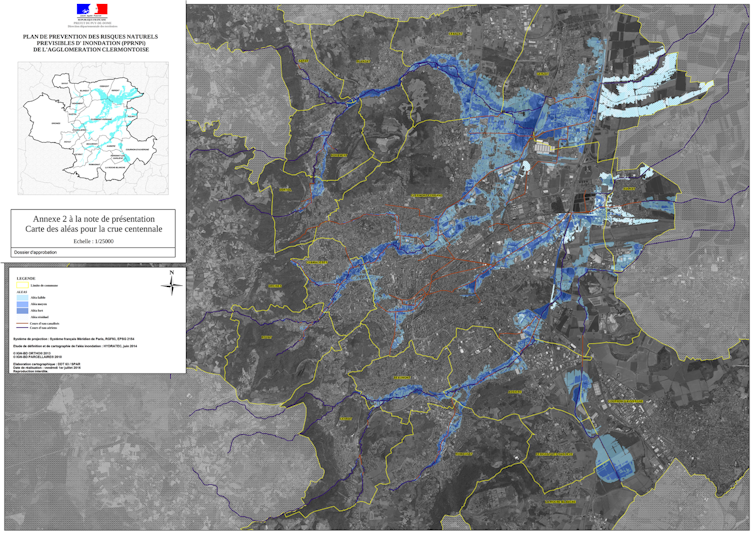Source: The Conversation – in French – By Philippes Mbevo Fendoung, Postdoctoral Research Fellow, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Yaoundé, la capitale camerounaise, est une ville cosmopolite et dynamique où les collines verdoyantes côtoient l’architecture moderne, créant un mélange harmonieux de culture, d’histoire et de dynamisme urbain. La ville s’est considérablement développée au fil des ans en raison de l’urbanisation : sa population est passée de 59 000 habitants en 1957 à près de 4,1 millions en 2020. Cependant, son expansion a entraîné un déclin rapide de la végétation, transformant la ville en un ensemble d’îlots de chaleur urbains.
Une étude récente indique que Yaoundé va se réchauffer au cours des cinq prochaines années. Le phénomène d’îlot de chaleur urbain à Yaoundé est amplifié par le fait que la pauvreté dans la ville est élevée, laissant de nombreux habitants sans les moyens de rafraîchir leurs maisons. Cela entraîne des problèmes de santé, allant des maux de tête et de la fatigue aux difficultés respiratoires. Le géographe Philippes Mbevo Fendoung expose ce qui est nécessaire pour rafraîchir Yaoundé : plus d’espaces verts, moins de surfaces dures, de nouveaux bâtiments réfléchissants, des étangs et des fontaines publics, des ventilateurs pour les habitants, de nouvelles zones ombragées et des systèmes de climatisation abordables.
Qu’est-ce qu’un îlot de chaleur urbain ?
Les îlots de chaleur urbains sont des zones dans les villes où la température est plus élevée que dans les zones rurales environnantes. Cela est principalement dû à la réduction des espaces verts. Les surfaces telles que le béton et l’asphalte absorbent et retiennent la chaleur au lieu de la renvoyer vers l’atmosphère.
Les îlots de chaleur urbains constituent un problème de santé publique. Les personnes qui y vivent souffrent davantage de maladies liées à la chaleur. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires voient leur état s’aggraver, et la chaleur a des effets négatifs sur la santé mentale. Tout cela s’aggrave pendant les vagues de chaleur et l’environnement devient généralement inconfortable.
À Yaoundé, au cours des dix dernières années, la superficie forestière autour de la ville a diminué de moitié, rendant la ville encore plus chaude.
Quels sont les problèmes liés à la chaleur auxquels Yaoundé est confrontée ?
La température dans la ville augmente rapidement, et les zones les plus denses sont devenues des îlots de chaleur qui s’étendent à mesure que de plus en plus de personnes quittent les zones rurales pour s’installer à Yaoundé.
Nous avons calculé cela à l’aide d’images satellites, agrandies à 10 mètres, que nous avons traitées dans un logiciel géographique open source afin de cartographier la ville et les espaces verts. Cela nous a permis de voir les différences de température au fil du temps et de repérer les parties de la ville les plus touchées par les îlots de chaleur urbains. Nous avons remarqué que les surfaces dures à Yaoundé (telles que les trottoirs et les parkings) ont été multipliées par six depuis 2015.
Nous avons ensuite utilisé une formule pour prévoir les températures de surface futures à Yaoundé. Nous avons appliqué le taux moyen d’augmentation des températures à la température actuelle, avec une petite marge d’erreur pour tenir compte des changements naturels ou des incertitudes dans les données. De cette manière, nous avons constaté que les températures de 24 à 31 °C en 2015 devraient atteindre 38 °C d’ici 2030.
Il y a plusieurs raisons à cela :
Les bâtiments réchauffent la ville : les bâtiments en béton et les routes en asphalte absorbent et retiennent la chaleur du soleil, la libérant la nuit, ce qui empêche la ville de se refroidir.
L’environnement est une jungle de béton : les arbres et les plantes jouent un rôle essentiel dans la régulation de la température locale grâce à l’évapotranspiration. Leur absence rend l’îlot de chaleur encore plus chaud et moins agréable.
Pollution atmosphérique : avec l’augmentation du nombre de véhicules sur les routes de Yaoundé, les émissions de gaz d’échappement augmentent. Les particules fines et les gaz d’échappement augmentent les températures locales et provoquent des maladies respiratoires et cardiovasculaires, notamment en période de forte chaleur.
Le changement climatique est arrivé à Yaoundé : la hausse des températures et la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes (tels que les sécheresses et les fortes pluies) rendent Yaoundé encore plus chaude.
Des bâtiments mal conçus qui ne peuvent pas se rafraîchir : de nombreux bâtiments à Yaoundé, en particulier dans les quartiers populaires, sont mal conçus. Sans climatisation ni ventilation adéquate, les températures intérieures peuvent devenir insupportables.
La ville a besoin d’eau, mais elle en manque : plus Yaoundé se réchauffe, plus la demande en eau augmente. Mais la ville subit de fréquentes coupures d’eau et l’eau est parfois impropre à la consommation. Le manque d’eau potable et d’eau pour irriguer les cultures aggrave l’impact de la chaleur et met en péril l’approvisionnement alimentaire.
Yaoundé ne parvient pas à suivre le rythme de sa croissance démographique : l’urbanisation rapide s’est traduite par une croissance non régulée, des services insuffisants pour tous, une mauvaise gestion des déchets et une dégradation de l’environnement. La croissance de la ville n’étant pas planifiée, il est difficile d’y aménager des espaces verts.
Comment les habitants de Yaoundé vivent-ils la hausse des températures ?
Nous avons interrogé 300 ménages à Yaoundé et avons constaté que seuls 2,9 % d’entre eux disposaient de la climatisation. Tous les ménages ne disposaient pas de ventilateurs. Environ 45,5 % des familles de Yaoundé ont des revenus très faibles, compris entre 89 et 177 dollars américains par mois. Même si ce montant est légèrement supérieur au salaire minimum mensuel national de 70 dollars américains, il est bien trop faible pour permettre l’achat d’un climatiseur, qui coûte environ 339 dollars américains.
La plupart (91 %) des ménages que nous avons interrogés nous ont dit que la chaleur provoquait davantage de bouffées de chaleur et de problèmes respiratoires tels que l’asthme. Les enfants et les personnes âgées étaient les plus touchés. Ils ressentaient tous du stress et de l’anxiété.
Nous avons également interrogé des agriculteurs. Ils disent que la chaleur empêche les cultures de bien pousser. Ces agriculteurs étaient déjà peu aisés, et la chaleur entraînait une baisse de leurs revenus et une diminution de leur alimentation. Ils ont dû acheter du matériel d’irrigation coûteux et des variétés de cultures résistantes à la chaleur, ce qui a encore réduit leurs profits.
Les travailleurs de l’économie informelle ont déclaré que le fait d’être exposés à la chaleur sans protection adéquate leur causait de la fatigue et des maladies, limitant ainsi leur capacité à travailler.
Les transports publics sont inconfortables pendant les journées chaudes, poussant les gens à rester chez eux. Ce qui réduit les revenus des petits commerçants qui dépendent de la mobilité des clients.
Nos recherches ont montré que les communautés à faibles revenus et les zones défavorisées sont les plus touchées par l’îlot de chaleur urbain. Plus Yaoundé se réchauffe, plus les inégalités s’aggravent, car les personnes démunies ont moins accès aux infrastructures de climatisation et aux soins de santé.
Que faut-il faire maintenant ?
Bâtiments existants : de nouvelles réglementations d’urbanisme adaptatives sont nécessaires pour obliger les promoteurs immobiliers à adapter leurs bâtiments au changement climatique.
Nouveaux bâtiments : Yaoundé a un besoin urgent de plus d’espaces verts, tels que des parcs et des zones arborées. Ceux-ci doivent être obligatoires dans tous les nouveaux projets de construction et de logement.
Habitats informels : On estime que 60 % de la population camerounaise vit dans des quartiers informels urbains avec des routes non goudronnées, des maisons de fortune et un manque d’eau potable et d’assainissement. Ces habitants ont besoin d’une formation sur la manière de construire en utilisant la terre battue afin de rendre leurs maisons plus durables et plus fraîches. Des systèmes de collecte des eaux de pluie et d’assainissement écologiques, tels que des toilettes sèches qui n’utilisent pas d’eau, pourraient être intégrés.
Les habitants des quartiers informels pourraient également apprendre à concevoir des toits verts et des pergolas pour créer de l’ombre.
Des campagnes de sensibilisation du public aux effets de la chaleur doivent être lancées. La ville doit également suivre l’état de santé publique pendant les vagues de chaleur et améliorer le traitement des maladies liées à la chaleur.
Pour y parvenir, les agences gouvernementales, les organisations non gouvernementales et les communautés locales devront élaborer ensemble des plans d’adaptation au changement climatique. Les obligations vertes, les fonds de résilience urbaine, les partenariats public-privé, les écotaxes et la microfinance sont indispensables pour financer ces projets de développement durable.
![]()
Philippes Mbevo Fendoung does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
– ref. Yaoundé risque de frôler les 38 °C d’ici 2030 : comment un aménagement écologique peut rafraîchir la capitale camerounaise – https://theconversation.com/yaounde-risque-de-froler-les-38-c-dici-2030-comment-un-amenagement-ecologique-peut-rafraichir-la-capitale-camerounaise-268449