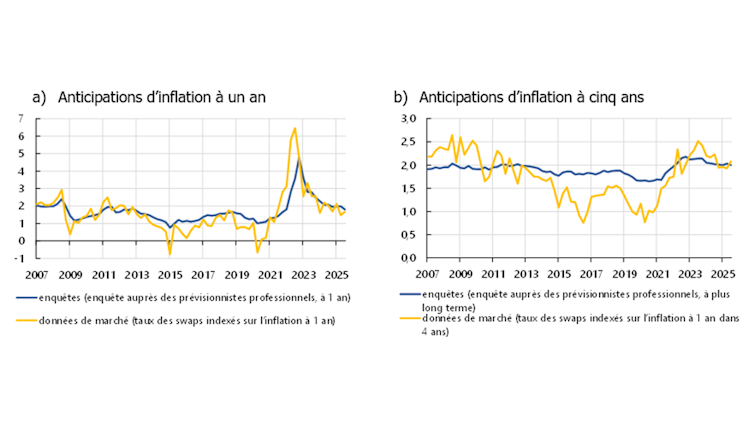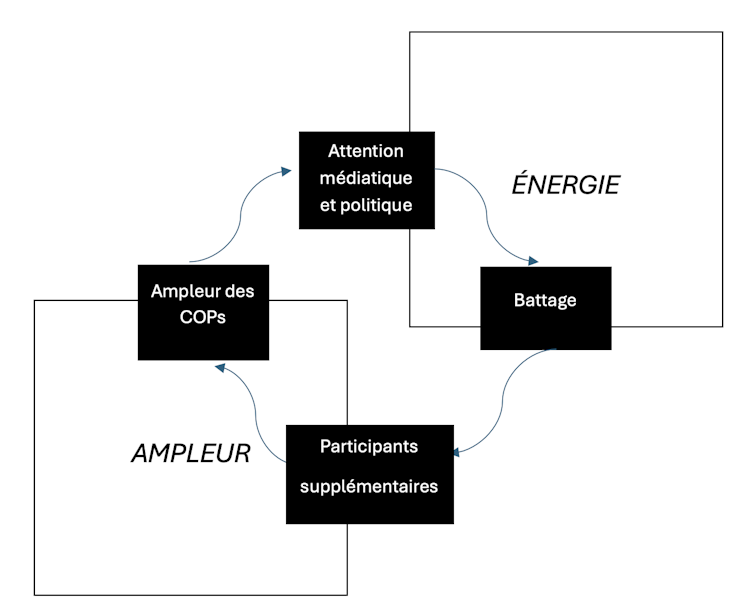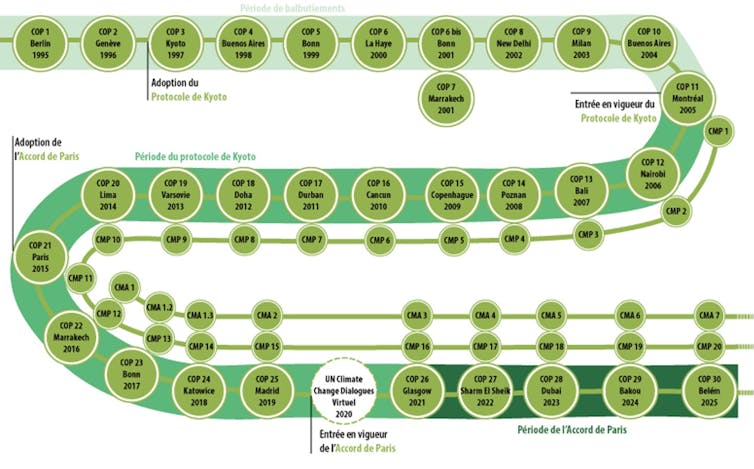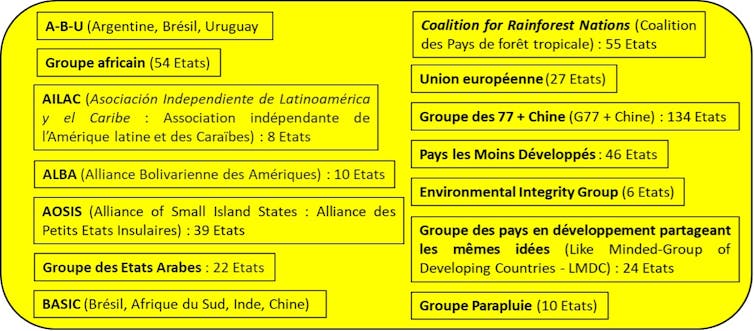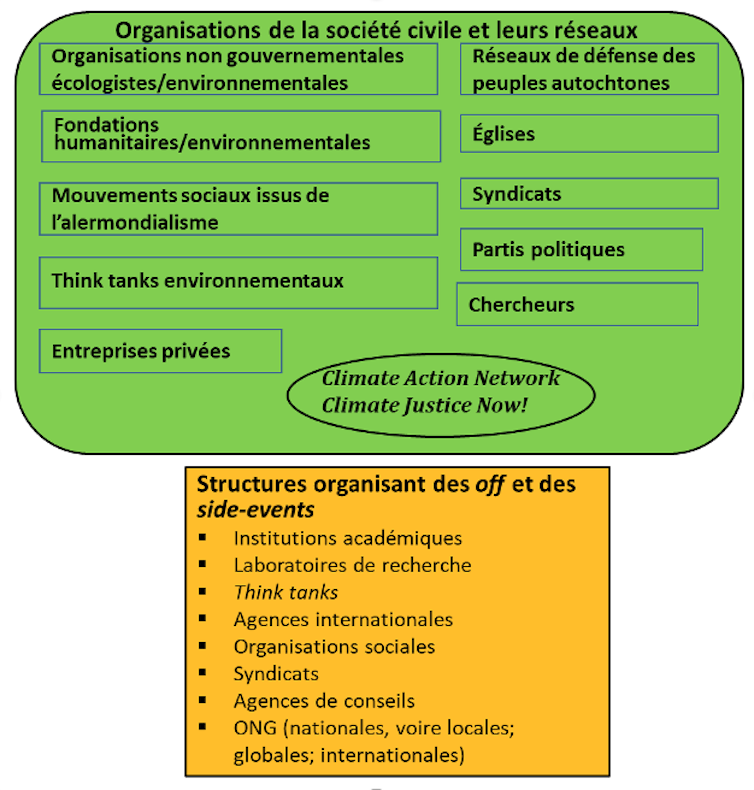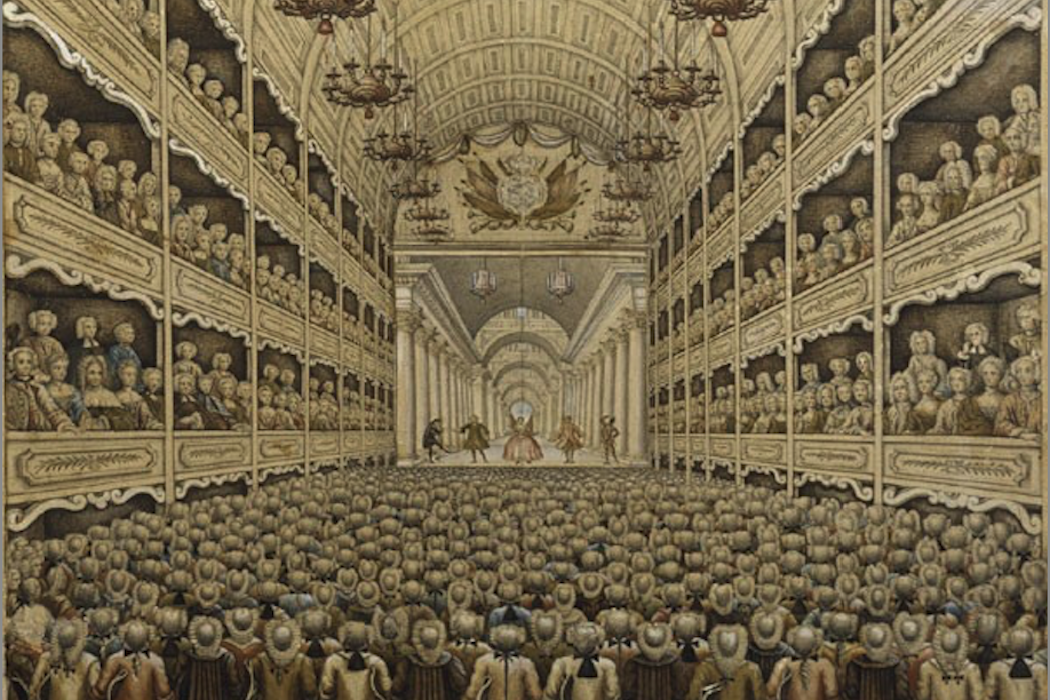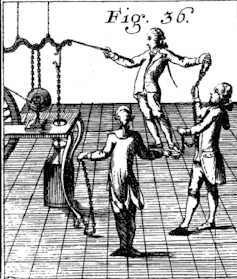Source: The Conversation – in French – By Arnaud Borremans, Chercheur associé à l’Institut de recherche Montesquieu (IRM), Université Bordeaux Montaigne

Clarice Pelotas
Autour de Donald Trump, nous retrouvons bon nombre de personnalités influencées par l’idéologie des Lumières sombres. L’auteur de l’essai qui a donné son nom à cette école de pensée, Nick Land, demeure relativement peu connu mais ses travaux sont de plus en plus étudiés. Pour les comprendre, il est nécessaire de bien appréhender la notion d’hyperstition qu’il a forgée.
Philosophe britannique né en 1962, Nick Land est connu pour avoir popularisé l’idéologie de l’accélérationnisme. Son travail s’émancipe des conventions académiques et utilise des influences peu orthodoxes et même ésotériques.
Dans les années 1990, Land était membre de l’Unité de Recherche sur la Culture cybernétique (CCRU), un collectif qu’il a cofondé avec la philosophe cyber-féministe Sadie Plant à l’Université de Warwick et dont l’activité principale consistait à écrire de la « théorie-fiction ». À cette époque, Land a cherché, dans ses travaux, à unir la théorie post-structuraliste, principalement la pensée d’auteurs comme Marx, Bataille, Deleuze et Guattari, avec des éléments issus de la science-fiction, de la culture rave et de l’occultisme. Si la démarche de la CCRU en tant que telle était expérimentale, plusieurs éléments laissent penser rétrospectivement que Land y a insufflé des éléments relevant de sa propre idéologie.
Land a démissionné de Warwick en 1998. Après une période de disparition, il réapparaît à Shanghai où il réside toujours, sans reprendre de poste universitaire, devenant alors le penseur fondateur du mouvement (néo-) réactionnaire (NRx), connu sous le nom de Lumières sombres (Dark Enlightenment), du nom de son essai paru en 2013. Un ouvrage qui aura un impact majeur.
De l’importance des Lumières sombres et de Land en leur sein
Il est important aujourd’hui d’étudier l’idéologie des Lumières sombres car celle-ci est devenue très influente au sein de la droite radicale, spécialement aux États-Unis depuis le début du second mandat de Donald Trump.
Il s’agit d’une contre-culture de droite qui promeut la réaction politique et sociétale face au fonctionnement actuel des sociétés démocratiques, appelant notamment à un retour à une forme de féodalisme et à un cadre de valeurs conservatrices imprégné de religiosité, non pour elle-même mais en tant que garantie d’ordre social.
Pour autant, les promoteurs des Lumières sombres ne se veulent nullement passéistes : ils sont technophiles et capitalistes, deux considérations éminemment modernes et qu’ils cherchent à concilier avec leur démarche de réaction. D’où des tensions de plus en plus sensibles avec une bonne partie de la droite chrétienne au sein de la coalition MAGA (Make America Great Again) : de nombreuses personnalités conservatrices, qui se méfient de l’intelligence artificielle et même la diabolisent, se méfient de la fascination assumée des NRx pour cette technologie.
Il n’en demeure pas moins que les tenants des Lumières sombres sont indiscutablement influents au sein de MAGA, notamment parce qu’ils comptent dans leurs rangs le multimilliardaire Peter Thiel qui est non seulement un soutien électoral majeur de Donald Trump mais aussi un idéologue. Thiel cherche de plus en plus ouvertement à réconcilier les Lumières sombres avec la droite chrétienne, notamment en se réclamant du christianisme dans sa pensée politique, tout en y injectant des considérations accélérationnistes.
Or, Land fut justement le premier à théoriser dûment l’accélérationnisme, c’est-à-dire l’une des considérations qui fédèrent le plus les tenants des Lumières sombres : il faut un État fort, appuyé sur un ordre social rigide, en vue de faciliter le progrès technologique, lui-même alimenté par la croissance capitalistique.
Il faut préciser que, dans le modèle de Land, cela créera inévitablement une inégalité sociale amenant même, de par le recours à des augmentations technologiques du corps humain, à une séparation des élites, vouées à devenir une « race » à part ; tout le propos de Land est clairement antidémocratique et relève du darwinisme social.
Même si Land et les autres figures des Lumières sombres échangent peu, quand elles ne marquent pas leur incompréhension et même leur mépris réciproque, comme entre Land et le polémiste étatsunien Curtis Yarvin, Land est incontestablement influent au sein du mouvement et, par association, auprès de l’administration Trump II.
En-dehors de Peter Thiel qui, même s’il ne le cite pratiquement jamais, semble influencé par Land, notamment par sa démarche conciliant techno-capitalisme et mysticisme, l’un des relais les plus évidents du penseur britannique auprès du pouvoir étatsunien est Marc Andreessen, magnat de la tech devenu conseiller officieux du président Trump sur les nominations aux fonctions publiques. En effet, Andreessen s’est fendu en 2023 d’un « Manifeste techno-optimiste » dans lequel il cite nommément Land et partage sa conception du techno-capitalisme comme une entité autonome et même consciente, encourageant une production culturelle qui facilite sa propre expansion.

techno-optimisme.com
Cette dernière considération est intéressante puisqu’elle illustre la portée prise par le concept d’« hyperstition », élaboré par Land durant ses années au sein de la CCRU et qui se retrouve, en creux, dans sa pensée ultérieure, estampillée NRx.
La nature de l’hyperstition
Pour mieux comprendre la notion d’« hyperstition », le blog de Johannes Petrus (Delphi) Carstens, maître de conférences en littérature, à l’Université du Cap-Occidental (Afrique du Sud), et son entretien avec Nick Land constituent les meilleures vulgarisations disponibles.
Comme le rappelle Carstens, cette approche considère les idées comme des êtres vivants qui interagissent et mutent selon des schémas très complexes et même totalement incompréhensibles, tels que des « courants, interrupteurs et boucles, pris dans des réverbérations d’échelle ». Carstens définit l’hyperstition comme une force qui accélère les tendances et les fait se concrétiser, ce qui explique en soi pourquoi l’hyperstition est cruciale pour la pensée politique de Land puisque cette dernière est accélérationniste. Carstens précise que les fictions participent de l’hyperstition parce qu’elles contribuent à diffuser des idées et renforcent ainsi l’attrait pour leur concrétisation. Par exemple, durant son entretien avec Land, Carstens présente l’Apocalypse non pas comme une révélation sur l’avenir mais comme un narratif qui invite les gens à le réaliser.
En outre, Carstens approfondit la nature en propre de l’hyperstition. Tout d’abord, il rappelle le lien entre l’hyperstition et le concept de « mèmes », mais précise que les hyperstitions sont une sous-catégorie très spécifique d’agents mémétiques puisqu’elles sont supposées participer de la confusion postmoderne dans laquelle tout semble « s’effondrer », selon Land et les autres auteurs de la CCRU. D’après les explications de Carstens, notamment via ses citations de Land, le capitalisme est l’un des meilleurs exemples d’hyperstition et même le premier d’entre tous, puisqu’il contribue puissamment à l’accélération postmoderne et facilite ainsi toutes les autres dynamiques hyperstitionnelles.
Ensuite, Carstens souligne la dimension occultiste de l’hyperstition, assumée par Land lui-même. Selon ce dernier, les hyperstitions sont constituées de « nombreuses manipulations, du fait de “sorciers”, dans l’histoire du monde » ; il s’agit de « transmuter les fictions en vérités ». Autrement dit, les hyperstitions sont en réalité « des idées fonctionnant de manière causale pour provoquer leur propre réalité ». Land précise même que les hyperstitions « ont, de manière très réelle, “conjuré” leur propre existence de par la manière qu’elles se sont présentées. » Par exemple, Land et ses co-auteurs de la CCRU présentaient dans leurs théories-fictions le « bug de l’an 2000 » non pas comme une panique injustifiée mais comme un narratif qui aurait pu provoquer un véritable effondrement de la civilisation moderne, ce qui aurait requis un contre-narratif puissamment asséné par les autorités pour calmer les populations.
Enfin, Land insiste sur le fait que l’hyperstition est un outil opérationnel, c’est-à-dire « la (techno-) science expérimentale des prophéties auto-réalisatrices ». Dès lors, Land instille la tentation de manipuler l’hyperstition pour procéder à de l’action politique, notamment en produisant et en propageant des narratifs de manière à les rendre viraux et à atteindre, pour ne pas dire « contaminer », autant d’esprits que possible.
Le rôle de l’hyperstition dans la néo-réaction
Même si Land n’a jamais mentionné l’Ordre architectonique de l’Eschaton (AOE) dans son essai de 2013, sa vision du mouvement NRx correspondait si bien aux intentions et aux comportements de ce groupe fictif inventé par la CCRU que l’hypothèse qu’il aurait servi de modèle à Land mérite d’être examinée. Même si la CCRU, majoritairement constituée de militants de gauche, présentait l’AOE comme une force malfaisante parce que conservatrice et même réactionnaire, il est envisageable que Land ait contribué à forger ce narratif au contraire pour exprimer sa propre sensibilité, qu’il gardait alors pour lui. Dès lors, l’AOE apparaît non plus comme une tentative d’action sur l’hyperstition pour nuire aux forces réactionnaires, en les dénonçant, mais comme une manière de les sublimer en un idéal-type à atteindre.
Selon la diégèse créée par la CCRU, l’AOE est une société plus que secrète. Elle est également décrite comme une « fraternité blanche », un cercle ésotérique strictement clandestin qui se manifeste au monde au travers d’organisations-satellites, même si ces dernières semblent se concurrencer les unes les autres.
Des liens évidents entre l’AOE et les Lumières sombres apparaissent lorsque nous lisons sa représentation dans les théories-fictions de la CCRU. L’AOE est décrit comme une organisation de mages dont les racines remontent à la mythique Atlantide, « source de la tradition hermétique occidentale », et qui considère l’histoire post-atlante comme prédestinée et marquée par la décadence. Cependant, l’AOE ne se résume pas à un ordre ésotérique qui n’agirait qu’au travers de la magie : la CCRU le décrit aussi comme une organisation politique avec des ressources importantes et une intention de remodeler le monde, y compris par des moyens autoritaires et violents.
L’Atlantide et l’AOE sont donc des idéalisations précoces des attentes de Land en termes de politique, notamment en mariant son goût pour la magie avec la réaction et l’autoritarisme. L’hyperstition apparaît dès lors comme une clé de voûte pour les militants néo-réactionnaires, à la fois comme un moyen et comme une fin : leur objectif même devrait être d’aider à la réalisation de l’AOE comme modèle, en diffusant cette fiction et en subjuguant les gens avec ce narratif. Les néo-réactionnaires espèrent qu’en assénant que la réaction est acquise par une forme de providence, qu’elle est sanctuarisée par une puissante société secrète et que celle-ci va dans le sens de leurs propres idées, cela confortera la conviction de leurs propres sympathisants et démobilisera les rangs des forces adverses.
![]()
Arnaud Borremans ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. L’hyperstition, un concept au cœur de la vision de Nick Land, idéologue des Lumières sombres autour de Trump – https://theconversation.com/lhyperstition-un-concept-au-coeur-de-la-vision-de-nick-land-ideologue-des-lumieres-sombres-autour-de-trump-268864