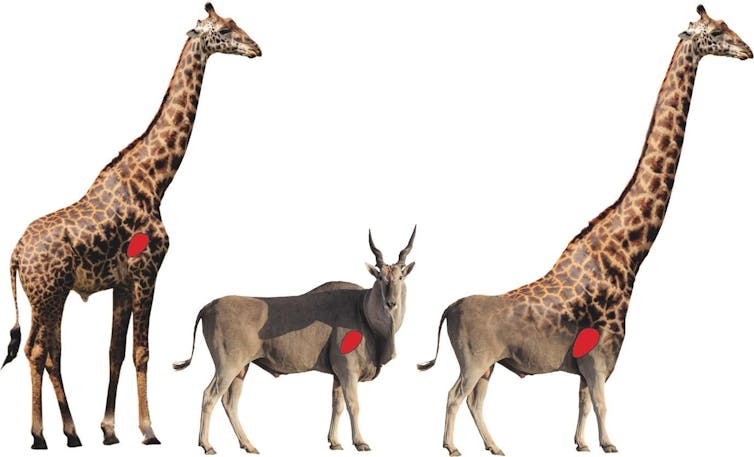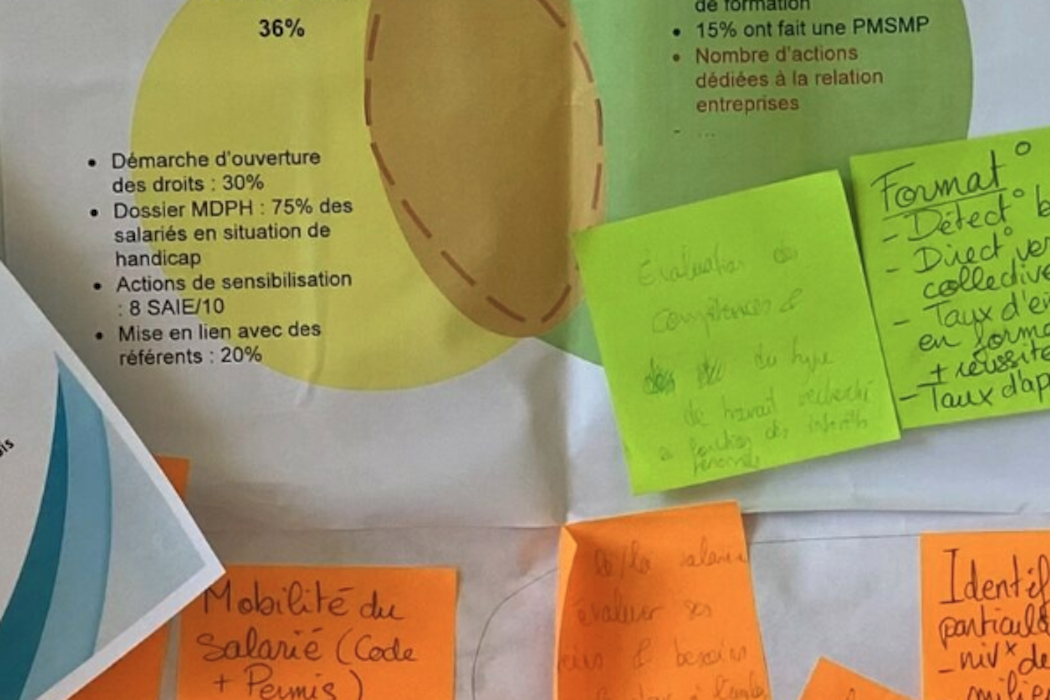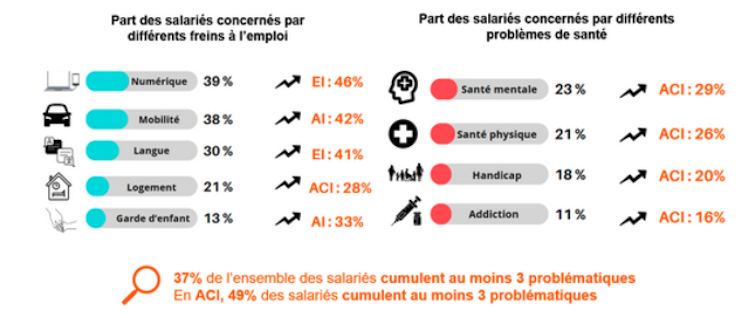Source: The Conversation – in French – By Mihaela Bonescu, Enseignant-chercheur en communication / marketing, Burgundy School of Business

Une étude scientifique, menée auprès de 18 chefs de cuisine étoilés en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Bourgogne, met en lumière les défis pour pérenniser la gastronomie française. Les solutions : transmettre le métier par l’apprentissage, encourager le « fait maison » et promouvoir un bénéfice santé pour la population.
Le 29 septembre 2025, l’agenda du président de la République annonçait un « déjeuner de la gastronomie et de la restauration traditionnelle ». De nombreux représentants de la gastronomie française – restaurateurs et chefs de cuisine étoilés, éleveurs, vignerons, bouchers, charcutiers et autres acteurs – ont fait le déplacement à l’Élysée pour défendre la filière et demander l’aide de l’État. Parmi eux, le chef Mathieu Guibert qui souligne :
« Un peuple qui mange bien est un peuple heureux. »
Après la rencontre avec le chef de l’État, la défiscalisation du pourboire a été préservée, et le discours s’est recentré sur l’attractivité des métiers, la promotion de la qualité ou encore l’éducation au bien-manger. De surcroît, ces échanges ont entériné l’augmentation de maîtres-restaurateurs, titre garantissant le travail des produits frais en cuisine.
Alors, quelle vision du bien-manger ? Quels sont les défis pour pérenniser la haute gastronomie française ? Ces questions ont animé notre recherche menée durant l’année 2024 auprès de 18 chefs de cuisine étoilés, localisés en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Bourgogne.
Problème de recrutement et baisse des fréquentations
Le secteur de la restauration rencontre des difficultés de recrutement du personnel. Plus de 200 000 emplois demeurent non pourvus chaque année, dont environ 38 800 postes d’aides en cuisine.
À cela s’ajoute une baisse de la fréquentation des restaurants traditionnels par les consommateurs. Plusieurs pistes d’explication peuvent la justifier :
-
le prix – critère essentiel de leurs choix ainsi que l’augmentation des tarifs affichés par les restaurants ;
-
l’amplification de l’effet de saisonnalité – avec des pics d’activité durant les périodes de vacances et les week-ends ;
-
l’évolution des habitudes de manger – la déstructuration du repas (plateau-télé, repas sur le pouce, apéro dînatoire ou grignotage) prend le dessus sur le repas traditionnel familial, qui reste un moment de socialisation et de convivialité …
-
l’évolution des comportements de consommation vers des régimes alimentaires moins carnés, moins caloriques, s’inscrivant dans une consommation plus responsable tout en exigeant du goût et de la qualité, des produits frais et naturels, locaux et du terroir, issus du travail des artisans.
L’apprentissage, condition de survie du métier
Un premier résultat de cette étude souligne l’importance de la continuité du financement de l’apprentissage comme l’indique un chef :
« Les bonnes écoles sont souvent des écoles privées qui sont très coûteuses, donc, de nouveau, on met les pieds dans un système où l’argent a une place importante. »
À ces considérations financières se rajoute une nécessaire adaptation des contenus et des compétences attendues des programmes pédagogiques qui « sont en retard ».
L’enjeu est de préserver les bases techniques du métier. Les chefs interrogés le regrettent : « Les bases en cuisine, maintenant on ne les apprend plus à l’école. » Ils pensent « qu’il y a un problème de formation », car « les apprentis n’ont pas de lien avec le produit, on leur apprend juste à cuisiner, on devrait revoir un peu notre façon de former et d’aller à la base ».
La transmission de la maîtrise technique du métier de cuisinier – savoir-faire, tours de main, recettes – reste une préoccupation quotidienne pour que les jeunes apprentis progressent et choisissent ces filières de formation. Si des cursus, tels que les CAP, Bacs pro, brevets professionnels (BP) ou BTS, assurent le premier niveau de formation, ce sont par la suite les chefs qui prennent le relais auprès de la nouvelle génération pour consolider l’aspect technique du métier et insuffler des valeurs qui portent la communauté.
« C’est à nous de nous battre pour que les gens se fédèrent autour de nous et que les jeunes suivent. En tant que chef, c’est ça la transmission. »
Ambassadeurs du terroir et des territoires
Les chefs interrogés ont exprimé leur nette préférence pour les bons produits provenant d’un approvisionnement en circuit court, grâce au travail des petits producteurs situés souvent à quelques kilomètres du restaurant.
« J’essaye de pas dépasser les 100 kilomètres pour m’approvisionner. »
S’instaure une relation pérenne avec ces producteurs de proximité, relation qui implique la confiance comme condition. Avec le temps, cette relation de proximité peut se transformer en relation amicale et durable, comme l’affirme un chef :
« Moi, j’aime bien ce travail de confiance avec nos producteurs. »
Valoriser les richesses du territoire devient une évidence, avec une conscience éclairée de leur responsabilité sociale vis-à-vis de l’économie locale. Pour les chefs, « le travail pour s’épanouir, pour avancer, pour bien gagner sa vie, pour élever sa famille, pour développer un territoire, pour développer une société » est important, tout comme le fait de « participer à une communauté, à un système économique qui est géographiquement réduit ».
Les chefs de cuisine étoilés n’hésitent pas à s’engager dans la valorisation des aménités patrimoniales locales. Ils mobilisent le tissu des artisans locaux pour offrir aux consommateurs une « cuisine vivante », reflet du territoire, et se considèrent comme des « passeurs » et « ambassadeurs du terroir et du territoire ». Les chefs n’hésitent pas à rendre visible le travail des producteurs en mentionnant leur identité sur les cartes et les sites Internet des restaurants.
À lire aussi :
De Byzance à nos tables : l’étonnante histoire de la fourchette, entre moqueries, scandales et châtiment divin
Éduquer au bien-manger pour une meilleure santé
Les chefs interviewés pensent qu’ils ont un rôle à jouer dans l’amélioration de la santé publique par l’alimentation. Comment ? En insistant sur l’importance des repas, y compris à la maison, et sur la nécessité d’apprendre à cuisiner dès le plus jeune âge. « Bien manger, c’est important ; mais il faut surtout manger différemment », témoigne un chef interviewé.
Ils s’inquiètent de la place du bien-manger au sein des familles.
« Quand je discute avec des institutrices, des enfants de moins de dix ans viennent à l’école sans avoir petit-déjeuné. Là, on parle de santé publique ! »
Ils suggèrent d’introduire des cours de cuisine au sein des programmes scolaires pour sensibiliser les plus jeunes à la saisonnalité des produits, à la conservation des ressources naturelles et à la culinarité.
Même si des dispositifs officiels existent comme la loi Égalim, le programme national nutrition santé (PNNS) avec le célèbre mantra « Bien manger et bien bouger », leur application reste à développer au moyen d’actions concrètes. Si la défiscalisation reste un sujet en restauration, d’autres enjeux sont à considérer : la transmission du métier par l’apprentissage, le « fait maison » et le bien-manger pour conserver un bénéfice santé et le plaisir à table.
![]()
Pascale Ertus a reçu des financements de l’Académie PULSAR de la Région des Pays de la Loire, de l’Université de Nantes et du LEMNA (Laboratoire d’Economie et de Management de Nantes Université).
Mihaela Bonescu ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. L’avenir de la gastronomie française ne se joue pas uniquement dans l’assiette – https://theconversation.com/lavenir-de-la-gastronomie-francaise-ne-se-joue-pas-uniquement-dans-lassiette-267040