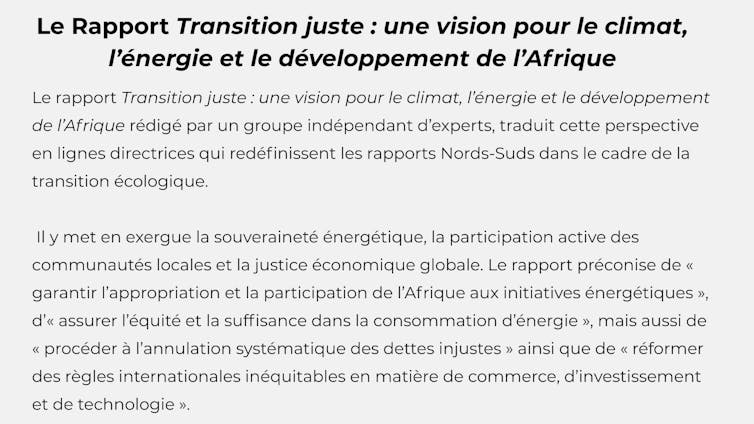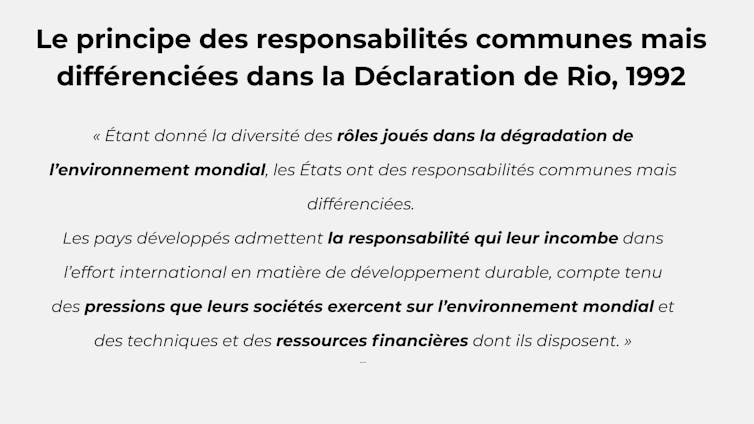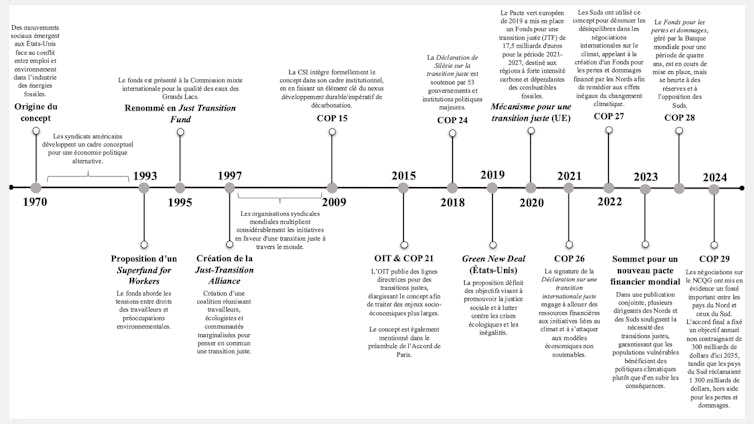Source: The Conversation – in French – By Jillian Sunderland, PhD candidate in Sociology, University of Toronto
Sur TikTok et les campus universitaires, les jeunes hommes redéfinissent aujourd’hui la masculinité, parfois avec des lattes au matcha, des Labubus, des appareils photo argentiques et des sacs fourre-tout achetés d’occasion.
À l’Université métropolitaine de Toronto, un concours intitulé « homme performatif » (performative male, en anglais) a récemment attiré une foule considérable en se moquant de ce nouvel archétype de la masculinité sur TikTok. Ce terme désigne les jeunes hommes qui se construisent délibérément une image douce, sensible et émotionnellement consciente, marquant leur rejet de la « masculinité toxique ».
Lors de ces concours, les participants rivalisent pour faire rire et attirer l’attention des femmes en récitant des poèmes, en exhibant des vêtements d’occasion ou en distribuant des produits d’hygiène féminine afin de montrer qu’ils font partie des « gentils ».
Des événements similaires ont eu lieu de San Francisco à Londres, reflétant un changement plus large dans la façon dont la génération Z aborde le genre. Des recherches montrent que les jeunes hommes expérimentent le genre en ligne, mais le public réagit souvent avec humour ou scepticisme.
Cela soulève une question importante : à l’heure où la « masculinité toxique » est dénoncée, pourquoi les réactions du public face à des versions plus douces de la masculinité oscillent-elles entre curiosité, ironie et jugement ?
Pourquoi la génération Z parle de « performatif »
La méfiance de la génération Z envers ces jeunes hommes peut s’expliquer en partie par des changements culturels plus larges.
Comme le montrent les recherches sur les réseaux sociaux, les jeunes attachent de l’importance à l’authenticité, qu’ils perçoivent comme un gage de confiance. Si la génération Y a perfectionné l’art de se mettre en scène via égoportraits et vidéos montrant ses meilleurs moments, la génération Z valorise la spontanéité et le naturel.
Des études sur TikTok révèlent que de nombreux utilisateurs partagent et consomment davantage de contenus émotionnellement « bruts », en contraste avec l’esthétique plus travaillée d’Instagram.
Dans ce contexte, « l’homme performatif » se distingue parce qu’il semble mettre trop d’efforts afin de paraître sincère. Le latte au matcha, l’appareil photo argentique, le sac fourre-tout : ce ne sont que des accessoires, pas des valeurs. Ainsi, ceux qui ont réellement intégré ces valeurs n’auraient pas besoin de le signaler en se promenant avec un carnet Moleskine ou un essai de la poétesse Sylvia Plath.
Mais comme l’explique la philosophe Judith Butler, tous les genres sont « performatifs » : ils se construisent par des actions répétées. Les sociologues Candace West et Don Zimmerman appellent cela « faire son genre » – le travail quotidien consistant à montrer que l’on est « homme » ou « femme ».
Ce cadre permet de comprendre pourquoi « l’homme performatif » peut sembler hypocrite : le genre est toujours performatif et contrôlé, destiné à paraître maladroit avant de sembler naturel.
À cet égard, la moquerie des « hommes performatifs » sert à maintenir les hommes dans la « boîte masculine », c’est-à-dire les limites étroites de la masculinité acceptée. Des études montrent que depuis l’école jusqu’au travail, les hommes sont jugés plus sévèrement que les femmes lorsqu’ils sortent des normes de genre. De cette manière, la moquerie envoie un message à tous les hommes, leur indiquant qu’il existe des limites à la manière dont ils peuvent s’exprimer.
À lire aussi :
Les « contes de fée » sur les réseaux sociaux peuvent miner votre confiance, mais vous pouvez aussi en rire!
Quand le progrès reste un privilège
Cependant, de nombreux chercheurs mettent en garde contre le fait que ces nouveaux styles masculins pourraient encore renforcer certains privilèges.
Dans l’ère post-#MeToo, où la « masculinité toxique » est critiquée, de nombreux hommes revisitent leur identité. Les appels en faveur d’une « masculinité saine » et de modèles masculins positifs témoignent d’une culture en quête de nouvelles façons d’être un homme, encore incertaines.
Dans ce contexte, de nombreux commentateurs publics affirment que ces hommes se présentent comme conscients d’eux-mêmes, proches du féminisme et « différents des autres hommes » pour séduire plus facilement.
Les sociologues Tristan Bridges et C.J. Pascoe parlent de « masculinité hybride » : certains hommes privilégient une esthétique progressiste ou queer pour consolider leur statut tout en conservant leur autorité.
Une analyse de 2022 sur les créateurs masculins populaires de TikTok montre que plusieurs brouillent les frontières de genre par la mode et la présentation de soi, tout en renforçant certaines normes de blancheur, de musculature et de désirabilité hétérosexuelle.
Cela rejoint les critiques fréquentes des « hommes performatifs » : ils utilisent le langage du féminisme ou de la thérapie sans changer leur approche du partage de l’espace, de l’attention ou de l’autorité.
Ces petites expériences ont-elles de l’importance ?
Pourtant, comme l’affirme la sociologue Francine Deutsch dans sa théorie du « défaire le genre », le changement commence souvent par des actes partiels et imparfaits. Des études montrent que copier et expérimenter les genres sont des moyens essentiels pour apprendre de nouveaux rôles de genre.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
À première vue, il n’y a rien de fondamentalement néfaste à ce que les hommes s’adonnent à la tenue d’un journal intime, à la collection de disques vinyles ou à l’art du latte.
En fait, les recherches sur la jeunesse et la lutte contre la radicalisation suggèrent que ces activités pourraient constituer des outils pratiques pour contrer la radicalisation et l’isolement en ligne, un autre problème qui touche les jeunes hommes.
À lire aussi :
‘ Adolescence ‘ est une critique poignante de la masculinité toxique chez les jeunes
À quoi ressemblerait le changement ?
En réalité, nous ne disposons peut-être pas encore des outils nécessaires pour reconnaître le changement. Une grande partie de notre monde est créée pour être partagée et consommée sur les réseaux sociaux. La domination masculine semble ainsi difficile à remettre en question.
Un signe positif est que, plutôt que d’être sur la défensive, de nombreux créateurs masculins se moquent de la situation et utilisent la parodie comme un moyen d’explorer à quoi pourrait ressembler un homme plus sensible.
Et peut-être que la tendance « homme performatif » nous renvoie l’image de nos propres contradictions. Nous exigeons de l’authenticité, mais nous consommons du spectacle ; nous supplions les hommes de changer, mais nous les critiquons lorsqu’ils essaient ; nous demandons de la vulnérabilité, mais nous reculons lorsqu’elle semble trop forcée.
L’« homme performatif » peut sembler ironique, mais il expérimente également ce que signifie être un homme aujourd’hui.
Il n’est pas encore certain que cette expérience mènera à un changement durable ou qu’elle ne sera qu’une autre mode en ligne, mais elle donne un aperçu de la manière dont la masculinité est en train d’être réécrite, latte après latte.
![]()
Jillian Sunderland a précédemment reçu des financements du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et de la Bourse d’études supérieures de l’Ontario (BESO).
– ref. Homme « performatif » : la nouvelle masculinité des jeunes attire curiosité, ironie et jugement – https://theconversation.com/homme-performatif-la-nouvelle-masculinite-des-jeunes-attire-curiosite-ironie-et-jugement-270341