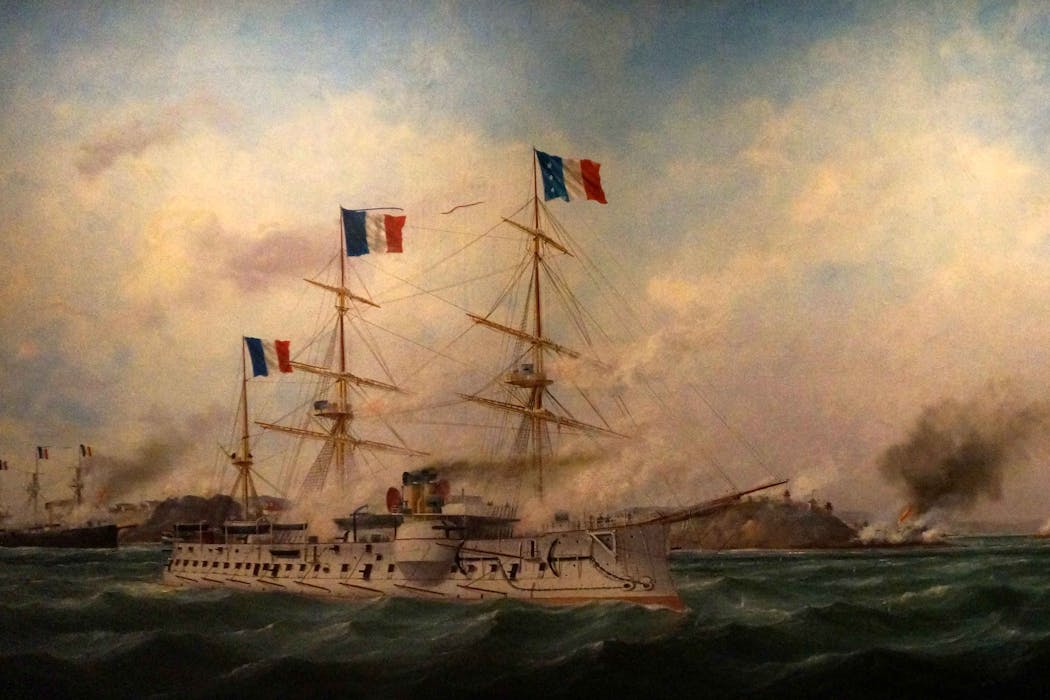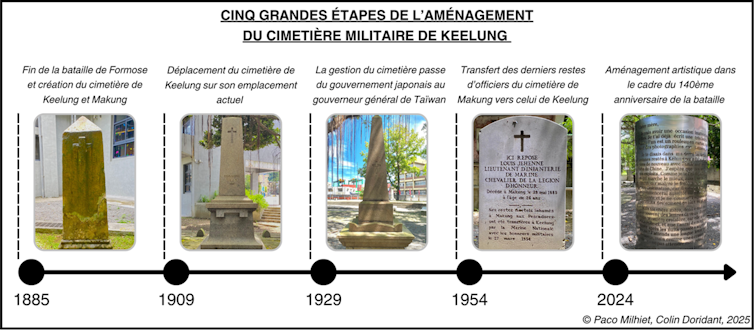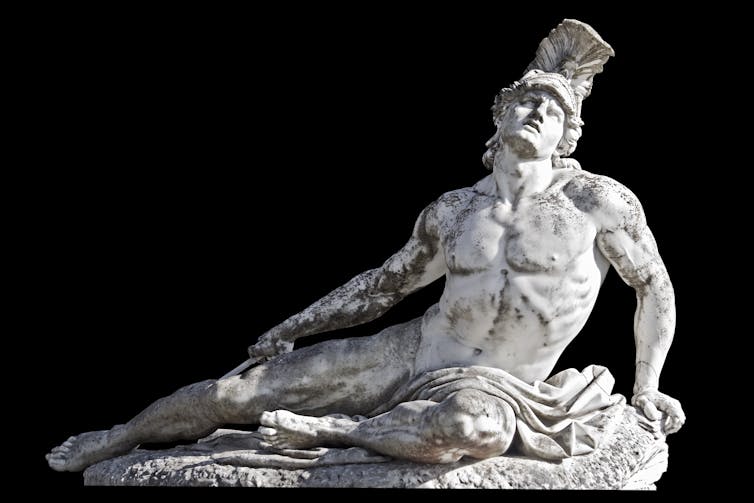Source: The Conversation – in French – By Shaoyu Yuan, Adjunct Professor, New York University; Rutgers University
En adoptant en octobre le quinzième plan quinquennal du pays, Xi Jinping renforce le modèle dirigé par l’État, misant sur la technologie et la défense plutôt que sur la consommation des ménages. Un pari à haut risque…*
A intervalle régulier, depuis 1953, le gouvernement chinois dévoile une nouvelle stratégie directrice pour son économie : le très important plan quinquennal. Dans l’ensemble, ces feuilles de route ont eu pour objectif de stimuler la croissance et l’unité du pays alors qu’il se transformait d’une économie rurale et agricole en une puissance urbaine et développée.
La tâche à laquelle les dirigeants chinois étaient confrontés lorsqu’ils se sont réunis début octobre 2025 pour élaborer leur quinzième plan de ce type se heurtait cette fois à deux difficultés majeures : la faiblesse de la croissance intérieure et l’intensification des rivalités géopolitiques.
Leur solution ? Miser sur les mêmes recettes. En promettant d’assurer un « développement de haute qualité » grâce à l’autonomie technologique, à la modernisation industrielle et à l’expansion de la demande intérieure, Pékin renforce son pari sur un modèle dirigé par l’État, celui-là même qui a alimenté son essor ces dernières années. Le président Xi Jinping et les autres responsables ayant finalisé le plan 2026-2030 parient sur le fait qu’une croissance industrielle tirée par l’innovation pourrait garantir l’avenir de la Chine, même si des interrogations persistent sur la faiblesse des dépenses de consommation et sur les risques économiques croissants.
En tant qu’expert de l’économie politique de la Chine, je considère le nouveau plan quinquennal chinois autant comme un instrument de pouvoir que comme un outil économique. En réalité, il s’agit avant tout d’une feuille de route destinée à naviguer dans une nouvelle ère de compétition. Ce faisant, il risque toutefois de ne pas s’attaquer au fossé grandissant entre une capacité industrielle en plein essor et une demande intérieure atone.
Des rêves high-tech
Au cœur du nouveau plan on trouve des orientations plaçant l’industrie et l’innovation technologique au premier plan. Concrètement, cela signifie moderniser les usines traditionnelles, automatiser et « verdir » l’industrie lourde, tout en favorisant l’émergence de « secteurs d’avenir » tels que l’aérospatiale, les énergies renouvelables ou l’informatique quantique.
En faisant migrer l’économie vers le haut de la chaîne de valeur, Pékin espère échapper au piège du revenu intermédiaire et consolider son statut de superpuissance technologique autosuffisante. Pour protéger la Chine des contrôles à l’exportation instaurés par d’autres pays afin de freiner son ascension, Pékin redouble d’efforts pour « internaliser » les technologies critiques, en injectant massivement des fonds dans les entreprises nationales tout en réduisant la dépendance envers les fournisseurs étrangers.
Cette quête d’autosuffisance ne relève pas uniquement de considérations économiques : elle est explicitement liée à la sécurité nationale. Sous la direction de Xi Jinping, la Chine a poursuivi avec détermination ce que le Parti communiste chinois appelle la « fusion militaro-civile », c’est-à-dire l’intégration de l’innovation civile aux besoins militaires. Le nouveau plan quinquennal devrait institutionnaliser cette fusion comme principal levier de modernisation de la défense, garantissant que toute avancée dans l’intelligence artificielle ou la puissance de calcul civiles profite automatiquement à l’Armée populaire de libération.
Restructurer le commerce mondial
L’offensive chinoise, pilotée par l’État, dans les industries de haute technologie porte déjà ses fruits, et le nouveau plan quinquennal vise à prolonger cette dynamique. Au cours de la dernière décennie, la Chine s’est hissée au rang de leader mondial des technologies vertes – panneaux solaires, batteries et véhicules électriques – grâce à un soutien massif du gouvernement. Pékin entend désormais reproduire ce succès dans les semi-conducteurs, les machines de pointe, la biotechnologie et l’informatique quantique.
Une telle ambition, si elle se concrétise, pourrait redessiner les chaînes d’approvisionnement mondiales et les normes industrielles à l’échelle planétaire.
Mais cette stratégie accroît également les enjeux de la rivalité économique qui oppose la Chine aux économies avancées. La maîtrise chinoise de chaînes d’approvisionnement complètes a poussé les États-Unis et l’Europe à évoquer une réindustrialisation afin d’éviter toute dépendance excessive vis-à-vis de Pékin.
En promettant de bâtir « un système industriel moderne fondé sur une industrie manufacturière de pointe » et d’accélérer « l’autosuffisance scientifique et technologique de haut niveau », le nouveau plan indique clairement que la Chine ne renoncera pas à sa quête de domination technologique.
Un rééquilibrage insaisissable
Ce à quoi le plan accorde en revanche une attention relativement limitée, c’est au manque de dynamisme de la demande intérieure. Le renforcement de la consommation et des conditions de vie ne reçoit guère plus qu’un assentiment de principe dans le communiqué publié à l’issue du plénum au cours duquel le plan quinquennal a été élaboré.
Les dirigeants chinois ont bien promis de « stimuler vigoureusement la consommation » et de bâtir « un marché intérieur solide », tout en améliorant l’éducation, la santé et la protection sociale. Mais ces objectifs n’apparaissent qu’après les appels à la modernisation industrielle et à l’autosuffisance technologique – signe que les priorités anciennes continuent de dominer.
Et cela ne manquera pas de décevoir les économistes qui appellent depuis longtemps Pékin à passer d’un modèle ouvertement tourné vers les exportations à un modèle de croissance davantage porté par la consommation des ménages.
La consommation des ménages ne représente encore qu’environ 40 % du produit intérieur brut, bien en deçà des standards des économies avancées. En réalité, les ménages chinois se remettent difficilement d’une série de chocs économiques récents : les confinements liés au Covid-19 qui ont ébranlé la confiance des consommateurs, l’effondrement du marché immobilier qui a anéanti des milliers de milliards de richesse, et la montée du chômage des jeunes, qui a atteint un niveau record avant que les autorités n’en suspendent la publication.
Avec des gouvernements locaux enchevêtrés dans la dette et confrontés à de fortes tensions budgétaires, le scepticisme est de mise quant à la possibilité de voir émerger prochainement des politiques sociales ambitieuses ou des réformes favorables à la consommation.
Puisque Pékin renforce son appareil manufacturier tandis que la demande intérieure demeure faible, il est probable que l’excédent de production soit écoulé à l’étranger – notamment dans les secteurs des véhicules électriques, des batteries et des technologies solaires – plutôt qu’absorbé par le marché domestique.
Le nouveau plan reconnaît la nécessité de maintenir une base industrielle solide, en particulier dans des secteurs industriels en difficulté et d’autres, anciens, peinant à rester à flot. Cette approche peut ainsi éviter, à court terme, des réductions d’effectifs douloureuses, mais elle retarde le rééquilibrage vers les services et la consommation que de nombreux économistes jugent nécessaire à la Chine.
Effets en cascade
Pékin a toujours présenté ses plans quinquennaux comme une bénédiction non seulement pour la Chine, mais aussi pour le reste du monde. Le récit officiel, relayé par les médias d’État, met en avant l’idée qu’une Chine stable et en croissance demeure un « moteur » de la croissance mondiale et un « stabilisateur » dans un contexte d’incertitude globale. Le nouveau plan appelle d’ailleurs à un « grand niveau d’ouverture », en conformité avec les règles du commerce international, à l’expansion des zones de libre-échange et à l’encouragement des investissements étrangers – tout en poursuivant la voie de l’autosuffisance.
Pourtant, la volonté de la Chine de gravir l’échelle technologique et de soutenir ses industries risque d’intensifier la concurrence sur les marchés mondiaux – potentiellement au détriment des fabricants d’autres pays. Ces dernières années, les exportations chinoises ont atteint des niveaux record. Cet afflux de produits chinois à bas prix a mis sous pression les industriels des pays partenaires, du Mexique à l’Europe, qui commencent à envisager des mesures de protection. Si Pékin redouble aujourd’hui de soutien financier à la fois pour ses secteurs de pointe et ses industries traditionnelles, le résultat pourrait être une surabondance encore plus forte de produits chinois à l’échelle mondiale, aggravant les tensions commerciales.
Autrement dit, le monde pourrait ressentir davantage la puissance industrielle de la Chine, sans pour autant bénéficier suffisamment de son pouvoir d’achat – une combinaison susceptible de mettre à rude épreuve les relations économiques internationales.
Un pari risqué sur l’avenir
Avec le quinzième plan quinquennal de la Chine, Xi Jinping mise sur une vision stratégique à long terme. Il ne fait aucun doute que le plan est ambitieux et global. Et s’il réussit, il pourrait propulser la Chine vers des sommets technologiques et renforcer ses prétentions au statut de grande puissance.
Mais ce plan révèle aussi la réticence de Pékin à s’écarter d’une formule qui a certes généré de la croissance, mais au prix de déséquilibres ayant pénalisé de nombreux ménages à travers le vaste territoire chinois.
Plutôt que d’opérer un véritable changement de cap, la Chine tente de tout concilier à la fois : rechercher l’autosuffisance tout en poursuivant son intégration mondiale, proclamer son ouverture tout en se fortifiant, et promettre la prospérité au peuple tout en concentrant ses ressources sur l’industrie et la défense.
Mais les citoyens chinois, dont le bien-être est censé être au cœur du plan, jugeront en fin de compte de son succès à l’aune de la progression de leurs revenus et de l’amélioration de leurs conditions de vie d’ici 2030. Et ce pari s’annonce difficile à tenir.
![]()
Shaoyu Yuan ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Avec son nouveau plan quinquennal, la Chine prend un pari très risqué – https://theconversation.com/avec-son-nouveau-plan-quinquennal-la-chine-prend-un-pari-tres-risque-269422