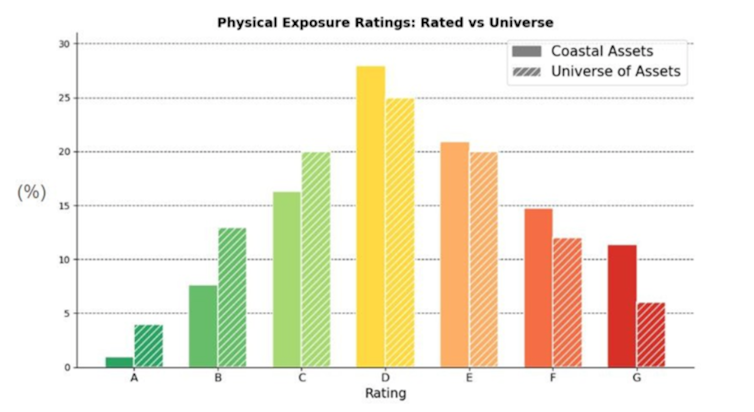Source: The Conversation – in French – By Nathalie Sonnac, Professeure en sciences de l’information et de la communication, Université Paris-Panthéon-Assas
Les campagnes de dénigrement de l’audiovisuel public, portées par des médias privés, ont récemment pris une ampleur inédite. Le Rassemblement national ne cache pas son intention de le privatiser s’il arrive au pouvoir. Quelles seraient les conséquences de ce choix aux plans économique et politique ?
Nous assistons depuis plusieurs années à une crise des régimes démocratiques, qui se traduit par la montée de dirigeants populistes et/ou autoritaires au pouvoir et à une défiance massive des populations envers les institutions, journalistes et médias. En l’espace d’une génération, les réseaux sociaux les ont supplantés comme les principales sources d’information : 23 % des 18-25 ans dans le monde (Reuters Institute, 2024) s’informent sur TikTok, 62 % des Américains s’informent sur les réseaux sociaux, tandis que seul 1 % des Français de moins de 25 ans achètent un titre de presse.
Pour autant, dans ce nouveau paysage médiatique, la télévision continue d’occuper une place centrale dans la vie des Français, qu’il s’agisse du divertissement, de la culture ou de la compréhension du monde. Elle demeure le mode privilégié d’accès à l’information : 36 millions de téléspectateurs lors d’une allocution du président Macron pendant la crise sanitaire ; près de 60 millions de Français (vingt heures en moyenne par personne) ont suivi les JO de Paris sur France Télévisions. Le groupe public – qui réunit 28 % de part d’audience en 2024 – est la première source d’information chez les Français, il bénéficie d’un niveau de confiance supérieur à celui accordé aux chaînes privées.
L’impossible équation économique d’une privatisation de l’audiovisuel public
Pourtant, tel un marronnier, l’audiovisuel public est régulièrement attaqué par des politiques prônant sa privatisation, voire sa suppression, parfois au nom d’économies pour le contribuable ; d’autres fois, par idéologie. La « vraie-fausse » vidéo des journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen, diffusée en boucle sur la chaîne CNews, donne l’occasion à certains de remettre une pièce dans la machine.
Concrètement, privatiser l’audiovisuel public signifierait vendre les chaînes France 2, France 3 ou France 5 à des acheteurs privés, comme le groupe TF1, propriétaire des chaînes gratuites, telles que TF1, LCI et TFX ; le groupe Bertelsmann, propriétaire des chaînes gratuites M6, W9 ou 6Ter… ou encore le groupe CMA-CGM, propriétaire de BFM TV.
Sur le plan économique, cela relève aujourd’hui du mirage. Même les chaînes privées, pourtant adossées à de grands groupes, peinent à équilibrer leurs comptes. Dans un environnement aussi fortement compétitif, sur l’audience et les revenus publicitaires – les chaînes, les plateformes numériques, comme YouTube, et les services de vidéo à la demande (SVOD), comme Netflix ou Disney+ (qui ont ouvert leur modèle à la publicité), se livrent une concurrence acharnée. Comment imaginer qu’un nouvel entrant aussi puissant qu’une chaîne du service public soit viable économiquement ? Cela revient à ignorer la situation du marché de la publicité télévisée, qui n’est plus capable d’absorber une chaîne de plus.
Ce marché a reculé de 9 % entre 2014 et 2024. Et la télévision ne pèse plus que 20 % du marché total contre 26 % en 2019, quand le numérique capte désormais 57 % des recettes et pourrait atteindre 65 % en 2030. La fuite des annonceurs vers les plateformes en ligne fragilise toutes les chaînes gratuites de la TNT, dont le financement repose quasi exclusivement sur la publicité.
Le service public, pivot économique de l’écosystème audiovisuel
Une chaîne de télévision, ce sont d’abord des programmes : documentaires, films, séries, jeux, divertissements et informations. Or, malgré l’arrivée de nouveaux acteurs, comme les services de vidéo à la demande, qui investissent à hauteur d’un quart des obligations versées au secteur, la production audiovisuelle reste largement dépendante des chaînes de télévision. Ce secteur pèse lourd : plus de 5 500 entreprises, 125 000 emplois et un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards d’euros.
Le paysage audiovisuel français reste dominé par trois groupes : TF1, M6 et France TV concentrent plus de 90 % du chiffre d’affaires des chaînes gratuites et assurent 75 % de la contribution totale de la production. Parmi eux, le groupe public France TV est le premier partenaire de la production audiovisuelle et cinématographique nationale : il investit chaque année 600 millions d’euros en achat de programmes audiovisuels et cinématographiques et irrigue ainsi toute l’industrie culturelle.
Le secteur de la production audiovisuelle, malgré l’arrivée des acteurs de la SVOD et leur demande croissante de programmes de création originale française (films, animation, documentaires), demeure largement dépendant des commandes des chaînes de télévision : la diminution du nombre de chaînes, notamment publiques, conduirait à fragiliser l’ensemble de la filière audiovisuelle et culturelle.
Une étude d’impact, réalisée en 2021, établit que le groupe France Télévisions génère 4,4 milliards d’euros de contribution au produit intérieur brut (PIB) pour 2,3 milliards d’euros de contributions publiques, 62 000 équivalents temps plein (pour un emploi direct, cinq emplois supplémentaires sont soutenus dans l’économie française), dont 40 % en région et en outre-mer » et pour chaque euro de contribution à l’audiovisuel public (CAP) versé, 2,30 € de production additionnelle sont générés. Loin d’être une charge, le service public audiovisuel est donc un levier économique majeur, créateur d’emplois, de richesse et de cohésion territoriale.
Le service public : un choix européen
Au-delà des chiffres, l’audiovisuel public constitue un choix démocratique. Les missions de services publics sont au cœur des missions de l’Europe, déjà présentes dans la directive Télévision sans frontière, à la fin des années 1980. Aujourd’hui, c’est la directive de services de médias audiovisuels qui souligne l’importance de la coexistence de fournisseurs publics et privés, allant jusqu’à formuler qu’elle caractérise le marché européen des médias audiovisuels.
Le Parlement européen l’a rappelé en réaffirmant l’importance d’un système mixte associant médias publics et privés, seul modèle capable de garantir à la fois la diversité et l’indépendance. Il ajoute en 2024 dans le règlement sur la liberté des médias l’indispensable « protection des sources journalistiques, de la confidentialité et de l’indépendance des fournisseurs de médias de service public ».
L’étude publiée par l’Observatoire européen de l’audiovisuel en 2022, malgré la diversité des médias publics européens, tous s’accordent autour de valeurs communes : l’indépendance face aux ingérences politiques, l’universalité pour toucher tous les publics, le professionnalisme dans le traitement de l’information, la diversité des points de vue, la responsabilité éditoriale.
Un rôle démocratique indispensable
En France, un suivi très concret et précis du fonctionnement des services publics est assuré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Ces principes sont encadrés par des contrats d’objectifs et de moyens (COM) qui garantissent leur mission démocratique, leur transparence et font l’objet d’un suivi rigoureux par l’autorité de régulation. Plus de 70 articles déterminent les caractéristiques de chaque service public édité, qui vont de la nécessité de faire vivre le débat démocratique à la promotion de la langue française ou l’éducation aux médias et à l’information, en passant par la communication gouvernementale en temps de crise ou encore la lutte contre le dopage. Un cahier des charges est adossé à des missions d’intérêt général, il garantit le pluralisme, la qualité de l’information et l’indépendance éditoriale.
L’information est une de ses composantes essentielles de sa mission d’intérêt général. Elle représente 62,6 % de l’offre globale d’information de la TNT (hors chaînes d’information) en 2024 : JT, émissions spéciales au moment d’élections, magazines de débats politiques et d’investigations. Ces derniers apparaissent comme des éléments distinctifs de l’offre.
Une consultation citoyenne de 127 109 personnes, menée par Ipsos en 2019 pour France Télévisions et Radio France, faisait apparaître que « la qualité de l’information et sa fiabilité » ressortaient comme la première des attentes (68 %), devant « un large éventail de programmes culturels » (43 %) et « le soutien à la création française » (38 %). Dans un climat généralisé de défiance à l’égard des institutions, l’audiovisuel public demeure une référence pour les téléspectateurs.
Il est temps de siffler la fin de la récréation
Le cocktail est explosif : concurrence féroce entre chaînes d’info, fuite des annonceurs vers les plateformes numériques, déficit chronique des chaînes privées. En pleine guerre informationnelle, sans réinvestissement massif dans le service public et sans réflexion sur le financement de la TNT, le risque est clair : l’affaiblissement des piliers démocratiques de notre espace public.
En France, ce rôle doit être pleinement assumé. L’État, à travers l’Arcom, est le garant de la liberté de communication, de l’indépendance et du pluralisme. Il va de sa responsabilité d’assurer la pérennité du financement du service public et de protéger son rôle contre les dérives des logiques commerciales et idéologiques.
![]()
Nathalie Sonnac est membre du Carism et du Laboratoire de la République.
– ref. La privatisation du service public, un non-sens économique et une menace pour notre démocratie – https://theconversation.com/la-privatisation-du-service-public-un-non-sens-economique-et-une-menace-pour-notre-democratie-266692