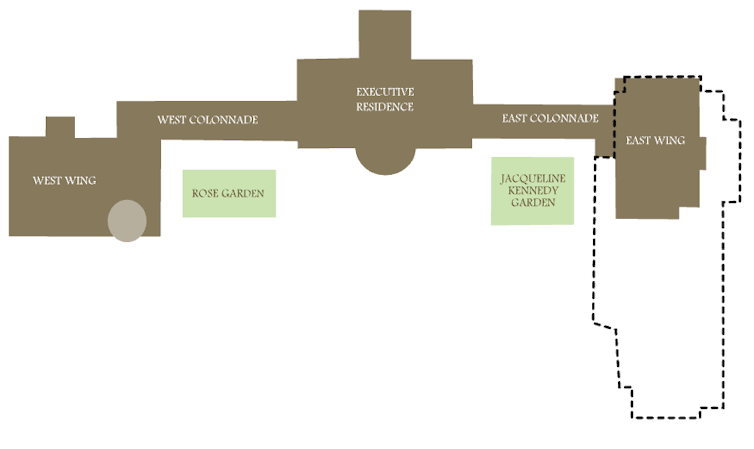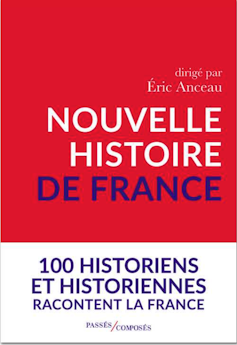Source: The Conversation – in French – By Alejandro Legaz Arrese, Catedrático Área de Educación Física y Deporte, Universidad de Zaragoza

Dans l’ombre de la hausse du mal-être chez les jeunes, une réalité persiste : la puberté marque une rupture nette entre filles et garçons. Des études menées auprès de plus de 10 000 adolescents en Espagne révèlent un écart émotionnel qui s’installe tôt – et qui ne cesse de se creuser.
Ces dernières années, on observe une hausse préoccupante des problèmes de santé mentale chez les jeunes. Pourtant, un aspect essentiel passe souvent inaperçu : cette crise psychique ne touche pas les adolescents et les adolescentes de la même manière.
Dans nos récentes études sur le sommeil, l’anxiété, la dépression, la qualité de vie et le risque de troubles alimentaires, nous avons analysé les données de plus de 10 000 adolescents espagnols âgés de 11 à 19 ans. Les résultats sont sans équivoque : non seulement le fossé émotionnel entre filles et garçons existe, mais il se manifeste tôt et s’intensifie avec l’âge.
Le fossé apparaît à la puberté
La différence entre les sexes n’est pas innée. Elle apparaît avec les changements hormonaux et sociaux de la puberté. Au départ, filles et garçons affichent un bien-être émotionnel similaire. Cependant, à partir de l’âge de 14 ans environ chez les filles, lorsque la puberté bat son plein et que les changements physiques et hormonaux s’accélèrent, les trajectoires commencent à diverger. À partir de ce moment, les filles dorment moins bien, manifestent davantage d’anxiété et rapportent plus de symptômes dépressifs.
Pour beaucoup d’entre elles, l’adolescence devient une période émotionnellement plus intense. De nombreuses jeunes filles décrivent un sentiment de vide, une confusion identitaire et une plus grande difficulté à comprendre ou à réguler leurs émotions. Il ne s’agit pas simplement d’un mal-être passager : à ce stade, l’équilibre émotionnel se fragilise et la réponse au stress s’amplifie.
Un sentiment d’autonomie et de contrôle en recul
Cette phase s’accompagne également d’un changement notable dans la perception de leur autonomie. Certaines adolescentes expriment le sentiment d’avoir moins de prise sur leur temps, leur corps ou leurs décisions. Alors que, pour beaucoup de garçons, la maturité rime avec indépendance, elle s’accompagne chez les filles d’une pression accrue, d’attentes plus fortes et d’exigences plus lourdes envers elles-mêmes.
L’estime de soi chute nettement, tandis que la relation au corps devient plus critique. Les préoccupations liées au poids, à l’apparence ou à l’auto-évaluation constante se multiplient, augmentant le risque de troubles alimentaires. Parallèlement, de nombreuses adolescentes disent se sentir plus fatiguées, avec moins d’énergie et une forme physique en déclin par rapport à la période précédant la puberté.
À lire aussi :
Las chicas adolescentes presentan más síntomas de depresión que los chicos
Ce schéma rejoint les conclusions internationales du rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui souligne une détérioration plus marquée du bien-être psychologique des femmes à partir de la puberté, ainsi qu’une sensibilité émotionnelle accrue pendant cette période.
Ce n’est pas l’environnement qui change, mais la perception de soi
Un point clé ressort : la sphère sociale n’explique pas cet écart. Les relations familiales, scolaires et amicales évoluent de manière similaire chez les deux sexes. Les données ne révèlent pas de différences significatives en matière de soutien social, d’amitiés ou d’expériences de harcèlement.
Le fossé émotionnel ne provient donc pas d’un environnement plus hostile pour les filles. Il émerge de l’intérieur : dans la manière dont elles se sentent, se perçoivent et évaluent le contrôle qu’elles exercent sur leur vie. Il s’agit d’un déséquilibre intime, plutôt que social.
À lire aussi :
Instagram de chicas, instagram de chicos
Hormones et pression esthétique
Pourquoi cette divergence ? L’explication est complexe et multifactorielle. La puberté féminine survient plus tôt et s’accompagne de changements hormonaux plus intenses qui influent sur le sommeil, l’humeur et la gestion du stress. Mais ces transformations, naturelles et communes aux deux sexes, ne constituent ni la cause unique ni la solution. La différence tient à la manière dont elles sont vécues et interprétées dans un environnement social saturé d’attentes autour du corps féminin.
À cela s’ajoute un contexte contemporain dominé par la pression esthétique, l’exposition permanente aux réseaux sociaux et l’injonction à « être parfaite » sur tous les plans. Les dernières études disponibles établissent un lien entre ces dynamiques et la hausse du mal-être émotionnel chez les jeunes filles.
La puberté devient ainsi une période biologique et culturelle particulièrement exigeante pour elles.
Un fossé qui persiste à l’âge adulte
Ce schéma ne disparaît pas avec les années. Les données de notre groupe de recherche et les travaux scientifiques portant sur la population adulte montrent que les femmes continuent de présenter une qualité de sommeil moindre, des niveaux d’anxiété et de dépression plus élevés, ainsi qu’une insatisfaction corporelle plus marquée que les hommes.
Le fossé émotionnel qui s’ouvre à la puberté ne se comble pas spontanément avec le temps.
Le sport, un facteur de protection
Nos données montrent que l’activité physique, et en particulier la pratique du sport de compétition, est associée à un meilleur sommeil, une plus grande satisfaction de vie et un moindre mal-être émotionnel, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Lorsque la pratique sportive est équivalente, les bénéfices le sont aussi : le sport protège de la même manière.
Cependant, l’écart de bien-être entre filles et garçons demeure. Non pas parce que le sport serait moins efficace pour elles, mais parce que les adolescentes font globalement moins d’exercice et participent moins aux compétitions sportives, comme le confirment notre étude et d’autres travaux antérieurs.
Le sport, à lui seul, ne peut compenser les facteurs sociaux qui pèsent plus lourdement sur les adolescentes. En revanche, encourager leur participation, notamment à des niveaux compétitifs, permet de réduire l’écart en leur donnant accès aux mêmes bénéfices que les garçons.
D’autres leviers pour réduire l’écart
La bonne nouvelle, c’est que d’autres stratégies contribuent également à diminuer cet écart émotionnel. Les études montrent que les interventions les plus efficaces sont celles qui renforcent la relation au corps, réduisent la comparaison sociale et améliorent l’estime de soi.
Les programmes scolaires axés sur l’éducation à l’image corporelle et à la perception de soi ont permis de réduire le risque de troubles alimentaires et d’améliorer le bien-être émotionnel des adolescentes.
Les initiatives visant à enseigner une utilisation critique des réseaux sociaux et à identifier les messages nuisibles à l’image de soi se révèlent également efficaces pour limiter la pression esthétique et numérique.
À lire aussi :
Cómo mejorar el bienestar de los universitarios con psicología positiva
Enfin, les stratégies de régulation émotionnelle et de pleine conscience, axées sur l’apprentissage de la gestion du stress, l’apaisement de l’esprit et la connexion avec le présent, ont été associées à une amélioration du bien-être psychologique et à une diminution des niveaux d’anxiété chez les adolescentes.
Ce n’est pas seulement leur responsabilité
Mais tout ne dépend pas d’elles. Les recherches montrent également que le contexte joue un rôle clé. Les familles qui écoutent, valident les émotions et encouragent l’autonomie protègent la santé mentale de leurs filles.
Quand les écoles enseignent des compétences socio-émotionnelles universelles, telles que la reconnaissance des émotions, la résolution des conflits ou le renforcement de l’estime de soi, les symptômes d’anxiété et de dépression dus à l’adolescence diminuent.
Et les médias et les réseaux sociaux ont une énorme responsabilité : la manière dont ils représentent les corps et la réussite influence directement la façon dont les jeunes filles se perçoivent.
En outre, les politiques publiques qui encadrent les messages liés au corps et à l’image, tout en favorisant des environnements éducatifs et sportifs inclusifs, contribuent à réduire la pression esthétique et à améliorer le bien-être des adolescentes.
Une période critique (et une occasion à saisir)
L’adolescence est une étape décisive. En soutenant les filles à ce moment clé, en renforçant leur autonomie, leur estime de soi et leur relation à leur corps et à leurs émotions, nous posons les bases d’un bien-être durable.
Il ne s’agit pas de leur demander d’être fortes. Il s’agit de créer des environnements qui ne les fragilisent pas. Investir aujourd’hui dans la santé mentale des adolescents, c’est construire une société plus juste et plus équilibrée demain.
![]()
Alejandro Legaz Arrese a reçu des financements du Groupe de recherche sur le mouvement humain financé par le gouvernement d’Aragon.
Carmen Mayolas-Pi a reçu des financements associés au groupe de recherche Movimiento Humano de la part du gouvernement d’Aragon.
Joaquin Reverter Masia a reçu des financements du programme national de recherche, développement et innovation axé sur les défis de la société, dans le cadre du plan national de R&D&I 2020-2025. Le titre du projet est : « Évaluation de divers paramètres de santé et niveaux d’activité physique à l’école primaire et secondaire » (numéro de subvention PID2020-117932RB-I00). En outre, la recherche bénéficie du soutien du groupe de recherche consolidé « Human Movement » de la Generalitat de Catalunya (référence 021 SGR 01619).
– ref. Pourquoi les adolescentes se sentent-elles moins bien que les garçons ? – https://theconversation.com/pourquoi-les-adolescentes-se-sentent-elles-moins-bien-que-les-garcons-269663