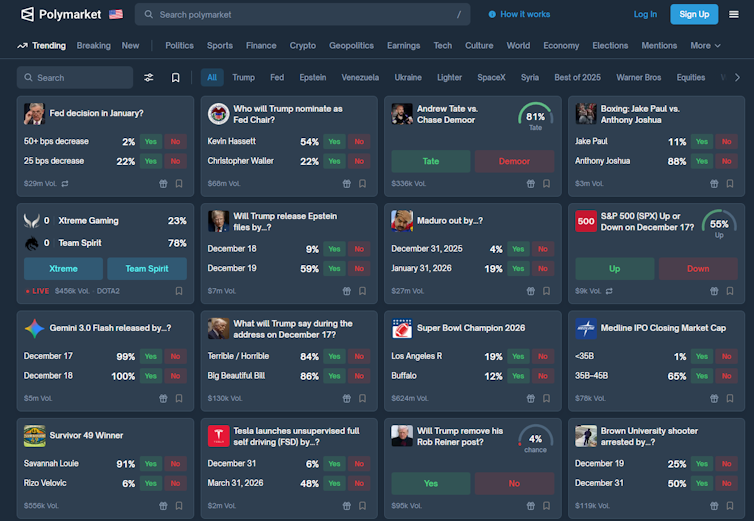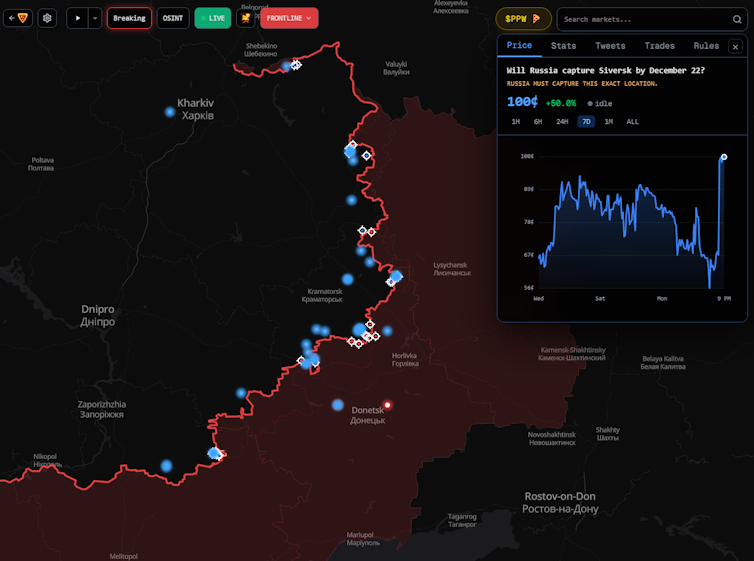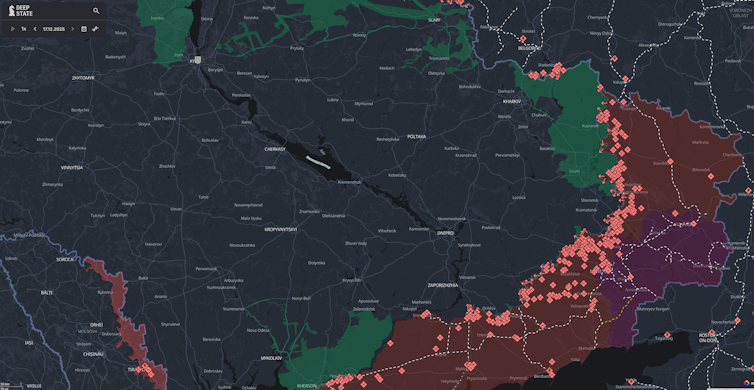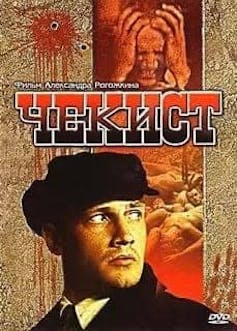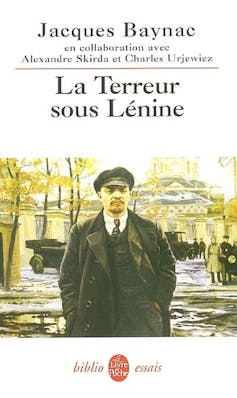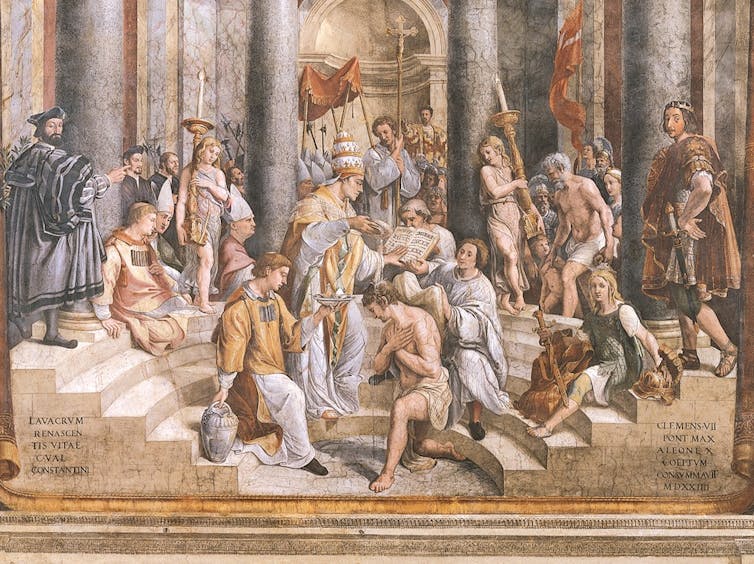Source: The Conversation – France (in French) – By Yangang Xing, Associate Professor, School of Architecture Design and the Built Environment, Nottingham Trent University
Et si le confort thermique ne se résumait pas à chauffer plus, mais à chauffer mieux ? Des lits chauffants chinois aux kotatsu japonais, l’Asie a longtemps privilégié des solutions ciblées, sobres et durables face au froid.
Les matins d’hiver à Harbin, où l’air extérieur pouvait vous geler les cils, je me réveillais sur un lit de terre chaude. Harbin, où j’ai grandi, se situe dans le nord-est de la Chine. Les températures hivernales y descendent régulièrement jusqu’à −30 °C et, en janvier, même les journées les plus douces dépassent rarement −10 °C. Avec environ 6 millions d’habitants aujourd’hui, Harbin est de loin la plus grande ville du monde à connaître un froid aussi constant.
Rester au chaud sous de telles températures m’a occupé l’esprit toute ma vie. Bien avant la climatisation électrique et le chauffage urbain, les habitants de la région survivaient à des hivers rigoureux en utilisant des méthodes entièrement différentes des radiateurs et des chaudières à gaz qui dominent de nos jours les foyers européens.
Aujourd’hui, en tant que chercheur en architecture dans une université britannique, je suis frappé par tout ce que nous pourrions apprendre de ces systèmes traditionnels. Les factures d’énergie restent trop élevées et des millions de personnes peinent à chauffer leur logement, tandis que le changement climatique devrait rendre les hivers plus instables. Nous avons besoin de moyens efficaces et peu énergivores pour rester au chaud, sans dépendre du chauffage de l’ensemble d’un logement à l’aide de combustibles fossiles.
Certaines des réponses se trouvent peut-être dans les méthodes avec lesquelles j’ai grandi.
Un lit chaud fait de terre
Mes premiers souvenirs de l’hiver sont liés au fait de me réveiller sur un « kang » – une plateforme-lit chauffée faite de briques de terre, utilisée dans le nord de la Chine depuis au moins 2 000 ans. Le kang est moins un meuble qu’un élément du bâtiment lui-même : une dalle épaisse et surélevée, reliée au poêle familial situé dans la cuisine. Lorsque le poêle est allumé pour cuisiner, l’air chaud circule dans des conduits aménagés sous le kang, réchauffant l’ensemble de sa masse.

Google Gemini, CC BY-SA
Pour un enfant, le kang avait quelque chose de magique : une surface chaude et rayonnante qui restait tiède toute la nuit. Mais à l’âge adulte – et aujourd’hui en tant que chercheur – je peux mesurer à quel point il s’agit d’une pièce d’ingénierie remarquablement efficace.
Contrairement au chauffage central, qui fonctionne en réchauffant l’air de chaque pièce, seul le kang (c’est-à-dire la surface du lit) est chauffé. La pièce elle-même peut être froide, mais les personnes se réchauffent en s’allongeant ou en s’asseyant sur la plateforme, sous d’épaisses couvertures. Une fois chauffée, sa masse de plusieurs centaines de kilogrammes de terre compactée restitue lentement la chaleur pendant de longues heures. Il n’y avait pas de radiateurs, pas besoin de pompes, et nous ne chauffions pas inutilement des pièces inoccupées. Comme une grande partie de la chaleur initiale était produite par des feux nécessaires de toute façon pour cuisiner, nous économisions du combustible.
L’entretien du kang était une affaire familiale. Mon père – professeur de littérature chinoise au collège, pas vraiment un ingénieur – est devenu un expert du kang. Empiler avec soin des couches de charbon autour du foyer afin de maintenir le feu toute la nuit relevait du travail de ma mère. Avec le recul, je mesure l’ampleur des compétences et du travail que cela exigeait, ainsi que la confiance que les familles accordaient à un système nécessitant une bonne ventilation pour éviter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.
Mais malgré tous ses inconvénients, le kang offrait quelque chose que les systèmes de chauffage modernes peinent encore à fournir : une chaleur durable avec très peu de combustible.
Des approches similaires en Asie de l’Est
Dans toute l’Asie de l’Est, les manières de se réchauffer par temps froid ont évolué autour de principes similaires : maintenir la chaleur près du corps et ne chauffer que les espaces qui comptent vraiment.
En Corée, l’ancien système ondol fait également circuler de l’air chaud sous des sols épais, transformant toute la surface du sol en plancher chauffant. Le Japon a développé le kotatsu, une table basse recouverte d’une lourde couverture, avec un petit dispositif chauffant placé en dessous pour garder les jambes au chaud. Ils peuvent être un peu coûteux, mais comptent parmi les objets les plus populaires dans les foyers japonais.
Les vêtements étaient eux aussi très importants. Chaque hiver, ma mère me confectionnait un tout nouveau manteau épais et matelassé, qu’elle garnissait de coton fraîchement cardé. C’est l’un de mes souvenirs les plus tendres.
L’Europe avait des idées similaires – puis les a oubliées
Des approches comparables se sont jadis développées en Europe. Les Romains de l’Antiquité, par exemple, chauffaient les bâtiments grâce à des hypocaustes, qui faisaient circuler l’air chaud sous les sols. Au Moyen Âge, les foyers suspendaient de lourdes tapisseries aux murs pour réduire les courants d’air, et de nombreuses cultures utilisaient des coussins moelleux, des tapis chauffés ou des espaces de couchage clos afin de conserver la chaleur.
La généralisation du chauffage central moderne au XXe siècle a remplacé ces pratiques par un modèle plus énergivore : chauffer des bâtiments entiers à une température uniforme, même lorsqu’une seule personne est présente au domicile. Tant que l’énergie était bon marché, ce modèle fonctionnait, malgré le fait que la plupart des logements européens (notamment en France, NDT) soient mal isolés au regard des standards internationaux.
Mais aujourd’hui, alors que l’énergie est redevenue chère, des dizaines de millions d’Européens ne parviennent pas à chauffer correctement leur logement. De nouvelles technologies comme les pompes à chaleur et les énergies renouvelables aideront – mais elles fonctionnent d’autant mieux que les bâtiments qu’elles chauffent sont déjà performants, ce qui permet de fixer des consignes de chauffage plus basses et des consignes de refroidissement plus élevées.
Les approches traditionnelles du chauffage domestique ont donc encore beaucoup à nous apprendre. Le kang et les systèmes similaires démontrent que le confort ne vient pas toujours d’une consommation accrue d’énergie, mais d’une conception plus intelligente de la chaleur.
![]()
Yangang Xing ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Pas de chauffage central mais des lits chauffés… Ce que la ville la plus froide du monde nous enseigne – https://theconversation.com/pas-de-chauffage-central-mais-des-lits-chauffes-ce-que-la-ville-la-plus-froide-du-monde-nous-enseigne-272640