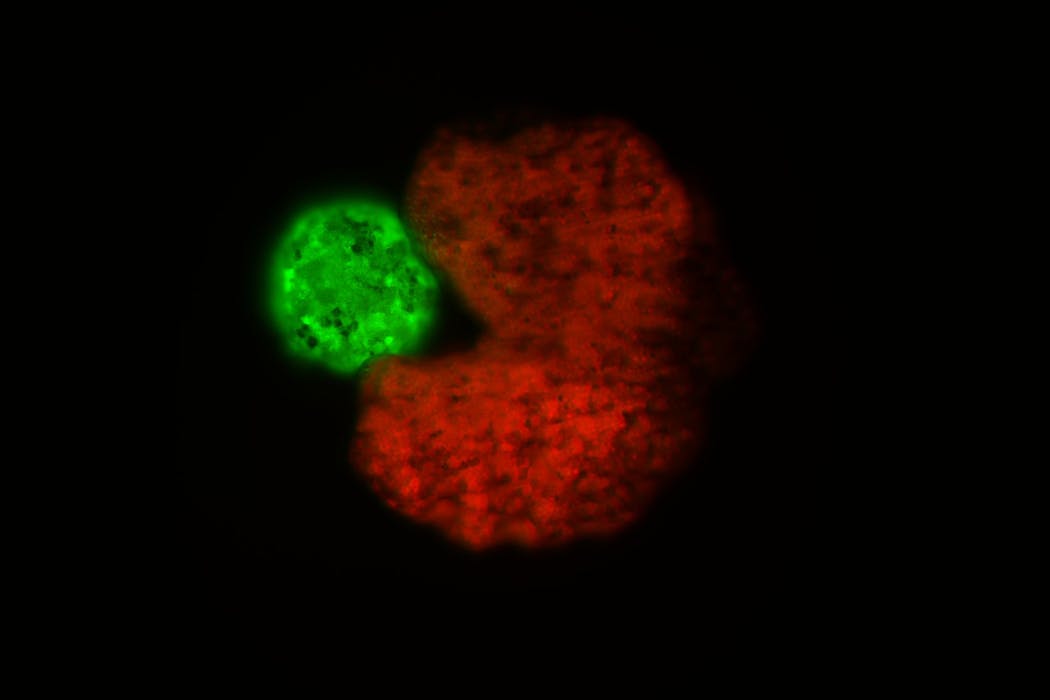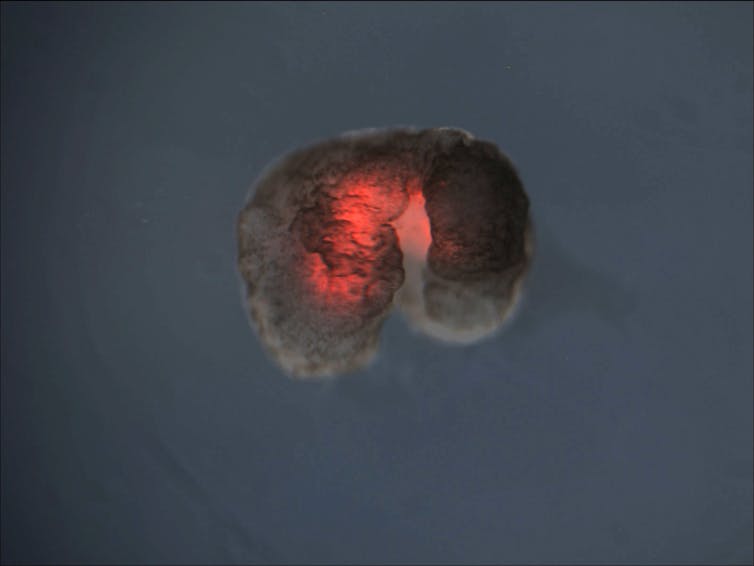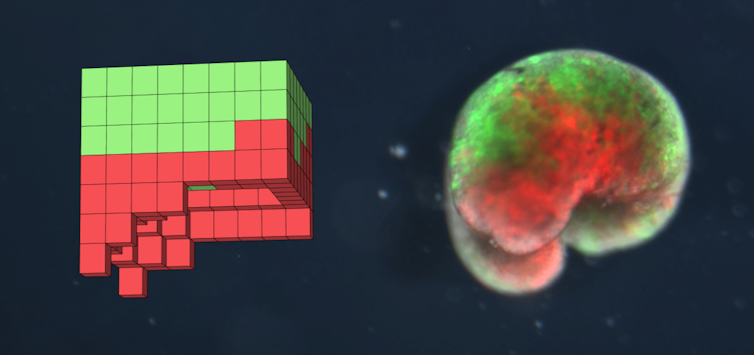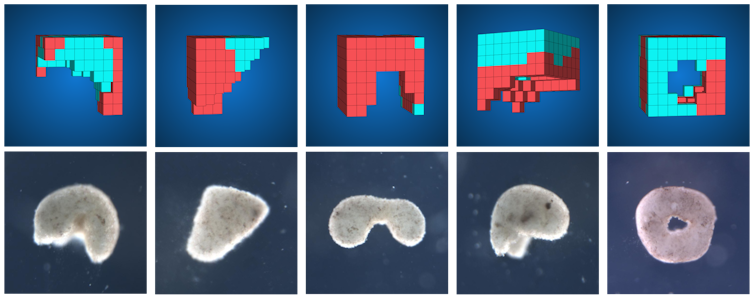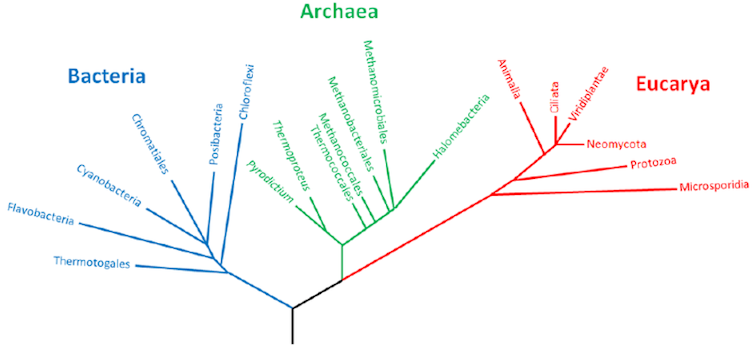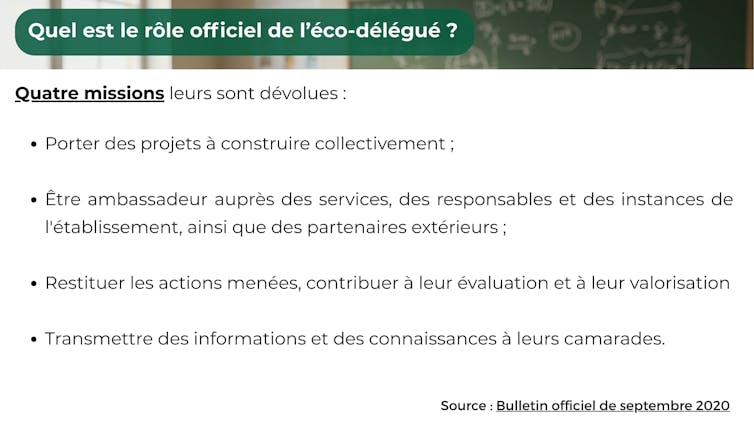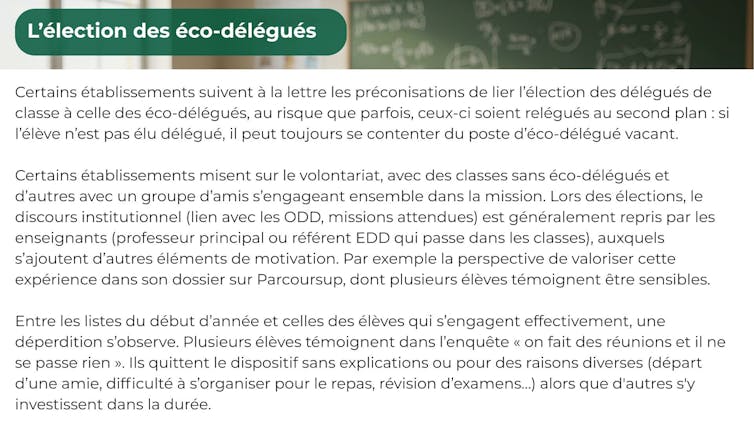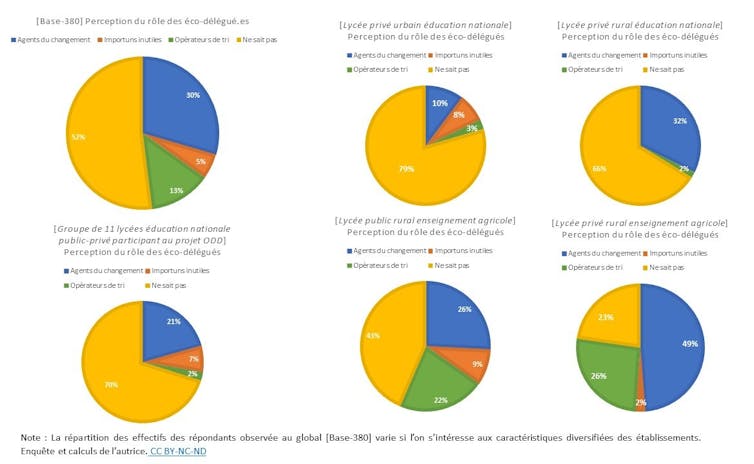Source: The Conversation – France in French (3) – By Alexandre Guigue, Professeur de droit public, Université Savoie Mont Blanc
L’échec de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2026 place le gouvernement face à un choix délicat. Le premier ministre entend déposer un projet de loi spéciale, comme en décembre 2024, après le renversement du gouvernement de Michel Barnier. Ce choix soulève d’importantes questions de conformité constitutionnelle et de portée juridique. Décryptage.
Après l’échec de la commission mixte paritaire (CMP), vendredi 19 décembre, qui n’est pas parvenue à proposer un texte de compromis, le premier ministre se retrouvait avec trois options : donner le dernier mot à l’Assemblée nationale et tenter de forcer l’adoption par l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, attendre l’expiration du délai de soixante-dix jours pour mettre en œuvre le projet de loi de finances (PLF) par ordonnance, ou déposer un projet de loi spéciale. C’est cette dernière voie qui a été choisie. Pourquoi ? Et est-ce conforme au droit ?
Les trois options qui s’offraient au premier ministre
L’option de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution
Cette option pouvait être écartée assez facilement. D’abord, le premier ministre Sébastien Lecornu l’avait lui-même écartée en début de procédure. Ensuite, c’est une voie très risquée. C’est celle qui a fait chuter le gouvernement de Michel Barnier, le 4 décembre 2024, sur l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Certes, contrairement à Michel Barnier, Sébastien Lecornu est parvenu à obtenir le vote du PLFSS 2026. Mais, au regard des débats tendus sur le projet de loi de finances, le premier ministre prendrait un très grand risque en recourant à cette procédure. De toute façon, en cas de renversement, il aurait été contraint, en tant que premier ministre démissionnaire, de procéder exactement comme l’a fait Michel Barnier en décembre 2024, c’est-à-dire de déposer un projet de loi spéciale.
L’option d’une mise en œuvre du projet par ordonnance
L’article 47 alinéa 3 de la Constitution prévoit que « si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance ». Le PLF a été déposé à l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025. La fin de la période de soixante-dix jours calendaires est le 23 décembre, à minuit. En conséquence, si le Parlement « ne s’est pas prononcé », et seulement dans ce cas (ce qui exclut un rejet du PLF), le gouvernement peut se passer du Parlement complètement. Cela signifie que l’État fonctionnerait en 2026 sur la seule base du projet initial du gouvernement, en retenant éventuellement les amendements votés par les deux assemblées (ce point a prêté à discussion entre spécialistes. A priori, rien n’empêche le gouvernement d’admettre des amendements votés par les deux assemblées).
La possibilité d’une mise en œuvre par ordonnance dépend donc de deux conditions : l’écoulement du délai de soixante-dix jours et l’absence de rejet définitif par l’Assemblée nationale.
Cependant, comme pour l’article 49 alinéa 3, Sébastien Lecornu a annoncé qu’il n’aurait pas recours aux ordonnances. Cette position, qui peut être critiquée dans la mesure où un premier ministre se prive ainsi de pouvoirs que la Constitution lui donne, a une certaine logique, puisque les deux procédures s’apparentent à un passage en force. En effet, dans les deux cas, le PLF est mis en œuvre sans vote formel du Parlement. Dans le premier, il est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée ; dans le second, le PLF est mis en œuvre par ordonnance sans que le Parlement n’ait pu se prononcer.
Sébastien Lecornu privilégie donc la concertation et l’approbation du Parlement, en excluant tout passage en force. Le vote positif du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) le conforte dans cette direction. Après l’échec de la commission mixte paritaire, le premier ministre choisit donc de déposer un projet de loi spéciale.
L’option de la loi spéciale
Sans l’épisode mouvementé de 2024, cette option paraîtrait extraordinaire puisque deux situations seulement avaient donné lieu à des lois de finances spéciales.
En 1962, après le renversement de son gouvernement, le premier ministre Georges Pompidou avait fait adopter, le 22 décembre 1962, un projet de loi de finances partiel comportant la seule première partie du PLF. Un autre projet de loi de finances spéciale comportant la deuxième partie avait été adopté le 26 janvier 1963.
La deuxième situation s’est produite en 1979. Par une décision du 24 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a invalidé le PLF 1980 pourtant adopté par le Parlement. Pris au dépourvu, le gouvernement s’est alors inspiré des textes existants en faisant adopter une loi spéciale, le 27 décembre 1979. Saisi une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel avait validé ce choix en constatant que, comme les textes n’avaient pas prévu cette situation, « il appartenait, de toute évidence, au Parlement et au gouvernement, dans la sphère de leurs compétences respectives, de prendre toutes les mesures d’ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ; qu’ils devaient, pour ce faire, s’inspirer des règles prévues, en cas de dépôt tardif du projet de loi de finances, par la Constitution et par l’ordonnance portant loi organique, en ce qui concerne tant les ressources que la répartition des crédits et des autorisations relatifs aux services votés » (décision du 29 décembre 1979).
En 2024, après le renversement du gouvernement Barnier, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé le dépôt d’un projet de loi de finances spéciale. Après un vote à l’unanimité par les députés et les sénateurs, la loi spéciale a été promulguée onze jours avant la fin de l’année (20 décembre 2024).
En décembre 2025, si la situation est comparable, elle présente tout de même quelques différences.
Les conditions sont-elles remplies pour le dépôt d’un projet de loi de finances spéciale ?
L’article 47 de la Constitution et l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) posent chacun une condition pour une loi de finances spéciale. Aucune des deux n’est remplie par Sébastien Lecornu.
La condition de l’absence de dépôt « en temps utile » du PLF
L’article 47 alinéa 4 de la Constitution, qui prévoit la possibilité d’une loi de finances spéciale, pose la condition de l’absence d’un dépôt « en temps utile de la loi de finances pour être promulguée avant le début de l’exercice » (le 1er janvier 2026). Cela renvoie à la situation dans laquelle le PLF a été déposé avec un retard tel que le Parlement n’a pas pu disposer du temps d’examen prévu par la Constitution, c’est-à-dire soixante-dix jours. Or, si Sébastien Lecornu a déposé le PLF en retard, le 14 octobre 2025, le Parlement a bien, théoriquement, disposé de soixante-dix jours calendaires, le délai s’achevant le 23 décembre à minuit. En conséquence, la condition n’est pas remplie pour déposer un projet de loi spéciale
(ce point a été confirmé par le rapporteur de la commission des finances de l’Assemblée nationale dans son rapport sur le projet de loi spécial de 2024).
Qu’à cela ne tienne, le premier ministre le fera quand même, comme Michel Barnier en décembre 2024. Cette petite entorse de la Constitution semble implicitement assumée par le gouvernement. Il faut dire que, pour respecter la lettre du texte, le premier ministre devrait retirer le PLF qui est à l’Assemblée, en redéposer un autre, constater que le dépôt n’a pas été fait en temps utile et déposer un projet de loi spécial. En 2024, Michel Barnier ne le pouvait pas, car étant démissionnaire, il n’en avait pas le pouvoir. En 2025, Sébastien Lecornu en a le pouvoir, mais le temps presse et, surtout, cela revient au même.
La condition d’un dépôt du projet de loi spéciale avant le 19 décembre
L’article 45 de la LOLF prévoit que le projet de loi de finances spéciale doit être déposé avant le 19 décembre. Or, l’échec de la commission mixte paritaire est intervenu le 19 décembre, justement. Pour déposer un projet de loi spéciale, le gouvernement doit d’abord recueillir l’avis du Conseil d’État puis l’arrêter en Conseil des ministres.
Sébastien Lecornu, même en allant très vite, n’est pas en mesure de respecter ce délai. Le dépôt intervient donc avec quelques jours de retard. Est-ce problématique ? La LOLF n’est pas respectée, mais de peu. Ce n’est problématique que si le Conseil constitutionnel est saisi et que s’il applique strictement la règle du 19 décembre. Il y a des raisons pour le premier ministre de ne pas être inquiet. En décembre 2024, le projet de loi spéciale avait été adopté à l’unanimité et le Conseil n’avait pas été saisi.
Même si le Conseil est saisi en 2025, il est fort probable qu’au regard de sa jurisprudence antérieure il considère que le premier ministre a bien tout mis en œuvre pour assurer la continuité de la vie nationale et, par surcroît, avec l’aval du Parlement.
Le contenu de la loi spéciale
En 1979, le gouvernement s’était contenté de prévoir le strict minimum prévu par l’article 47 alinéa 4 de la Constitution, c’est-à-dire la perception des impôts existants. En décembre 2025, le gouvernement s’est montré plus audacieux.
Partant du principe que la Constitution se contente de prévoir ce contenu obligatoire, il a considéré que d’autres dispositions pouvaient être ajoutées. Le Conseil d’État a confirmé cette lecture dans son avis sur le projet de loi spéciale de 2024. La loi spéciale de 2024 comportait quatre articles. Le premier portait sur la perception des impôts existants. Le deuxième prévoyait le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales. Le troisième portait autorisation pour le gouvernement d’emprunter. Le quatrième a permis aux organismes de sécurité sociale de percevoir leurs ressources non permanentes.
En 2025, le gouvernement est parvenu à faire adopter le PLFSS. Par conséquent, il n’a pas besoin de prévoir le quatrième article. Comme il n’y a pas de raison qu’il en prévoit d’autres, le projet comportera sans doute les trois premiers articles.
Le Parlement devrait rapidement voter le projet de loi spéciale. Si, comme en 2024, il le fait à l’unanimité, il n’y aura vraisemblablement pas de saisine du Conseil constitutionnel.
Le 1er janvier 2026, le gouvernement fonctionnera avec le minimum, comme début 2025. Il restera alors à faire à adopter par le Parlement un PLF complet. François Bayrou y était parvenu, le 5 février 2025. La voie du compromis choisie par Sébastien Lecornu lui permettra-t-elle de le faire comme ce fut le cas pour le PLFSS ?
![]()
Alexandre Guigue est membre de membre de la Société française de finances publiques, association reconnue d’utilité publique réunissant universitaires et praticiens des finances publiques.
– ref. Budget 2026 : les conséquences de l’échec de la commission mixte paritaire et du choix de la loi spéciale – https://theconversation.com/budget-2026-les-consequences-de-lechec-de-la-commission-mixte-paritaire-et-du-choix-de-la-loi-speciale-272501