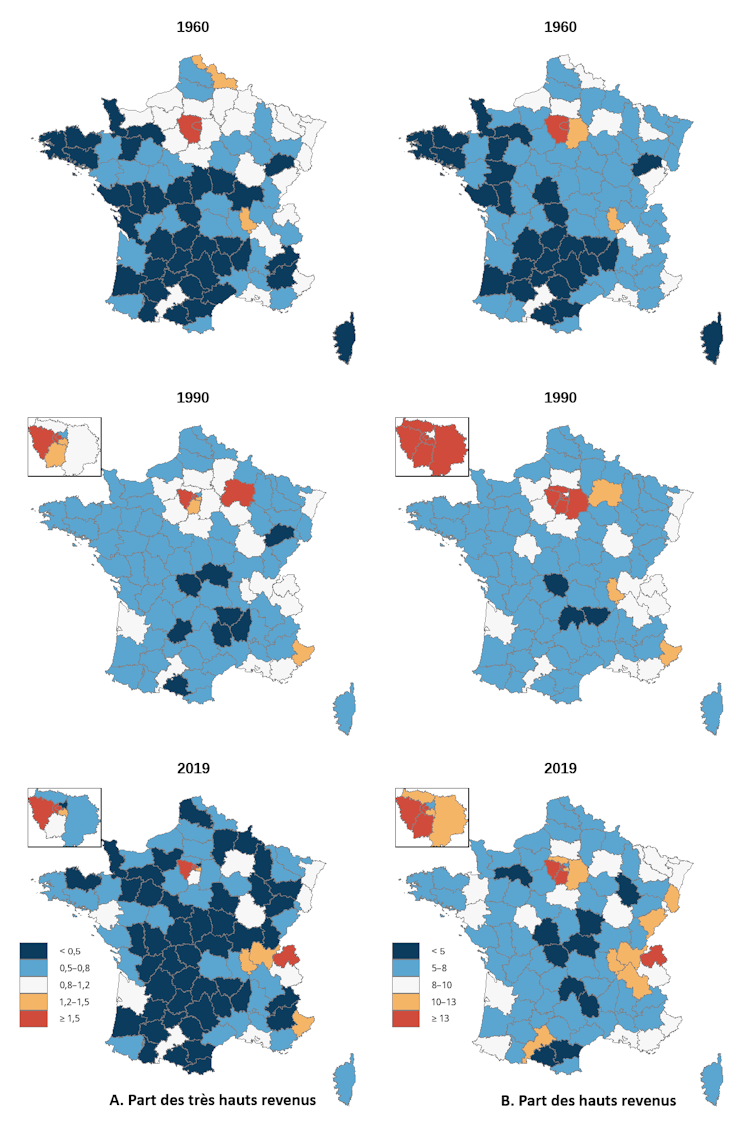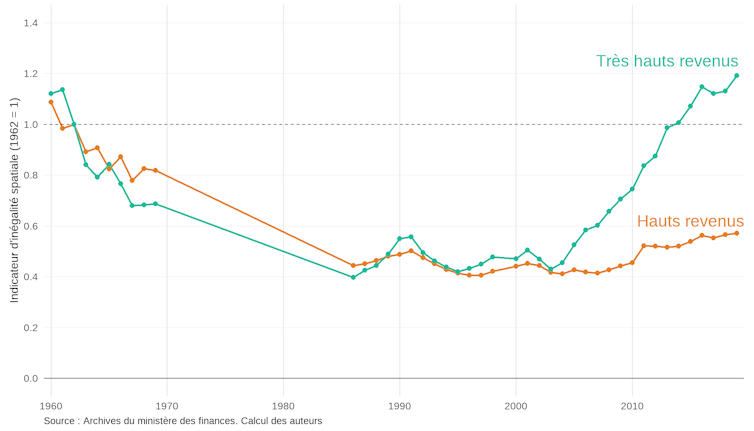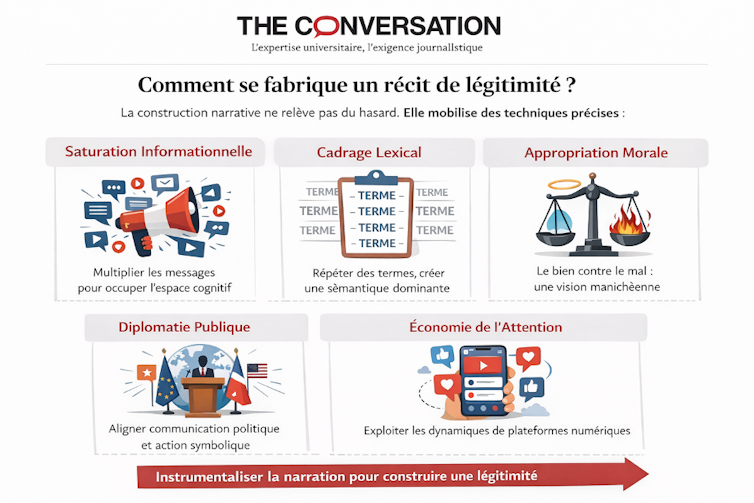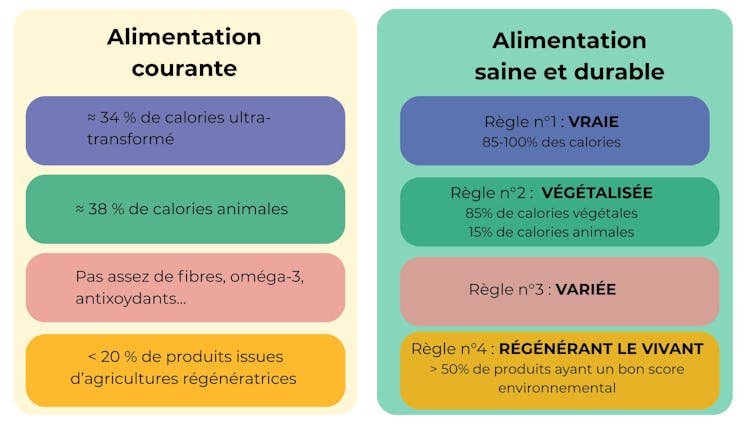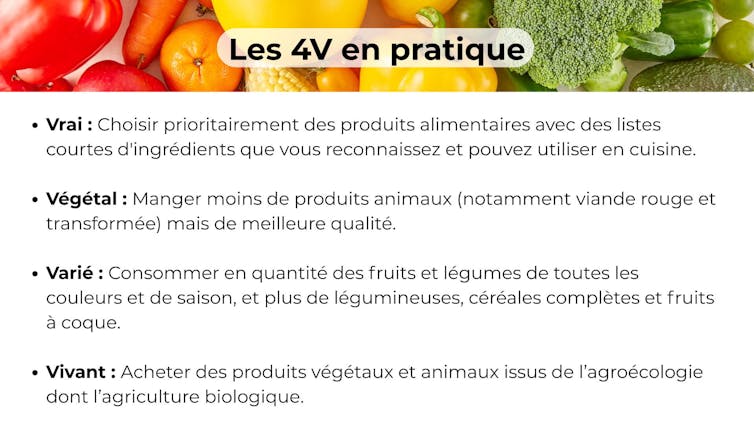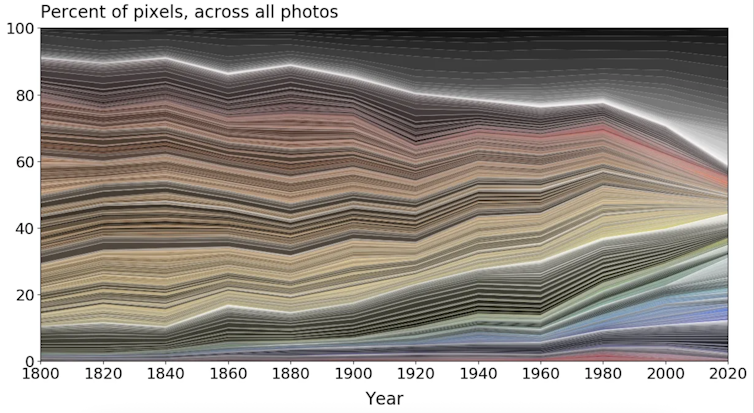Source: The Conversation – in French – By Benoît Vieille, Professeur en mécanique des matériaux aéronautiques, INSA Rouen Normandie
Qu’il s’agisse de pièces de fusée, d’automobile, de pont ou même d’aliments, la fabrication additive (FA) redéfinit complètement le champ des possibles dans de très nombreux domaines d’activités. Elle offre des perspectives prometteuses en matière de matériaux, mais elle pose également des défis techniques, économiques et environnementaux qui nécessitent une maturation et une adaptation des procédés en lien avec les matériaux utilisés.
Plus connu sous la dénomination « impression 3D », ce procédé met en œuvre des polymères (plastiques) ou des alliages métalliques pour fabriquer des objets du quotidien. Les imprimantes 3D polymères sont accessibles au grand public pour quelques centaines d’euros. Elles permettent notamment de fabriquer des pièces prototypes (d’où le nom prototypage rapide), des coques de téléphone, des pièces de rechange, des prothèses, des bijoux, des jouets, des objets de décorations ou des maquettes. En ce qui concerne les métaux, les machines d’impression sont beaucoup plus chères (quelques centaines de milliers d’euros). On trouve des applications telles que des implants médicaux, des pièces aérospatiales/automobiles, de l’outillage industriel, des bijoux de luxe. On peut également trouver ce principe de fabrication dans le domaine du BTP avec des « imprimantes » qui mettent en œuvre du béton pour fabriquer des maisons, des bâtiments ou tout type de structure en génie civil.
Mais, comme toute nouveauté, le procédé suscite autant d’espoir qu’il ne réserve de surprises (bonnes ou mauvaises) à celles et ceux qui souhaitent utiliser ce nouveau moyen de fabrication.
D’un point de vue technique, l’impression 3D consiste, couche après couche, à durcir (polymériser) une résine liquide ou à venir déposer de la matière (plastique ou métallique) de manière précise et contrôlée (en ajustant les paramètres tels que la température, la vitesse d’impression, le taux de remplissage, l’orientation de l’objet) pour répondre à certaines contraintes de géométrie, poids, optimisation des propriétés mécaniques ou physiques.
La microstructure d’une pièce imprimée en 3D (polymère ou métal) désigne l’organisation interne de sa matière à une échelle microscopique, influencée par le procédé d’impression. La complexité de la géométrie, les dimensions, le prix vont conditionner le choix de la technologie d’impression et des matériaux associés.
Une révolution dans de nombreux domaines industriels
Qu’elle soit alternative ou complémentaire des techniques conventionnelles par enlèvement de matière ou par déformation, la FA révolutionne de nombreux domaines industriels. De la réalisation de pièces monolithiques (en une seule étape de fabrication, sans assemblage) à forte valeur ajoutée à la fonctionnalisation (conférer à la pièce certaines propriétés locales en changeant les paramètres d’impression au besoin), en passant par le prototypage rapide (valider la conception d’une pièce prototype de manière itérative), les possibilités sont multiples. On peut citer notamment des prothèses de hanche en titane adaptées à l’anatomie de chaque patient, des injecteurs de fusée à géométrie complexe et fabriquées en une seule pièce, des moules optimisés avec canaux de refroidissement sur mesure, des bijoux en métaux précieux avec des designs impossibles à obtenir avec des moyens d’usinage conventionnels.
La chaîne de valeurs de la FA – qui définit l’ensemble des étapes de réalisation d’une pièce de l’approvisionnement en matière première, à la conception, aux conditions de mise en œuvre, à la fabrication, au coût énergétique, à la reprise d’usinage, aux opérations de parachèvement, à la qualification de la santé matière, à la caractérisation des propriétés physiques, au recyclage – est cependant plus complexe et potentiellement plus onéreuse. La technicité, oui, mais pas à n’importe quel prix ! Outre les moyens de fabrication spécifiques sur lesquels elle repose, elle nécessite des règles de conception fondamentalement différentes car elle impose de nouvelles contraintes techniques. De la Conception Assistée par Ordinateur, au choix matériau, au programme machine et à l’industrialisation, il faut ainsi redéfinir complètement la manière de penser du cahier des charges à la maintenance des produits issus de la FA.
Des enjeux majeurs pour les matériaux
Un des points fondamentaux du développement de ces nouveaux procédés réside dans la compréhension du lien entre les paramètres de fabrication des pièces (temps d’impression, puissance du laser, vitesse de déplacement de la tête d’impression, dimensions, environnement de travail – sous atmosphère contrôlée ou non), leur santé matière (présence de porosités ou de défauts parfois liés à un manque de fusion/gazéification locaux de la matière) et leurs propriétés physiques (conductivité thermique ou électrique, propriétés mécaniques, densité). Autrement dit, il est nécessaire de fiabiliser les procédés et optimiser les propriétés finales de la pièce en étant capable de contrôler des paramètres de fabrication, lesquels vont beaucoup dépendre des matériaux mis en œuvre. Ainsi, la FA présente des enjeux majeurs pour les matériaux, qu’ils soient techniques, économiques ou environnementaux.
Tout d’abord, les procédés de FA nécessitent de développer, en amont, des matériaux adaptés (filaments, poudres) aux spécificités des procédés (fusion laser, dépôt de matière fondue, alimentation en matière des têtes d’impression), lesquels vont imposer des contraintes en termes de prix, toxicité et recyclabilité. En effet, les poudres métalliques ou polymères spécifiques (de type thermoplastique) dédiées à la fabrication additive restent souvent plus coûteuses que les matériaux conventionnels, d’un facteur 10 environ.
Néanmoins, malgré le coût plus élevé des matériaux et des procédés, l’impression 3D réduit les déchets (pas de copeaux comme en usinage), permet de fabriquer des pièces dont la géométrie est optimisée (allègement des structures) et élimine le besoin de moules coûteux pour les petites séries, ce qui peut compenser l’écart de coût pour des pièces à forte valeur ajoutée. Ainsi, la réduction des coûts est un enjeu clé pour une adoption plus large. De plus, l’approvisionnement en matière première peut être limité, ce qui ralentit le développement des applications industrielles.
La FA permet également de faire de l’hybridation en associant différents types de matériaux lors de l’impression (en utilisant plusieurs têtes d’impression) afin d’obtenir des pièces composites dont les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques sont spécifiques. Par exemple, dans l’industrie aérospatiale ou l’automobile, l’impression 3D de pièces comme des moules d’injection ou des échangeurs thermiques avec des canaux de refroidissement complexes intégrés – lesquels sont impossibles à réaliser par usinage classique – permettent d’optimiser la dissipation thermique, améliorant l’efficacité et la longévité de la pièce.
Les procédés de FA permettent également d’imprimer des structures arborescentes (bio-mimétisme) obtenues via des outils d’optimisation topologique qui est une méthode de conception avancée qui utilise des algorithmes pour déterminer la forme optimale d’une structure en fonction de contraintes spécifiques, telles que la résistance, le poids, ou la distribution des efforts. La spécificité de l’impression 3D réside aussi dans la possibilité de produire des structures complexes de type treillis ou architecturées pour fonctionnaliser le matériau (propriétés mécaniques sur mesure, réduction de la masse, diminution des coûts de fabrication, isolation thermique, acoustique, absorption des chocs ou des vibrations).
Fusion de matière
Quand les pièces sont imprimées, il existe – selon le procédé de fabrication – des opérations dites de parachèvement qui consistent à finaliser les pièces. Cela inclut l’usinage des supports de conformage (qui sont comme des échafaudages qui supportent la pièce lors de la fabrication couche par couche), la reprise d’usinage des surfaces (ou polissage) pour améliorer l’état de surface (quand cela est possible) en raison de la rugosité importante des pièces brutes. On peut également réaliser des traitements thermiques pour homogénéiser la microstructure (pièces métalliques) ou de compression à chaud pour limiter le taux de porosités (un des inconvénients majeurs de l’impression 3D). Ces opérations sont fondamentales, car la rugosité de surface et le taux de porosités sont les caractéristiques les plus critiques du point de vue du comportement mécanique. Par ailleurs, quand il s’agit de procédés à base de poudres, il est nécessaire de dépoudrer les pièces pour évacuer le surplus de matière, lequel peut nuire au fonctionnement en service de la pièce ainsi fabriquée.
Par nature, la majorité des procédés de FA impliquent la fusion de matière (plastique ou métallique), ce qui va se traduire par des échauffements localisés et des différences de température très importants au sein de la pièce. Ces gradients thermiques vont conditionner la microstructure, la présence de contraintes internes (en lien avec la microstructure), la santé (présence de défauts), l’anisotropie (les propriétés ne sont pas les mêmes dans toutes les directions) et l’hétérogénéité (les propriétés ne sont pas les mêmes en tout point) des pièces. La fiabilité des pièces imprimées va donc beaucoup dépendre de ces caractéristiques.
En amont, il est alors important d’étudier les interactions entre procédés-microstructure et propriétés mécaniques pour différents types de matériaux. C’est l’objet de nos travaux de recherche menés à l’INSA Rouen Normandie. Pour les polymères, l’impression 3D par dépôt de filament fondu (FFF) présente une porosité intrinsèque qui réduit la résistance à la rupture. En utilisant des procédés tels que le laser shock peening (LSP), un traitement mécanique in situ appliqué à certaines couches pendant l’impression, on peut alors faire de la fonctionnalisation en réduisant localement la porosité et en créant des barrières ralentissant la propagation des fissures, améliorant ainsi la ténacité des matériaux (la résistance à la fissuration du matériau). De manière similaire, pour les alliages métalliques obtenus par Fusion sur Lit de Poudre, en jouant sur les paramètres de fabrication (puissance et vitesse de déplacement du laser notamment), il est possible d’ajuster localement les propriétés du matériau pour moduler sa ténacité ou sa capacité à se déformer plastiquement.*
Aussi, il est nécessaire de caractériser précisément – en aval de la fabrication – les propriétés (thermiques, électriques, mécaniques) des pièces en accord avec les normes de certification propres aux différents domaines d’activité (médical, aéronautique, aérospatiale, automobile, agro-alimentaire).
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. L’avenir de l’impression 3D passera par les matériaux – https://theconversation.com/lavenir-de-limpression-3d-passera-par-les-materiaux-258652