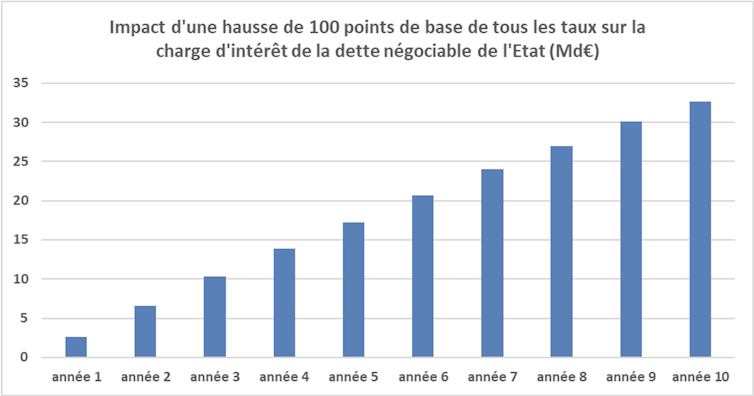Source: The Conversation – in French – By Marie-Hélène Beauséjour, Profeseure adjointe, École de technologie supérieure (ÉTS)

Lors d’accidents ou de chutes, les blessures au niveau de la colonne vertébrale sont fréquentes, notamment chez les personnes âgées, plus vulnérables.
Les lésions traumatiques de la moelle épinière peuvent nuire considérablement à la qualité de vie des personnes touchées et engendrer des conséquences importantes sur le plan sociétal et économique : au Canada, les soins aux victimes de traumatismes de la moelle épinière impliquant des conséquences sur le plan neurologique coûtent entre 1,47 M$ et 3,03 M$ par personne.
Cet article fait partie de notre série La Révolution grise. La Conversation vous propose d’analyser sous toutes ses facettes l’impact du vieillissement de l’imposante cohorte des boomers sur notre société, qu’ils transforment depuis leur venue au monde. Manières de se loger, de travailler, de consommer la culture, de s’alimenter, de voyager, de se soigner, de vivre… découvrez avec nous les bouleversements en cours, et à venir.
Or, les modèles numériques actuellement utilisés pour évaluer ces blessures ne sont pas adaptés aux caractéristiques des personnes âgées ou des femmes. Les modèles de ces groupes cibles sont généralement de simples mises à l’échelle réalisées à partir de modèles masculins qui ne permettent pas une compréhension approfondie des mécanismes derrière les traumatismes. De plus, ces données proviennent surtout du milieu sportif et de l’armée. Elles sont donc basées surtout sur des hommes jeunes et en bonne santé. Il y a un grand besoin d’en savoir davantage sur les femmes et les personnes âgées.

(Unsplash+), CC BY
Afin de mieux comprendre ces traumatismes et la manière de les prévenir, notre équipe de recherche à l’ÉTS élabore des modèles numériques davantage adaptés aux corps plus vulnérables.
Créer des modèles adaptés
Pour y arriver, nous nous appuyons sur la modélisation par éléments finis (MEF), c’est-à-dire sur des modèles numériques qui sont en fait des copies virtuelles ou jumeaux numériques de différents éléments du squelette ou des organes. L’accès à des corps humains étant plus difficile, cette méthode a l’avantage de reproduire les mécanismes de façon très fidèle, tout en facilitant les calculs.
Nous nous intéressons précisément à identifier la partie de l’os qui va briser, en tentant de déterminer dans quelles circonstances, avec quelle force et à quelle vitesse. Nous nous penchons tout particulièrement sur les ostéophytes spinaux. Ces excroissances situées au niveau des articulations sont notamment présentes chez les personnes âgées atteintes d’arthrose.
À l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal — où se trouve notre laboratoire — nous avons justement remarqué que beaucoup de victimes de traumatismes sont des personnes âgées qui ont fait une chute. Ces accidents, parfois en apparence banale, peuvent entraîner des troubles neurologiques. L’arthrose — donc les ostéophytes — peut avoir un impact sur le type et la localisation d’une blessure après un accident.
Actuellement, la science ne peut pas encore définir si ces déformations de la colonne vertébrale sont plutôt bénéfiques ou néfastes. Nous cherchons à identifier la composition des tissus de ces déformations, puis à réaliser des tests mécaniques afin de les intégrer aux modèles numériques.
D’autres facteurs qui influencent le type de traumatismes doivent aussi être pris en compte, comme la posture et la vitesse ou la trajectoire au moment de l’accident, mais aussi la densité osseuse ainsi que la musculature. Le disque intervertébral d’un jeune homme et d’une personne âgée ne réagit pas de la même façon, par exemple, ce qui rend cette dernière plus à risque d’avoir un accident.
Nous essayons donc de reproduire le modèle le plus fidèle à la personne entre autres en utilisant l’intelligence artificielle pour créer des modèles personnalisés. Une autre de nos approches est la création d’un catalogue de géométries typiques, soit 28 géométries ici. Cette stratégie est exploitable à la fois pour aider à la compréhension des traumatismes et pour concevoir des prothèses adaptées à chaque individu.
Vers une sécurité plus inclusive
Nos travaux sont utiles à la conception de meilleurs équipements de protection, notamment dans les voitures. Là encore, la plupart des études en matière de sécurité des femmes dans l’industrie de l’automobile sont basées sur la morphologie des hommes.
Nos systèmes de sécurité sont actuellement conçus pour une personne en parfaite santé. Pourtant, quand on construit un pont, nous établissons un certain critère de sécurité pour s’assurer qu’il ne s’effondre jamais. De la même manière, il faudrait d’abord penser à la personne la plus vulnérable qui conduira la voiture.
Lors d’un accident de la route, les femmes ont de 47 % à 71 % plus de risques de subir des blessures pour un même accident.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Cette donnée s’explique par une dégénérescence musculaire plus rapide avec la ménopause et une flexibilité plus grande à l’origine du fameux coup du lapin (une entorse cervicale). Le choix des matériaux et la conception de l’appuie-tête, par exemple, pourraient ainsi être faits en fonction de morphologies plus variées afin d’amortir le choc de manière personnalisée. Pour plusieurs équipements de protection, comme les protecteurs cervicaux, la relation entre la morphologie de la personne et les dimensions de l’équipement a un impact sur la sécurité, mais ceci n’est pas toujours pris en compte.
À terme, nous espérons que nos travaux permettront aussi de concevoir des outils et des traitements chirurgicaux plus adaptés aux femmes et aux personnes âgées. Les implications du programme de recherche sur lequel notre équipe de recherche travaille sont donc très étendues ; elles pourront contribuer à l’amélioration des stratégies de soins.
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Une nouvelle technologie pour mieux évaluer les blessures de la moelle épinière chez les femmes et les personnes âgées – https://theconversation.com/une-nouvelle-technologie-pour-mieux-evaluer-les-blessures-de-la-moelle-epiniere-chez-les-femmes-et-les-personnes-agees-250883