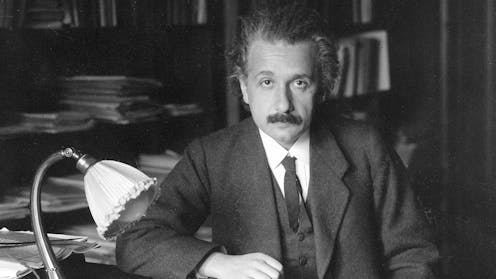Source: The Conversation – in French – By Hugo Spring-Ragain, Doctorant en économie / économie mathématique, Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS)
C’est vraisemblablement la mesure la plus discutée du plan de François Bayrou pour le budget 2026. L’annonce mi-juillet de la suppression de deux jours fériés – le lundi de Pâques et le 8-Mai – a été perçue de façon négative, au point que la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a demandé au premier ministre de revenir sur cette annonce. Mais qu’en est-il de l’impact réel de cette suppression annoncée ? L’économie y gagnerait-elle vraiment ? Dans quelle mesure, et à quel prix ?
La question revient de façon récurrente dans le débat public français : faut-il supprimer un ou plusieurs jours fériés pour relancer l’économie et améliorer la compétitivité ? L’idée, de nouveau, avancée par François Bayrou semble venue d’un raisonnement en apparence imparable : davantage de jours travaillés dans l’année équivaudraient à davantage de richesse produite, donc à plus de croissance et de recettes publiques.
Si cette perspective peut séduire par sa simplicité arithmétique, elle omet que la réalité économique est plus complexe. Les expériences menées en France comme à l’étranger montrent que l’effet est bien plus modeste que ne le laissent penser les annonces.
L’impact réel sur le produit intérieur brut (PIB) se mesure en centièmes de point, et les gains de productivité, essentiels à une croissance durable, sont quasiment inexistants. À l’inverse, les coûts sociaux et symboliques sont loin d’être anecdotiques. Supprimer des jours fériés contribue à l’effacement de repères collectifs, à la fragilisation de secteurs dépendant des temps de loisirs et peut produire de fortes contestations sociales.
À lire aussi :
Le projet de budget 2026 sous la menace d’un vote de défiance… et du FMI
Des conséquences économiques mineures
L’argument avancé en faveur de la suppression d’un ou deux jours fériés paraît simple : davantage de jours travaillés équivaudraient à davantage de production nationale. Les calculs officiels confirment en partie cette logique. En France, l’Insee) estime qu’un jour férié en semaine correspond à environ 1,5 milliard d’euros de production en moins, soit 0,06 point de PIB. Supprimer deux jours représenterait donc un gain proche de 3 milliards d’euros. Dans un pays dont le PIB annuel dépasse 3 200 milliards d’euros, l’effet est réel mais reste marginal.
Les comparaisons internationales vont dans le même sens. Au Danemark, la suppression, en 2023, du Store Bededag n’a ajouté que 0,01 à 0,06 % de PIB, selon le FMI. En Allemagne, l’institut IFO évalue l’effet à environ 8 milliards d’euros pour un jour ouvré supplémentaire, soit 0,2 % du PIB.
Deux effets à distinguer
Il faut cependant distinguer entre un effet de volume et un effet de productivité. Les travaux académiques récents, comme ceux de Rosso et Wagner, montrent qu’ajouter un jour ouvré accroît bien le PIB de l’année, mais sans impact mesurable sur la productivité horaire. On produit davantage parce qu’on travaille plus longtemps, et non parce que l’on travaille mieux.
Or la compétitivité des économies avancées repose avant tout sur la productivité horaire, qui dépend de l’innovation, de la formation et de l’organisation du travail. À cet égard, la France, malgré ses onze jours fériés, reste parmi les pays les plus performants de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), au même niveau que l’Allemagne et au-dessus du Royaume-Uni ou du Japon. Le nombre de jours chômés n’est donc pas un déterminant décisif.
Par ailleurs, les effets anticipés reposent sur l’hypothèse que les entreprises et les salariés utilisent pleinement ce supplément de travail. Or les comportements réels viennent nuancer cette projection. Certains salariés préfèrent poser des congés ou des RTT, les entreprises peuvent ne pas avoir suffisamment de demande pour justifier une production accrue, et les secteurs saisonniers n’en bénéficient pas de la même façon. L’impact mécanique est donc rarement atteint dans les faits, et les gains restent largement en deçà des promesses initiales.
Une question plus politique qu’économique
La suppression d’un jour férié touche à bien davantage que l’organisation comptable du calendrier. Elle interroge l’identité collective et la cohésion sociale. Les jours fériés incarnent des traditions religieuses, des commémorations civiques ou des symboles sociaux, comme le 1er -Mai. Ils représentent des repères partagés qui rythment l’année et structurent la mémoire nationale. Leur disparition suscite donc une opposition forte, car elle est perçue comme une remise en cause de ces éléments constitutifs de la vie collective.
Le cas français du lundi de Pentecôte illustre bien cette tension. Transformé par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, en 2004, en « journée de solidarité » pour financer la dépendance, il avait cessé d’être chômé. Face à une contestation importante, le dispositif a été assoupli et les entreprises ont pu aménager d’autres modalités.
Le rendement budgétaire demeure autour de 3 milliards d’euros par an, mais sans transformation durable de la trajectoire économique. L’épisode a surtout laissé l’image d’une réforme impopulaire pour un bénéfice limité, rappelant que la suppression d’un jour férié est d’abord une décision politique lourde, et non une mesure technique neutre.
Un capital social
Les recherches en sciences sociales soulignent également le rôle positif de ces journées. En Allemagne, Merz et Osberg ont montré que les jours fériés favorisent la coordination des temps sociaux, en permettant aux familles, aux amis ou aux associations de se retrouver simultanément. Ce capital social contribue au bien-être individuel et à la cohésion collective, et son effet économique est indirect mais réel.
Par ailleurs, certains secteurs bénéficient particulièrement des jours chômés : tourisme, hôtellerie, restauration, commerce de détail. Au Royaume-Uni, on estime que les jours fériés offrent aux petits commerces un « boost moyen » de 253 livres sterling de profits par jour, avec des hausses de ventes pouvant aller jusqu’à 15 % dans des secteurs comme le bricolage, le jardinage ou le mobilier.
La France dans la « bonne » moyenne ?
Enfin, les comparaisons internationales suggèrent qu’il existe un nombre optimal de jours fériés. Une étude portant sur une centaine de pays montre une relation en « U inversé » : jusqu’à un seuil situé autour de neuf à dix jours fériés par an, ils stimulent la croissance via la consommation et le repos. Au-delà, les interruptions deviennent de plus en plus coûteuses pour l’organisation productive. Avec ses onze jours fériés, la France se situe dans cette zone intermédiaire, proche de la moyenne européenne. Autrement dit, le pays n’a ni excès ni rareté, et toute suppression risquerait d’apporter peu économiquement tout en coûtant beaucoup socialement.
Au regard de ces éléments, la suppression d’un ou deux jours fériés apparaît moins comme une réforme économique de fond que comme une décision politique visant à dégager des recettes supplémentaires. Le gain de PIB est faible, limité et de nature ponctuelle, sans effet sur la productivité structurelle. En revanche, les pertes sociales et symboliques sont importantes, qu’il s’agisse de la mémoire nationale, de la cohésion sociale ou du dynamisme de secteurs dépendants des loisirs collectifs. L’expérience du lundi de Pentecôte l’a montré : la mesure se traduit avant tout par l’instauration de journées de solidarité déguisées, générant un effort supplémentaire des salariés sans véritable amélioration de la compétitivité.
![]()
Hugo Spring-Ragain ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Et si la suppression de deux jours fériés n’était pas justifiée économiquement ? – https://theconversation.com/et-si-la-suppression-de-deux-jours-feries-netait-pas-justifiee-economiquement-264387