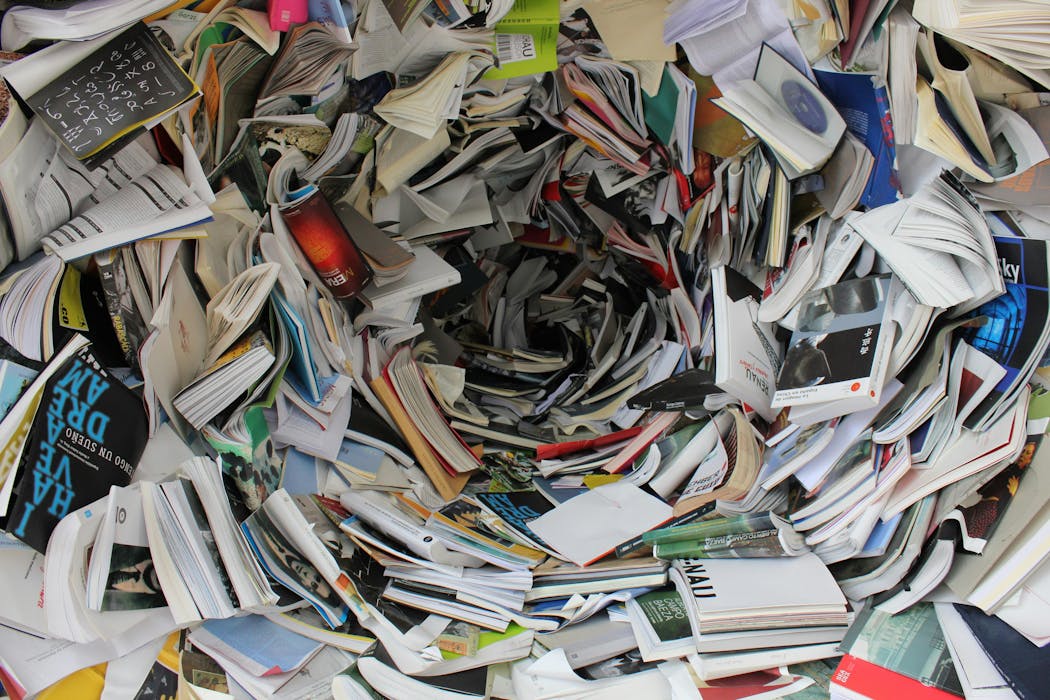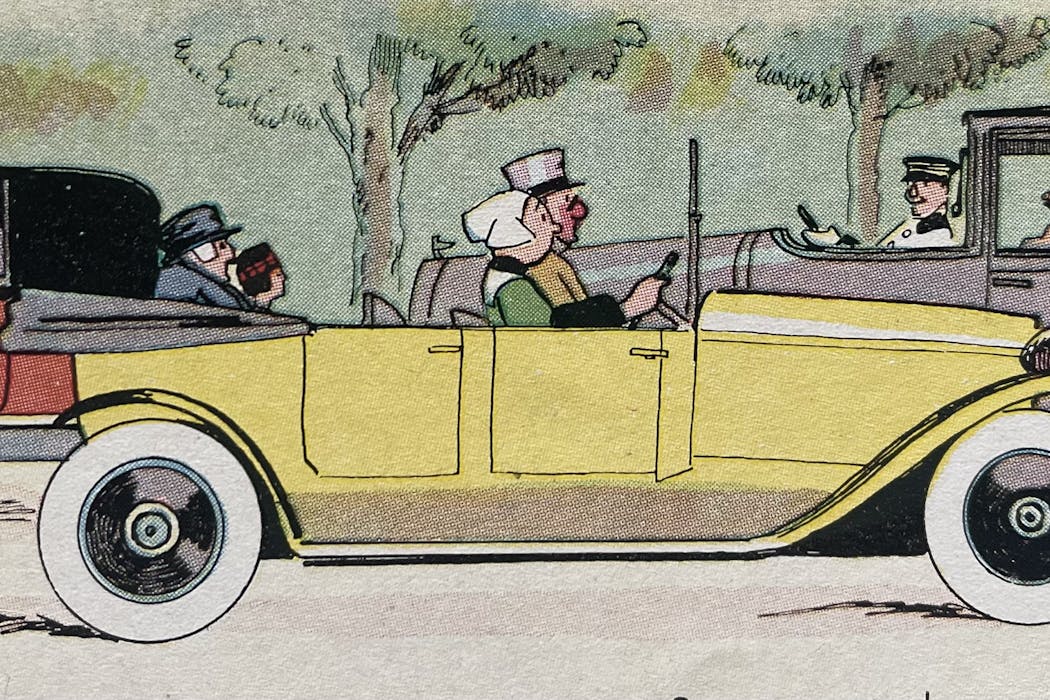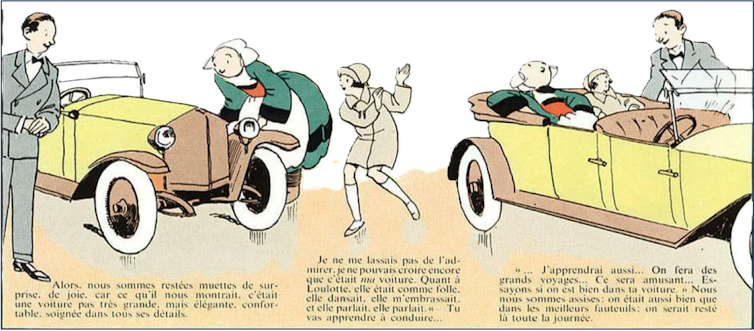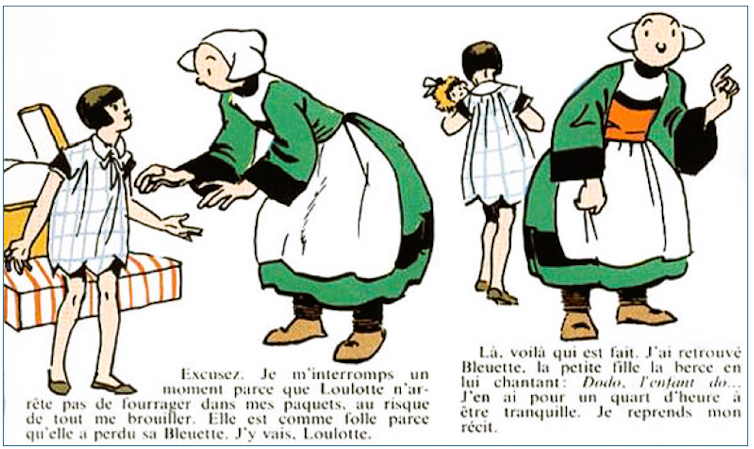Source: The Conversation – France in French (3) – By Laurence Coiffard, Professeur en galénique et cosmétologie, Université de Nantes, Auteurs historiques The Conversation France
Au début de l’année 2025, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une loi ayant pour objectif d’aboutir au remboursement à 100 % par la Sécurité sociale de certains soins et dispositifs prescrits dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein.
La loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’Assurance maladie a été promulguée, après son adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Elle concerne pour l’heure les « actes de dermopigmentation », les « sous-vêtements adaptés au port de prothèses mammaires amovibles » et le « renouvellement des prothèses mammaires ». La loi prévoit également « un forfait finançant des soins et des dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale ».
Toutefois, pour en savoir plus sur la nature des autres soins et dispositifs susceptibles d’être remboursés, il faudra attendre le décret d’application, qui n’a pas encore été publié au moment où ces lignes sont écrites. La Haute Autorité de santé (HAS), l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sont notamment consultées dans ce cadre.
Ce texte de loi nous amène à réfléchir à plusieurs sujets : la dermopigmentation et sa sécurité d’emploi, l’existence de produits hydratants susceptibles d’être prescrits et remboursés, ou encore l’importance des cosmétiques pour l’amélioration de la qualité de vie des patientes. Faisons le point.
« Soin de support » : de quoi s’agit-il ?
Utilisée depuis les années 1950 dans la littérature médicale, l’expression anglaise de « supportive cares » est souvent traduite improprement en français par le terme de « soins de support ». Il serait en effet plus juste d’employer le terme de « soins de soutien ».
Leur définition est précisée en 1994, grâce à la philosophe Margaret Fitch, qui les circonscrit à la cancérologie et les définit comme
« la prestation des services nécessaires aux personnes atteintes ou affectées par le cancer, pour répondre à leurs besoins informationnels, émotionnels, spirituels, sociaux ou physiques, pendant les phases de diagnostic, de traitement ou de suivi, englobant les questions de promotion de la santé et de prévention, de survie, de soins palliatifs et de deuil… »
Ce terme de « soins de support » sera repris par le président Jacques Chirac dans son plan Cancer de 2003, dont lesdits soins constitueront le point 42 des 70 mesures à mettre en place.
Dermopigmentation et remboursement
Le texte de loi évoque le remboursement des soins de « tatouage médical », dans le cadre de la chirurgie reconstructive du sein. Cette technique de tatouage, réalisée depuis 1975, a pour objectif de simuler l’aréole manquante à l’aide de pigments. Considérée comme sûre par le corps médical, elle est appréciée des bénéficiaires de manière générale.
Il serait utile, toutefois, de s’assurer de la qualité des encres utilisées. En effet, on trouve sur le marché des produits pouvant être contaminés par divers polluants susceptibles de compromettre la santé des utilisatrices : métaux lourds, hydrocarbures aromatiques polycycliques, amines aromatiques,formaldéhyde, etc.
À lire aussi :
Tatouage et allergies : de nombreuses encres contiennent des ingrédients non indiqués sur l’étiquette
Quelles crèmes hydratantes rembourser ?
Si les crèmes hydratantes ne sont pas désignées explicitement en tant que soins de support, il est évident que ces crèmes, susceptibles de traiter le problème de la sécheresse cutanée, effet indésirable récurrent, sont bien concernées.
Les traitements par chimio et radiothérapies peuvent induire une sécheresse cutanée. Dans ce contexte, les crèmes hydratantes susceptibles de traiter ce problème sont des produits importants pour améliorer la qualité de vie des patientes. Cependant, elles ne sont pas désignées explicitement en tant que soins de support dans le texte de loi.
Par ailleurs, il est important de déterminer de quelles crèmes hydratantes il est question, car leur nature n’est pas sans conséquences sur leur remboursement. Faut-il plutôt les chercher dans le domaine cosmétique ou bien dans celui du médicament ?
À l’heure actuelle, une dizaine de spécialités médicamenteuses sont remboursées à hauteur de 15 %. Destinées à traiter la sécheresse cutanée dans le cadre de différentes pathologies (comme l’eczéma ou le psoriasis), elles sont de composition très simple, renfermant un trio de principes actifs : glycérol, vaseline, paraffine. Leur prix est modique, puisqu’il faut compter 2,51 € pour acquérir un tube de 250 grammes.
D’autres dispositifs médicaux à caractère hydratant sont également remboursables en cas de prescription, dans certaines indications. Pour pouvoir être remboursable, il faut que le fabricant du dispositif médical en question accomplisse la démarche de déposer un dossier auprès de la Haute Autorité de santé (plus précisément à la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, Cnedimts) et auprès du Comité économique des produits de santé (Ceps). Si le remboursement est agréé, alors, ledit dispositif médical pourra figurer sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP).
À côté de ces différents dispositifs médicaux, il existe de très nombreux produits cosmétiques présentés comme hydratants ou émollients (capables d’amollir les tissus biologiques, les rendant plus souples). Ces derniers ne sont pas, pour l’heure, remboursés. Leur composition, très variable, devra être examinée avec soin, au cas par cas, afin d’éviter la présence de toute substance indésirable.
Pourquoi rembourser des vernis à ongles ?
Certains traitements du cancer du sein peuvent provoquer une altération de la plaque unguéale se traduisant par l’apparition de stries ou une modification de sa couleur. Afin de protéger les ongles des effets délétères de la chimiothérapie, qui peuvent entraîner leur chute, il est possible d’appliquer sur ceux-ci des vernis à ongles.
Les produits destinés à renforcer l’ongle peuvent donc être considérés comme des soins de support et, à ce titre, pourraient être remboursés.
Ces substances doivent être appliquées en deux couches successives. Pour renforcer leur efficacité, on peut d’abord couvrir l’ongle nu d’une couche de base, qui recevra le vernis, puis une couche de « top coat » sur ce dernier.
Des « thérapies par la beauté » ?
Certaines études ont mis en évidence le fait que les ateliers de maquillage, proposés par des socio-esthéticiennes (maquillage du teint, des yeux) permettent d’améliorer le bien-être et la qualité de vie des patientes. Cette « thérapie par la beauté » permet d’augmenter l’estime de soi, même chez les femmes qui ne semblent pas porter un intérêt particulier à leur apparence.
Ce moment est considéré comme une bulle apaisante par les femmes qui bénéficient de ces ateliers, lesquelles apprécient d’être traitées « comme une personne à part entière », et non plus comme une malade dont le corps est soumis à toutes sortes de protocoles curatifs.
Que changer, et jusqu’où aller ?
Proposer le remboursement des soins de support aux femmes souffrant d’un cancer du sein est une bonne chose. Cependant, la notion de soin de support est une notion vague et élastique, suffisamment étirable pour recouvrir toutes les pratiques qui permettent d’apporter un bénéfice à la patiente.
Cette loi, pour être appliquée correctement, va donc devoir faire la lumière sur les zones d’ombre qui existent encore, afin de ne proposer aux patientes que des produits sûrs et efficaces. Une crème hydratante remboursable ? Il en existe déjà. Des produits de maquillage des ongles ou du teint remboursables ? Il n’en existe pas encore, et il va falloir déterminer lesquels seront les plus bénéfiques pour les patientes.
Par ailleurs, une dernière question se pose : qu’en sera-t-il du remboursement des soins de support applicables aux patients atteints d’autres types de cancers ?
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Cancer du sein : comment sont remboursés les produits de soutien ? – https://theconversation.com/cancer-du-sein-comment-sont-rembourses-les-produits-de-soutien-250115