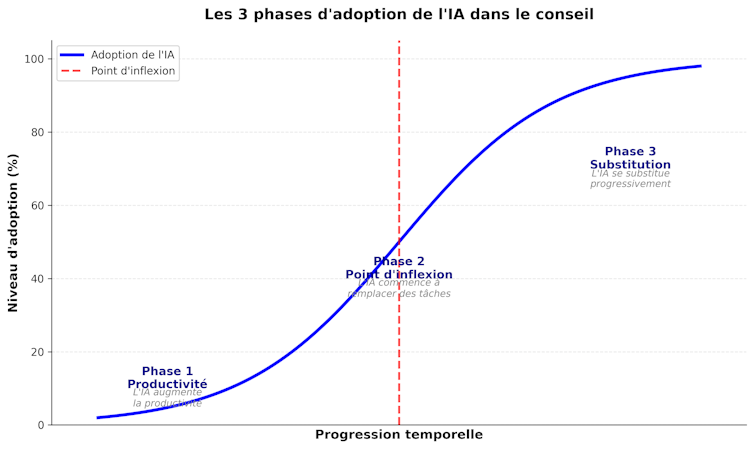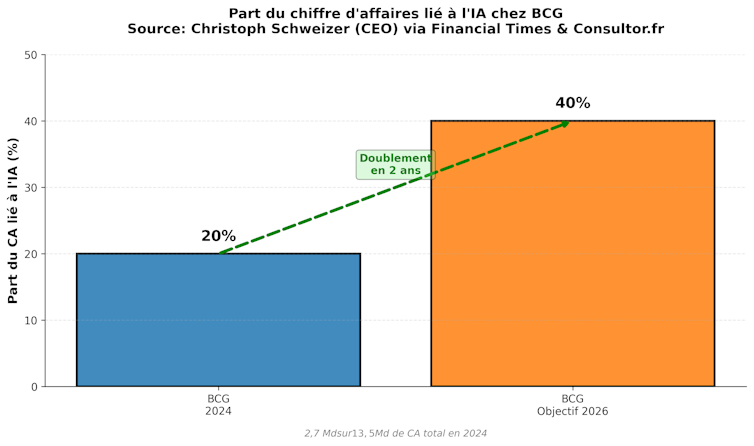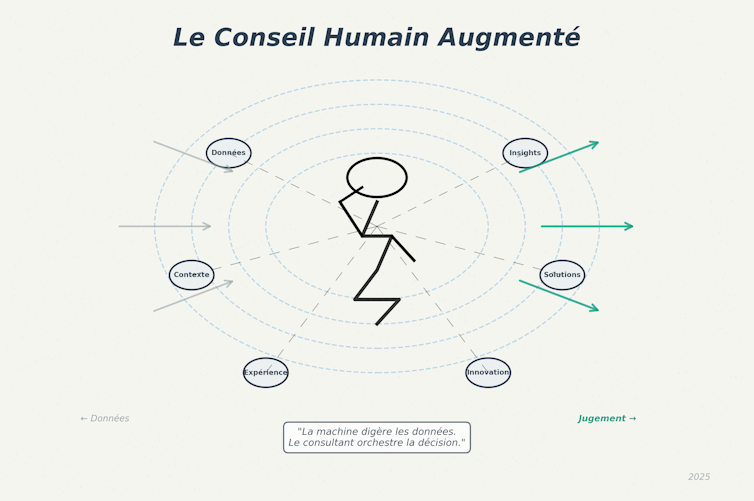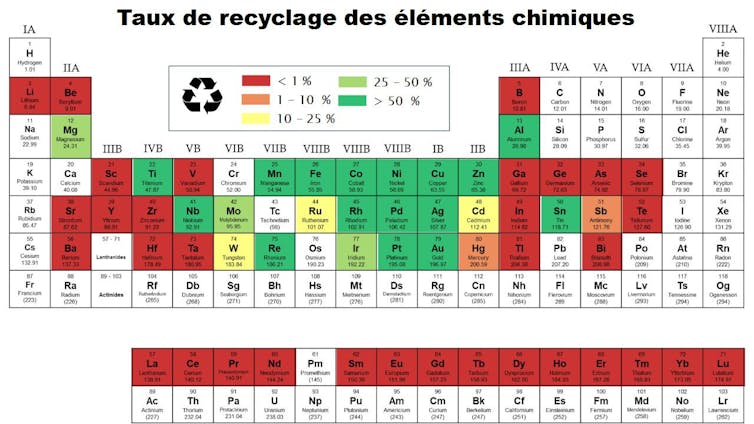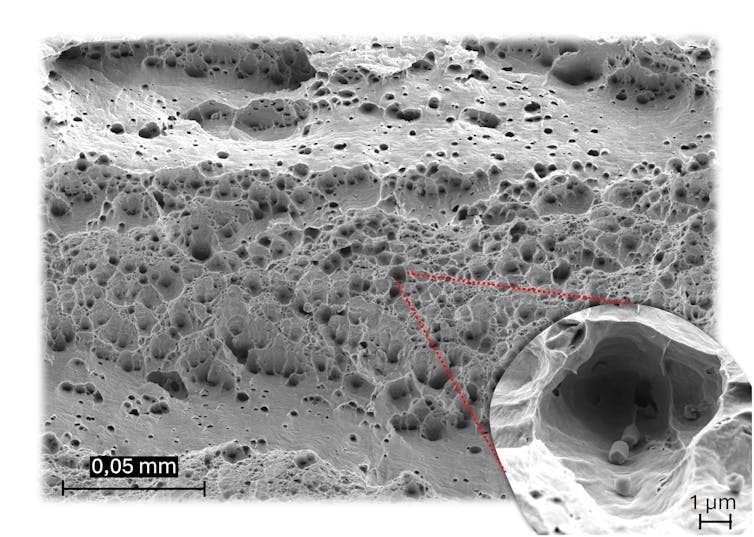Source: The Conversation – in French – By Christophe Premat, Professor, Canadian and Cultural Studies, Stockholm University
Au Québec, les citoyens disposent d’un pouvoir municipal rare au Canada : celui de bloquer par référendum des projets d’urbanisme dans leur quartier. Ce mécanisme de démocratie directe, inscrit dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme depuis les années 1970, est à double tranchant : il permet une implication citoyenne forte, mais peut aussi paralyser des initiatives nécessaires pour lutter contre la crise du logement.
Les référendums municipaux s’inscrivent dans une tradition de participation citoyenne ancrée dans la culture politique québécoise. On remarque néanmoins que la participation à ces scrutins est souvent faible, tandis que le pouvoir de blocage est puissant.
En tant que spécialiste des études canadiennes, je m’intéresse depuis ma thèse de science politique aux procédures de participation citoyenne, et tout particulièrement à la tension entre démocratie participative et démocratie directe.
Cet article fait partie de notre série Nos villes d’hier à demain. Le tissu urbain connaît de multiples mutations, avec chacune ses implications culturelles, économiques, sociales et – tout particulièrement en cette année électorale – politiques. Pour éclairer ces divers enjeux, La Conversation invite les chercheuses et chercheurs à aborder l’actualité de nos villes.
Tourisme et démocratie locale : la leçon de Petite-Rivière-Saint-François
En 2022, la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix, a organisé un référendum local visant l’assouplissement de deux règlements de zonage relatifs aux résidences de tourisme.
Le résultat a été sans appel, puisque plus de 70 % des électeurs ont voté contre l’assouplissement des règles qui aurait permis d’accueillir davantage de chalets locatifs près du Massif. Le message des citoyens était clair : préserver la qualité de vie et le caractère du territoire face à une pression touristique jugée excessive.
Le scrutin a eu un effet immédiat avec le rejet des règlements, stoppant ainsi un projet de développement.
À lire aussi :
Les voitures restreignent le droit des enfants de profiter de la ville. Voici des projets qui font la différence
À Québec, un vote favorable à la ville compacte
Deux ans plus tard, à Québec, dans l’arrondissement de Charlesbourg, le projet Maria-Goretti a connu une issue inverse.
Près de la moitié des électeurs de la zone concernée se sont déplacés pour voter, et cette fois, la majorité a approuvé le projet résidentiel soumis à approbation référendaire.
L’administration municipale a salué le résultat comme un signe d’adhésion à une densification maîtrisée, alors que les opposants y voyaient un précédent inquiétant pour le patrimoine local.
Au Québec, l’urbanisme passe aussi par les urnes
Ces deux exemples illustrent la vitalité – mais aussi les tensions – de la démocratie urbaine au Québec.
Contrairement à la plupart des provinces canadiennes, où les projets d’urbanisme sont décidés par les conseils municipaux sans recours direct aux électeurs, le Québec conserve des mécanismes d’approbation référendaire hérités de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).
Les citoyens qui s’estiment lésés par un projet peuvent demander l’ouverture d’un registre, recueillir des signatures, et si le seuil requis est atteint, déclencher un vote.
À lire aussi :
Crise du logement : alors que l’État se désengage, une entraide de proximité permet d’éviter le pire
Participation ou paralysie ? Le dilemme des référendums d’urbanisme au Québec
Ce dispositif, qui remonte aux années 1970, repose sur une idée forte : permettre à ceux qui habitent un quartier de participer à la décision sur son avenir. Mais il est aujourd’hui au cœur d’un débat : favorise-t-il réellement la démocratie, ou crée-t-il des zones de veto locales capables de bloquer toute initiative de densification ?
Le paradoxe tient à la fois dans la mobilisation et dans la portée.
Lorsqu’un vote a lieu, la participation dépasse rarement 50 %. Pourtant, un petit nombre d’électeurs peut décider du sort d’un projet d’intérêt collectif. En 2017, le gouvernement du Québec a tenté de moderniser ces procédures avec le projet de loi 122, qui visait à donner plus d’autonomie aux municipalités et à encourager d’autres formes de participation.
Plusieurs villes ont alors remplacé les référendums par des consultations publiques plus ouvertes, misant sur la pédagogie et le dialogue.
L’Office de consultation publique de Montréal
C’est le cas de Montréal, où l’Office de consultation publique (OCPM) organise régulièrement des audiences sur les grands projets urbains.
À lire aussi :
Élections municipales : les enjeux des villes changent, mais pas leurs pouvoirs
Des centaines de citoyens peuvent y soumettre des mémoires, participer à des ateliers, ou voter dans le cadre de budgets participatifs.
En 2021, plus de 20 000 Montréalais ont pris part à un vote en ligne pour choisir les projets d’aménagement financés par la ville – un chiffre sans précédent pour une initiative locale.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
La consultation plutôt que le référendum
À Boisbriand, la municipalité a choisi de multiplier les consultations plutôt que de déclencher des votes formels, afin d’éviter que quelques dizaines de signatures ne suffisent à bloquer un règlement.
Mais le référendum local conserve une charge symbolique forte.
Dans un contexte de méfiance croissante envers les promoteurs immobiliers, il apparaît comme le dernier rempart pour protéger les citoyens contre des décisions jugées opaques.
Le NIMBYisme à la québécoise : entre défense du cadre de vie et justice sociale
Cette défiance s’exprime aussi face aux élus municipaux, souvent perçus comme trop proches des intérêts privés. Le « non » devient alors une manière de reprendre le contrôle du territoire, de ralentir un rythme de transformation jugé trop rapide.
Ce réflexe de défense du cadre de vie est parfois associé au NIMBYisme, acronyme de « Not In My Backyard ».
L’expression désigne ceux qui soutiennent les politiques publiques en général, mais refusent leur application à proximité de chez eux. On parle souvent de NIMBYs « de droite », attachés à la valeur foncière de leur propriété et hostiles à la densification.
Mais le Québec voit émerger une autre forme de contestation, un NIMBYisme « de gauche », ancré dans la critique de la spéculation immobilière et de l’embourgeoisement. Les opposants ne défendent plus seulement leur jardin, mais aussi le droit au logement, la mixité sociale et la préservation du patrimoine collectif.

Frank DiMauro | Facebook
Référendums, NIMBYisme et crise du logement : un équilibre impossible ?
Ces deux visages du NIMBYisme se croisent et s’affrontent souvent dans les débats municipaux.
Un même projet peut être rejeté pour des raisons très différentes : les uns craignent la hausse du trafic ou la perte d’intimité, les autres redoutent l’arrivée de condominiums de luxe chassant les locataires modestes. La frontière entre conservatisme local et résistance progressiste devient floue, et le référendum en est le miroir.
Dans un contexte de crise du logement, cette ambivalence devient un enjeu politique majeur. Les gouvernements municipaux et provinciaux doivent arbitrer entre la participation et l’efficacité. Trop de recours citoyens peuvent ralentir des projets nécessaires, tandis que trop peu de recours risquent de creuser le fossé entre élus et habitants.
Les maires, eux, se retrouvent pris entre deux feux : on leur reproche à la fois de céder aux promoteurs et de ne pas aller assez vite pour répondre à la demande.
À lire aussi :
Pour les villes, finis les projets flamboyants, l’ère est à l’entretien, la consolidation et la résilience
Sortir de l’impasse
Plusieurs villes expérimentent des dispositifs de co-construction : jurys citoyens, laboratoires urbains, consultations hybrides.
Ces formes de participation ne remplacent pas le vote, mais cherchent à l’enrichir. Elles permettent d’impliquer les habitants dès la conception d’un projet, avant que les positions ne se figent dans un « oui » ou un « non ». L’enjeu n’est pas de supprimer la démocratie directe, mais de la rendre plus délibérative, moins défensive.
Les référendums municipaux québécois rappellent que la démocratie locale n’est jamais acquise. Ils traduisent à la fois une volonté d’autonomie citoyenne et une peur de perdre le contrôle face à des transformations urbaines rapides. Dans une époque où les villes se densifient, où le logement devient un bien rare, cette tension est inévitable.
Plutôt que de l’opposer, il s’agit d’en faire le moteur d’un nouveau pacte urbain où la parole des habitants pèse sans pour autant paralyser l’action collective.
![]()
Christophe Premat est professeur en études culturelles francophones et directeur du Centre d’études canadiennes de l’Université de Stockholm. Il est membre de l’Association Internationale des Études Québécoises depuis 2023. Il est l’auteur d’une thèse de science politique sur “la pratique du référendum local en France et en Allemagne” soutenue en 2008 à l’Institut d’études politiques de Bordeaux.
– ref. « Pas dans ma cour » : Les deux faces du NIMBYisme québécois – https://theconversation.com/pas-dans-ma-cour-les-deux-faces-du-nimbyisme-quebecois-267907