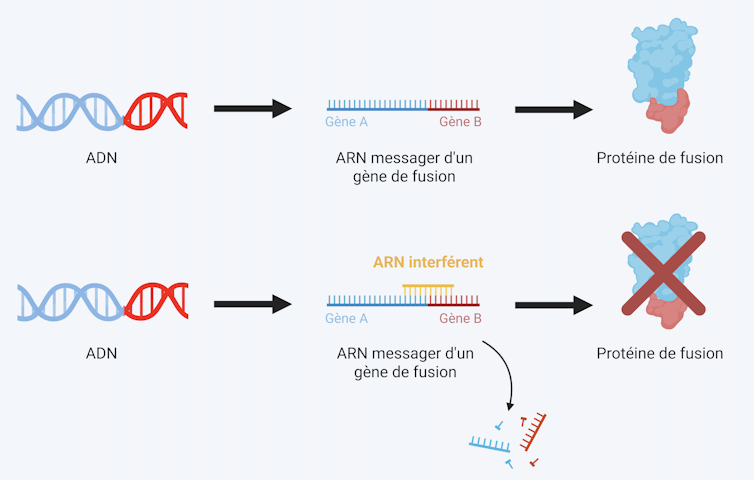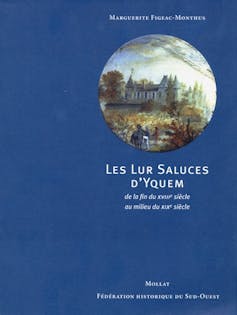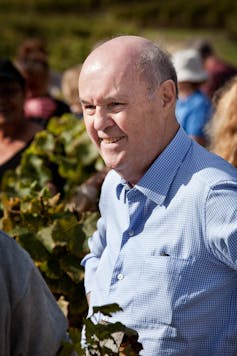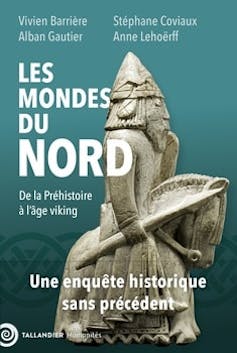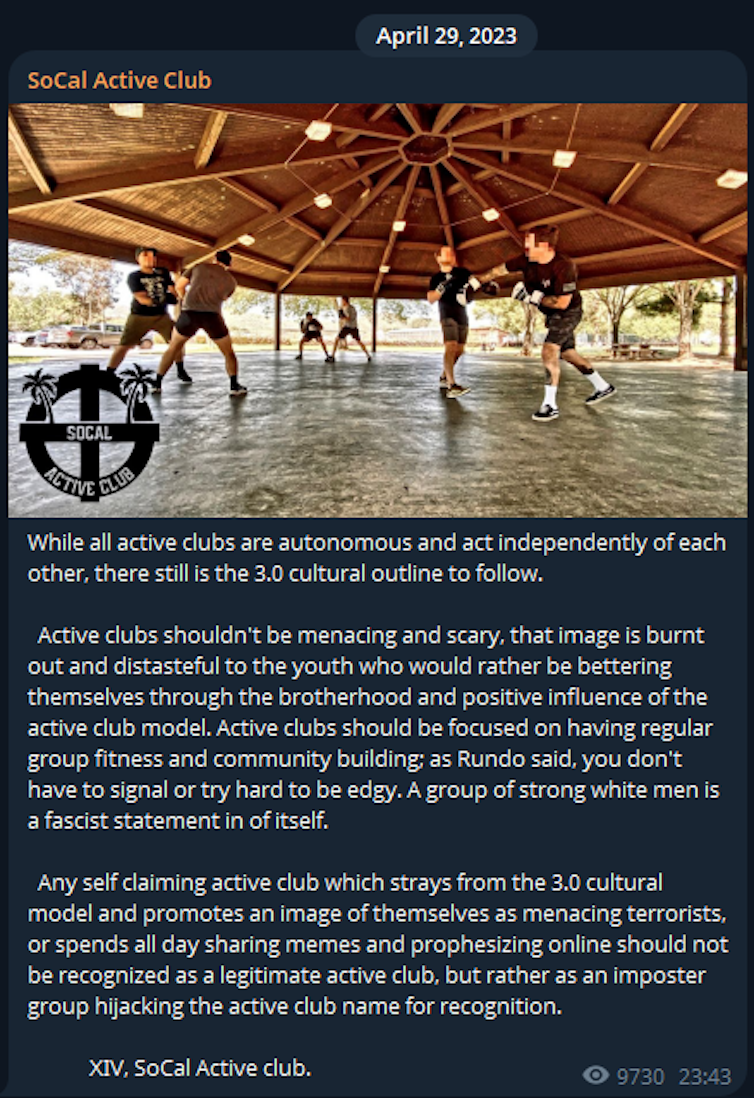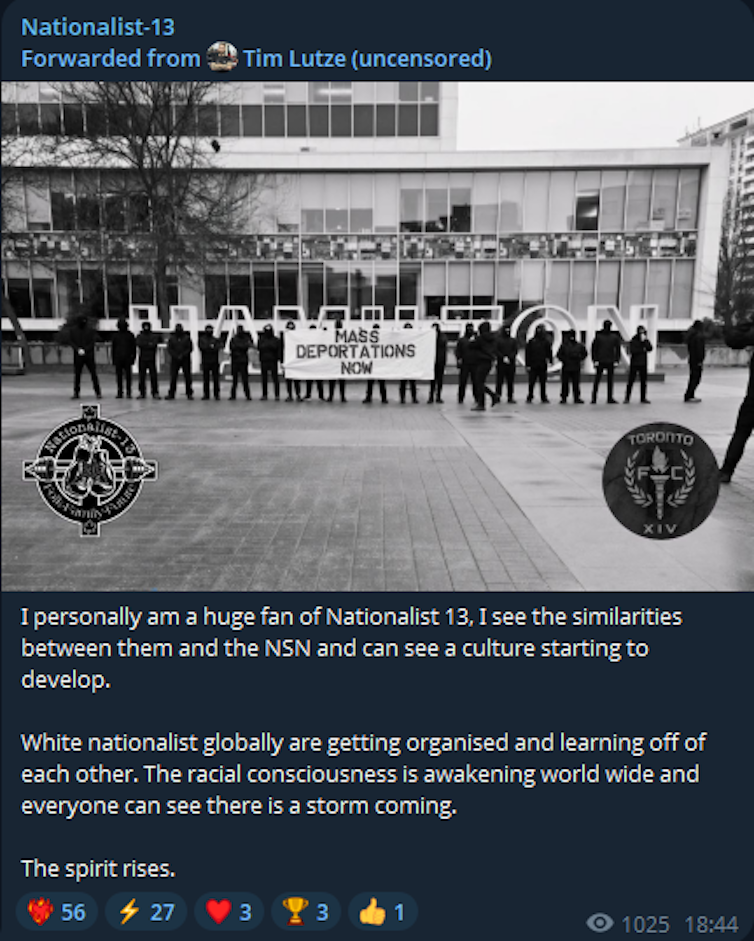Source: The Conversation – in French – By Marine Gauthier, PhD Candidate International Relations, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Ils occupent 20 % des territoires terrestres. Les peuples autochtones sont de plus en plus présents aux COP, mais leurs voix demeurent souvent inaudibles lorsque les décideurs du monde entier se réunissent.
« Nous ne sommes pas ici simplement pour poser sur vos photos. Nous sommes titulaires de droits en vertu de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et devons être présents à la table des décisions », avait prévenu, à la COP28 (Dubaï, 2023), Sarah Hanson, membre de la communauté anishinaabée de Biigtigong Nishnaabeg au Canada, et du Forum international des peuples autochtones sur le changement climatique.
Cette année-là comme les suivantes, cependant, bien peu de représentants des peuples autochtones se trouvaient à la table des négociations. Ils sont pourtant de plus en plus nombreux à se rendre aux COP pour tâcher de faire entendre les voix de leurs communautés dans des pavillons, panels, au moyen de déclarations solennelles ou d’interventions médiatiques. Ils représentent environ 476 millions de personnes et occupent 20 % du territoire terrestre parmi les plus cruciaux pour la préservation de la biodiversité et du climat. Leur rôle est donc crucial dans la lutte contre le changement climatique.
Mais derrière cette façade inclusive, un paradoxe persiste. Si la visibilité des peuples autochtones augmente, leurs voix peinent encore à peser réellement sur les décisions.
À l’approche de la prochaine COP, qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém (Brésil), aux portes de la forêt amazonienne, cette contradiction mérite toute notre attention. Elle met en lumière les hiérarchies persistantes de savoirs et de pouvoir qui structurent encore les négociations climatiques internationales.
Un effet vitrine qui ne débouche pas sur l’influence
Un contraste revient de manière frappante : les sessions plénières et les panels où interviennent des représentants autochtones sont largement médiatisés, mais les espaces fermés où s’écrivent les décisions finales leur restent inaccessibles. L’essentiel des discussions techniques se joue de fait dans des « salles de négociation » réservées aux États et à quelques acteurs institutionnels disposant de sièges permanents et de droit à la parole.
La visibilité accrue ne s’est donc pas encore traduite en véritable pouvoir de décision. Ce déséquilibre se retrouve dans les contributions déterminées au niveau national (CDN), les plans que chaque pays soumet dans le cadre de l’accord de Paris (2015) pour expliquer comment il compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique. Ces documents sont au cœur des COP, car ils servent de base à l’évaluation collective des efforts de chaque État. Or, dans de nombreux pays, leur élaboration reste très technocratique : confiée à des cabinets de consultants ou à des institutions internationales, elle se fait souvent sans véritable consultation des communautés locales ni des peuples autochtones, pourtant directement concernés par les politiques climatiques. De nouveau, à la COP28, à Dubaï en 2023, leurs voix étaient audibles sur les scènes publiques, mais absentes des textes finaux sur le mécanisme de Loss and damage (destiné à indemniser les pays et populations les plus vulnérables face aux pertes et dommages causés par le changement climatique) et les dispositifs financiers associés.
L’écoute sélective des savoirs autochtones
Les revendications des peuples autochtones, qu’il s’agisse de leurs droits fonciers, de leur souveraineté politique ou de la reconnaissance de leur histoire, sont ainsi rarement prises en compte. Sans doute parve que les admettre reviendrait à redistribuer le pouvoir au sein du système climatique international, ce que les États et les institutions internationales évitent soigneusement au travers de différentes stratégies, volontaires ou non.
Certes, les COP valorisent volontiers la contribution des peuples autochtones sur une série de sujets seulement. C’est le cas pour les « solutions fondées sur la nature », telles que la préservation des forêts utilisées pour compenser les émissions de carbone. Mais les contributions autorisées s’accordent avec les instruments financiers et technologiques déjà en place : ils permettent d’intégrer les savoirs autochtones tant qu’ils ne remettent pas en cause l’ordre établi. La participation devient alors une vitrine d’inclusivité, plus qu’un véritable partage du pouvoir.
Cette reconnaissance sélective s’apparente à une « justice épistémique partielle » : les savoirs autochtones sont validés quand ils renforcent les cadres scientifiques dominants, mais rarement reconnus comme fondateurs d’autres modes de gouvernance. Lors de la COP29, tenue en Azerbaïdjan en 2024, le Baku Workplan a certes souligné l’importance d’intégrer les savoirs autochtones dans les stratégies climatiques, notamment dans les domaines de l’adaptation et de la gestion des écosystèmes. Les savoirs agricoles et hydrologiques des peuples vivant en zones arides ont comme cela été largement valorisés, présentés comme une ressource précieuse pour renforcer la résilience face aux sécheresses et aux inondations.
En revanche, les savoirs portant sur la gouvernance foncière, la propriété des territoires ou les modes de consultation communautaires ont été largement absents des discussions, qui déterminent pourtant directement l’avenir de leurs terres. Ces éléments sont d’ailleurs systématiquement absents à ce jour des plans nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique (les CDN).
Cette marginalisation se produit également via le fonctionnement même du régime climatique. Les négociations s’appuient sur une logique globale (des chiffres, des tonnes de carbone, des scénarios prospectifs de réduction d’émissions) qui ignore les réalités locales. Ce cadre « aplatit » la diversité des contextes et réduit les savoirs autochtones à des anecdotes culturelles. Les projets de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+) illustrent ce décalage.
Ces initiatives visent à réduire les émissions issues de la déforestation en quantifiant le carbone stocké dans les forêts. Mais cette logique purement comptable ignore encore les usages coutumiers de la forêt (chasse, cueillette, cultures itinérantes) et les droits fonciers des communautés locales. Ces réalités demeurent marginales au milieu des indicateurs mesurables prédéfinis, tels que le nombre d’hectares « protégés », vidant de sens leur conception du territoire comme espace de vie.
Dans les débats de la COP, certains autochtones témoignent ainsi de la difficulté de faire entendre leurs savoirs. Les experts internationaux auxquels ils s’adressent « sont bien formés aux standards mondiaux, mais peu au contexte local » déplorait ainsi un représentant autochtone d’Afrique centrale. Ce décalage oblige alors les communautés à traduire leurs savoirs dans un langage normatif pour être audibles : un effort constant de « traduction culturelle » qui affaiblit la portée de leurs connaissances.
À cela s’ajoutent des obstacles pratiques : celui de la langue (l’anglais technique de la diplomatie), du rythme effréné des sessions parallèles, des moyens financiers limités pour envoyer des délégations complètes. Face à ces obstacles, les voix autochtones passent par l’intermédiaire d’ONG ou d’agences internationales, ou par des canaux de communication digitaux. Ce qu’ils disent sur leur territoire et leur vécu est alors reformulé dans un langage calibré pour les institutions internationales, au risque d’en édulcorer la portée critique.
Enfin, lorsqu’elle est institutionnalisée, la participation autochtone, cette image de protecteur, bien qu’elle leur ouvre certaines portes, peut aussi se retourner contre eux, car elle enferme leurs savoirs dans des cases figées.
Ainsi le plan de la République du Tchad pour réduire et s’adapter au changement climatique (CDN) indique-t-il la « mise en valeur des savoir-faire et connaissances autochtones » comme le deuxième pilier de son domaine d’intervention « environnement et forêts ». Mais dans le même temps, il désigne en coupable une grande partie des activités traditionnelles de ces peuples (« pression pastorale, braconnage, pêche, pression démographique, surexploitation des ressources naturelles, feux de brousse et agriculture ») comme cause de la dégradation de la biodiversité. Seule voie, aux yeux de ce plan gouvernemental, l’exploitation des produits forestiers non ligneux (écorces, feuilles, miel, champignons…) qui deviennent des « ressources durables » compatibles avec la logique de marché. Exploitation qui ne concerne d’ailleurs qu’une partie des communautés autochtones, souvent celles établies dans les zones boisées du Sud, et qui représente une part marginale de leurs activités économiques.
À l’approche de « la COP des COP »
Les savoirs autochtones ne servent ainsi fréquemment qu’à « réenchanter » une arène technocratique, sans pour autant en changer les règles du jeu.
À l’approche de la COP30, les peuples autochtones se préparent à une participation record, mais dans un scénario qui ressemble étrangement aux précédents. Cette conférence est un moment clé, car elle marquera la réévaluation des engagements climatiques dix ans après l’accord de Paris et elle abordera des thématiques chères aux peuples autochtones : arrêt de la déforestation d’ici à 2030, abandon des énergies fossiles, mise en place de ressources financières dédiées à la finance climatique.
Plus de 190 États et des milliers de représentants de la société civile et d’entreprises y seront présents. Le Brésil annonce la venue de 3 000 représentants autochtones, dont un millier participera à des sessions officielles – une première. Les organisations autochtones, notamment d’Amazonie, expriment déjà leurs revendications. Patricia Suarez, de l’Organisation nationale des peuples autochtones de l’Amazonie colombienne (OPIAC), rappelle à cet égard :
« Ce n’est pas seulement une question de climat, c’est une question de vie, de survie même de nos communautés. »
Pourtant, les règles du jeu n’ont pas changé. Ces représentants pourront écouter mais rarement parler. Leur inclusion dans les délégations nationales et les groupes techniques reste exceptionnelle. Surtout, la question des droits fonciers demeure un angle mort des négociations. Or, environ 22 % du carbone des forêts tropicales se trouve sur des terres gérées par des communautés autochtones, dont un tiers ne sont pas reconnues juridiquement. Sans titre foncier, ces territoires restent vulnérables à l’exploitation et à la déforestation : une menace directe pour le climat mondial comme pour la justice environnementale.
![]()
Marine Gauthier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. COP après COP, les peuples autochtones sont de plus en plus visibles mais toujours inaudibles – https://theconversation.com/cop-apres-cop-les-peuples-autochtones-sont-de-plus-en-plus-visibles-mais-toujours-inaudibles-268706