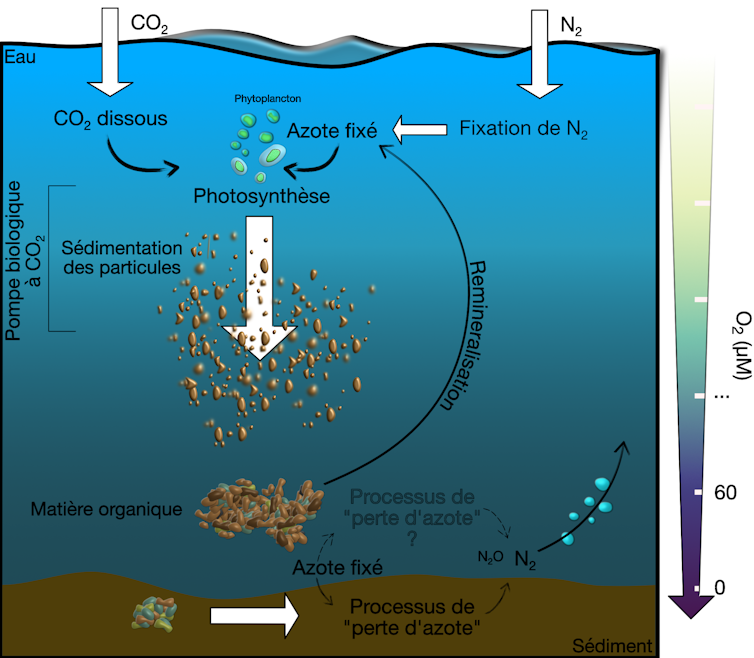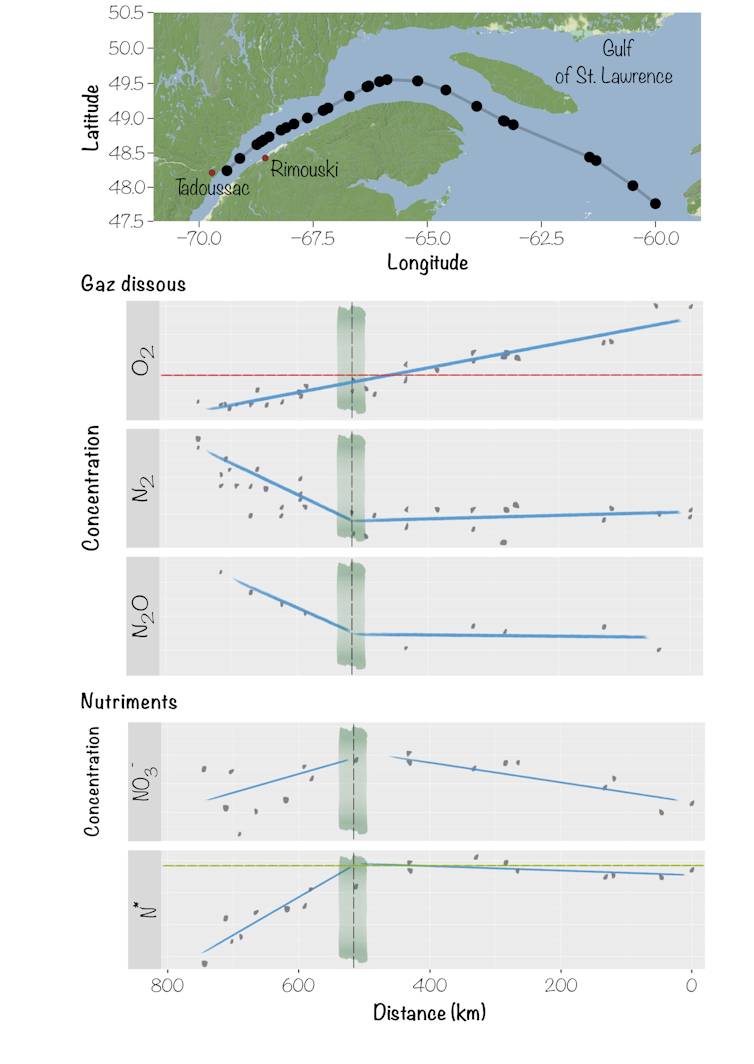Source: The Conversation – in French – By Coralie Thieulin, Enseignant chercheur en physique à l’ECE, docteure en biophysique, ECE Paris
Greffer l’organe d’un animal à un être humain n’est plus de la science-fiction. Ces dernières années, plusieurs patients ont reçu des cœurs, des reins ou même la peau d’un porc génétiquement modifié. Mais pourquoi choisir le cochon, plutôt qu’un autre animal ?
Le terme xénogreffe désigne la transplantation d’un tissu ou d’un organe provenant d’une espèce différente de celle du receveur, par exemple, d’un porc vers un humain. Elle se distingue de l’allogreffe, entre deux humains, et de l’autogreffe, utilisant les propres tissus du patient. L’objectif est de remédier à la pénurie chronique d’organes humains disponibles pour la transplantation, tout en garantissant la compatibilité et la sécurité du greffon.
En France, au 1er janvier 2025, 22 585 patients étaient inscrits sur la liste nationale d’attente pour une greffe, dont 11 666 en liste active. En 2024, 852 patients sont décédés en attendant une greffe.
La peau de porc, une pionnière des xénogreffes
C’est d’abord la peau qui a ouvert la voie. Depuis les années 1960, la peau de porc est utilisée comme pansement biologique temporaire pour les grands brûlés. Sa structure et son épaisseur sont étonnamment proches de celles de la peau humaine, ce qui permet une bonne adhérence et une protection efficace contre les infections et la déshydratation.
Contrairement à d’autres animaux (vache, mouton, lapin), la peau de porc présente un réseau de collagène (protéine structurelle présente dans le tissu conjonctif et responsable de la résistance et élasticité des tissus) et une densité cellulaire similaires à ceux de l’homme, limitant les réactions de rejet immédiat. Ces greffes ne sont toutefois que temporaires : le système immunitaire finit par les détruire. Néanmoins, elles offrent une protection temporaire avant une autogreffe ou une greffe humaine.
Une proximité biologique frappante
Au-delà de la peau, le cochon partage de nombreux points communs physiologiques avec l’être humain : taille des organes, rythme cardiaque, pression artérielle, composition du plasma, voire métabolisme. Le cœur d’un cochon adulte, par exemple, a des dimensions proches de celui d’un humain, ce qui en fait un candidat naturel pour les greffes.
D’autres espèces, comme les primates non humains, présentent une proximité génétique encore plus importante, mais leur utilisation soulève des questions éthiques et sanitaires beaucoup plus lourdes, sans parler de leur reproduction lente et de leur statut protégé.
Un animal compatible avec la médecine moderne
Au contraire, les cochons sont faciles à élever, atteignent rapidement leur taille adulte, et leurs organes peuvent être obtenus dans des conditions sanitaires contrôlées. Les lignées génétiquement modifiées, comme celles développées par la société américaine Revivicor, sont désormais dépourvues de certains gènes responsables du rejet hyper aigu, ce qui rend leurs organes plus « compatibles » avec le système immunitaire humain.
Les chercheurs ont aussi supprimé des virus « dormants » (qui ne s’activent pas) présents dans le génome du porc, réduisant le risque de transmission d’agents infectieux à l’Homme.
Du pansement biologique à la greffe d’organe
Après la peau, les chercheurs se tournent vers les reins, le cœur, le foie ou encore le pancréas. En 2024, des patients ont survécu plusieurs semaines avec un cœur de porc génétiquement modifié, une prouesse longtemps jugée impossible. Des essais ont également été menés avec des reins de porc, notamment chez des patients en état de mort cérébrale ou, plus récemment, chez un patient vivant. En revanche, les recherches sur le foie et le pancréas en sont encore au stade préclinique, menées uniquement chez l’animal. Ces avancées ne sont pas seulement symboliques : la pénurie mondiale de donneurs humains pousse la médecine à explorer des alternatives réalistes.
Cependant, le défi immunologique reste immense – même génétiquement modifiés, les organes porcins peuvent être rejetés par le système immunitaire humain – tout comme les enjeux éthiques liés notamment au bien-être animal
Le cochon s’est imposé non par hasard, mais parce qu’il représente un compromis entre proximité biologique, faisabilité et acceptabilité sociale. Si les essais confirment la sécurité et la durabilité des greffes, le porc pourrait bientôt devenir un allié inattendu mais essentiel de la médecine humaine.
![]()
Coralie Thieulin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Pourquoi le cochon est-il devenu l’animal de référence pour les xénogreffes ? – https://theconversation.com/pourquoi-le-cochon-est-il-devenu-lanimal-de-reference-pour-les-xenogreffes-267370