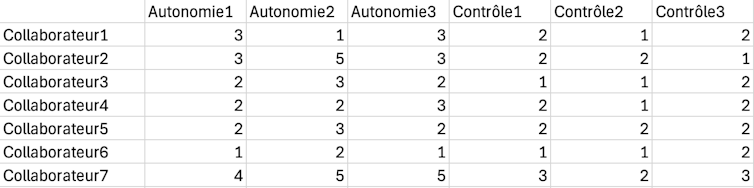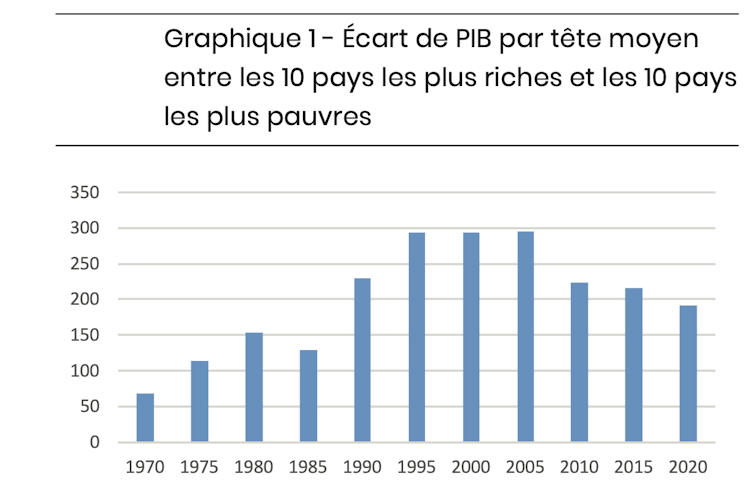Source: The Conversation – France in French (2) – By Willem Standaert, Associate Professor, Université de Liège
Alors que le Comité international olympique (CIO) adopte le jugement assisté par l’intelligence artificielle, cette technologie promet une plus grande cohérence et une meilleure transparence. Pourtant, les résultats de la recherche suggèrent que la confiance, la légitimité et les valeurs culturelles comptent autant que la précision technique.
En 2024, le CIO a dévoilé son agenda olympique de l’intelligence artificielle (IA), positionnant celle-ci comme un pilier central des futurs Jeux olympiques. Cette vision a été renforcée lors du tout premier Forum olympique sur l’IA, organisé en novembre 2025, où athlètes, fédérations, partenaires technologiques et décideurs politiques ont discuté de la manière dont l’IA pourrait soutenir le jugement, la préparation des athlètes et l’expérience des fans.
Aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 de Milan-Cortina qui démarrent vendredi 6 février, le CIO envisage d’utiliser l’IA pour soutenir le jugement en patinage artistique (épreuves individuelles et en couple, hommes et femmes), en aidant les juges à identifier précisément le nombre de rotations effectuées lors d’un saut.
Son utilisation s’étendra également à des disciplines, telles que le big air, le halfpipe et le saut à ski (des épreuves de ski et de snowboard où les athlètes enchaînent des sauts et figures aériennes), où des systèmes automatisés pourront mesurer la hauteur des sauts et les angles de décollage. À mesure que ces systèmes passent de l’expérimentation à un usage opérationnel, il devient essentiel d’examiner ce qui pourrait bien se passer… ou mal se passer.
Sports jugés et erreurs humaines
Dans les sports olympiques tels que la gymnastique et le patinage artistique, qui reposent sur des panels de juges humains, l’IA est de plus en plus présentée par les fédérations internationales et les instances sportives comme une solution aux problèmes de biais, d’incohérence et de manque de transparence. En effet, les juges doivent évaluer des mouvements complexes réalisés en une fraction de seconde, souvent depuis des angles de vue limités, et ce pendant plusieurs heures consécutives.
Les analyses post-compétition montrent que les erreurs involontaires et les divergences entre juges ne sont pas des exceptions. Cela s’est à nouveau matérialisé en 2024, lorsqu’une erreur de jugement impliquant la gymnaste américaine Jordan Chiles lors des Jeux olympiques de Paris a déclenché une vive polémique. En finale du sol, Chiles avait initialement reçu une note qui la plaçait à la quatrième place. Son entraîneur a alors introduit une réclamation, estimant qu’un élément technique n’avait pas été correctement pris en compte dans la note de difficulté. Après réexamen, la note a été augmentée de 0,1 point, permettant à Chiles d’accéder provisoirement à la médaille de bronze. Cette décision a toutefois été contestée par la délégation roumaine, qui a fait valoir que la réclamation américaine avait été déposée hors délai, dépassant de quatre secondes la fenêtre réglementaire d’une minute. L’épisode a mis en lumière la complexité des règles, la difficulté pour le public de suivre la logique des décisions, et la fragilité de la confiance accordée aux panels de juges humains.
Par ailleurs, des cas de fraude ont également été observés : on se souvient notamment du scandale de jugement en patinage artistique lors des Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City en 2002. À l’issue de l’épreuve en couple, des accusations ont révélé qu’une juge aurait favorisé un duo en échange d’un soutien promis dans une autre compétition, mettant au jour des pratiques d’échanges de votes au sein du panel de juges. C’est précisément en réponse à ce type d’incidents que des systèmes d’IA ont été développés, notamment par Fujitsu en collaboration avec la Fédération internationale de gymnastique.
Ce que l’IA peut (et ne peut pas) corriger dans le jugement
Nos recherches sur le jugement assisté par l’IA en gymnastique artistique montrent que la question ne se résume pas à savoir si les algorithmes sont plus précis que les humains. Les erreurs de jugement proviennent souvent des limites de la perception humaine, ainsi que de la vitesse et de la complexité des performances de haut niveau, ce qui rend l’IA attrayante. Cependant, notre étude impliquant juges, gymnastes, entraîneurs, fédérations, fournisseurs de technologies et fans met en lumière une série de tensions.
L’IA peut être trop exacte, évaluant les routines avec un niveau de précision qui dépasse ce que les corps humains peuvent réalistement exécuter. Par exemple, là où un juge humain apprécie visuellement si une position est correctement tenue, un système d’IA peut détecter qu’un angle de jambe ou de bras s’écarte de quelques degrés seulement de la position idéale, pénalisant une athlète pour une imperfection imperceptible à l’œil nu. Si l’IA est souvent présentée comme objective, de nouveaux biais peuvent émerger à travers la conception et la mise en œuvre des systèmes. Par exemple, un algorithme entraîné principalement sur des performances masculines ou sur des styles dominants peut pénaliser involontairement certaines morphologies. En outre, l’IA peine à prendre en compte l’expression artistique et les émotions, des éléments considérés comme centraux dans des sports tels que la gymnastique et le patinage artistique. Enfin, si l’IA promet une plus grande cohérence, son maintien exige une supervision humaine continue afin d’adapter les règles et les systèmes à l’évolution des disciplines.
Les sports d’action ont une autre logique
Nos recherches montrent que ces préoccupations sont encore plus marquées dans les sports d’action comme le snowboard et le ski freestyle. Beaucoup de ces disciplines ont été ajoutées au programme olympique afin de moderniser les Jeux et d’attirer un public plus jeune. Pourtant, des chercheurs avertissent que l’inclusion olympique peut accélérer la commercialisation et la standardisation, au détriment de la créativité et de l’identité de ces sports.
Un moment emblématique remonte à 2006, lorsque la snowboardeuse américaine Lindsey Jacobellis a perdu la médaille d’or olympique après avoir effectué un geste acrobatique consistant à saisir sa planche en plein saut en plein saut alors qu’elle menait la finale de snowboard cross. Ce geste, célébré dans la culture de son sport, a entraîné une chute qui lui a coûté la médaille d’or.
Les essais de jugement par IA aux X Games
Le jugement assisté par l’IA ajoute de nouvelles couches à cette tension. Des travaux antérieurs sur le halfpipe en snowboard avaient déjà montré comment les critères de jugement peuvent, avec le temps, remodeler subtilement les styles de performance. Contrairement à d’autres sports jugés, les sports d’action accordent une importance particulière au style et à la prise de risque, des éléments particulièrement difficiles à formaliser algorithmiquement.
Pourtant, l’IA a déjà été testée lors des X Games 2025, notamment pendant les compétitions de snowboard SuperPipe, une version de grande taille du halfpipe, avec des parois plus hautes permettant des sauts plus amples et plus techniques. Des caméras vidéo ont suivi les mouvements de chaque athlète, tandis que l’IA analysait les images afin de produire une note de performance indépendante. Ce système était testé en parallèle du jugement humain, les juges continuant à attribuer les résultats officiels et les médailles.
Cet essai n’a toutefois pas modifié les résultats officiels, et aucune comparaison publique n’a été communiquée quant à l’alignement entre les notes produites par l’IA et celles des juges humains. Néanmoins, les réactions ont été très contrastées : certains acteurs saluent une plus grande cohérence et transparence, tandis que d’autres ont averti que les systèmes d’IA ne sauraient pas quoi faire lorsqu’un athlète introduit une nouvelle figure – souvent très appréciée des juges humains et du public.
Au-delà du jugement : entraînement, performance et expérience des fans
L’influence de l’IA dépasse largement le seul cadre du jugement. À l’entraînement, le suivi des mouvements et l’analyse de la performance orientent de plus en plus le développement technique et la prévention des blessures, façonnant la manière dont les athlètes se préparent à la compétition. Parallèlement, l’IA transforme l’expérience des fans grâce à des ralentis enrichis, des visualisations biomécaniques et des explications en temps réel des performances.
Ces outils promettent davantage de transparence, mais ils cadrent aussi la manière dont les performances sont interprétées, avec davantage de « storytelling » autour de ce qui peut être mesuré, visualisé et comparé.
À quel prix ?
L’Agenda olympique de l’IA reflète l’ambition de rendre le sport plus juste, plus transparent et plus engageant. Toutefois, à mesure que l’IA s’intègre au jugement, à l’entraînement et à l’expérience des fans, elle joue aussi un rôle discret mais puissant dans la définition de ce qui constitue l’excellence. Si les juges d’élite sont progressivement remplacés ou marginalisés, les effets pourraient se répercuter à tous les niveaux : formation des juges, développement des athlètes et évolutions des sports eux-mêmes.
Le défi auquel sont confrontés les sports du programme olympique n’est donc pas seulement technologique ; il est institutionnel et culturel. Comment éviter que l’IA ne vide de leur substance les valeurs qui donnent à chaque sport son sens ?
![]()
Willem Standaert ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. L’IA arrive dans le jugement olympique. Qu’est-ce qui pourrait (bien) se passer ? – https://theconversation.com/lia-arrive-dans-le-jugement-olympique-quest-ce-qui-pourrait-bien-se-passer-272405