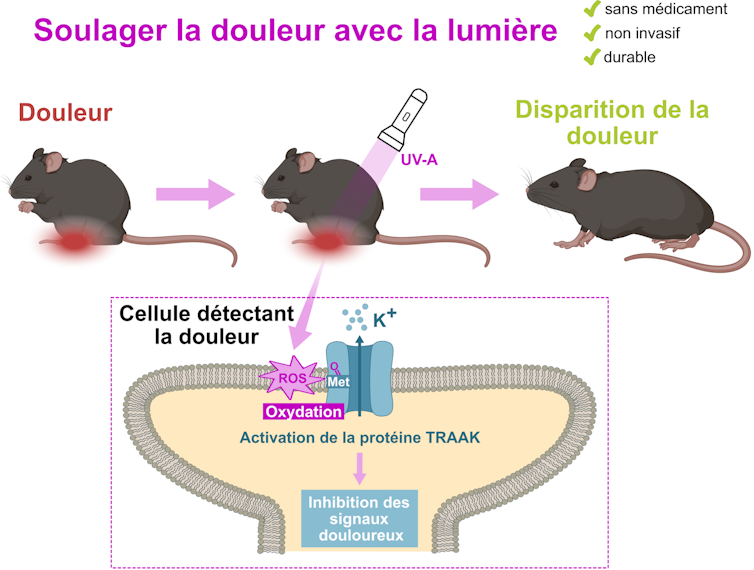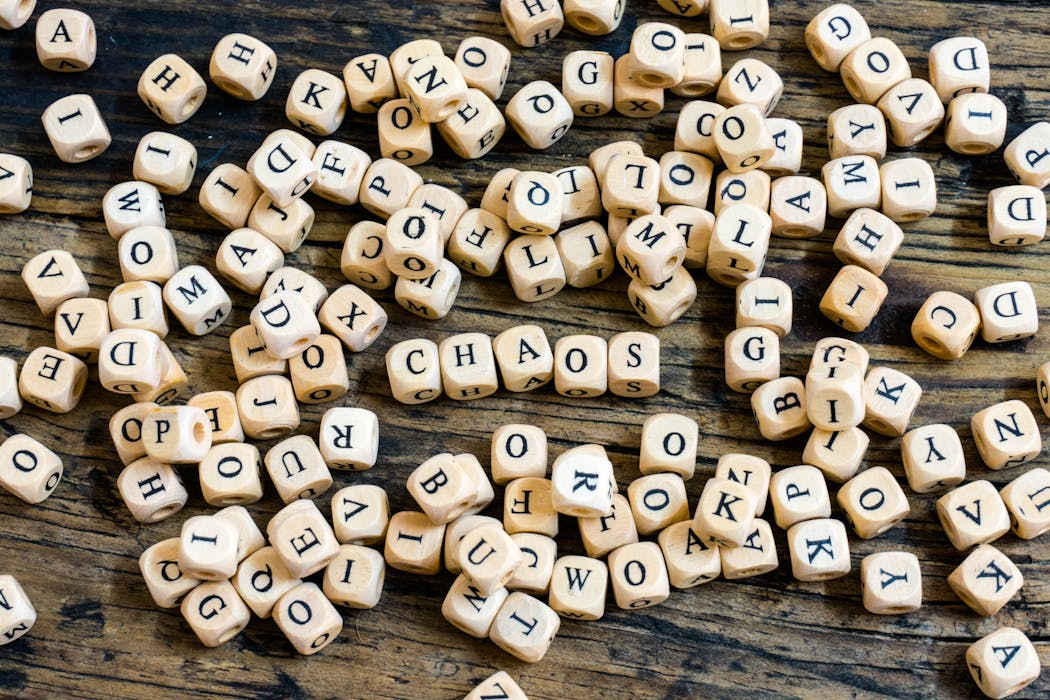Source: The Conversation – in French – By Julian Mischi, Sociologue et historien, Inrae
La dynamique politique des petites villes rurales diffère de celle des villages et des grandes villes. Lors des élections municipales se joue un subtil jeu de cache-cache politique : les candidats se font très discrets sur leurs liens avec les partis, craignant d’être accusés de servir ceux-ci plutôt que leur bourg. Personne n’est dupe, mais c’est la règle tacite.
Contrairement aux professionnels de la politique, les maires bénéficient d’une image favorable dans l’opinion publique, tout particulièrement lorsqu’ils sont à la tête de petites communes. Les élus ruraux échappent généralement au discrédit qui touche les partis politiques. Ils sont perçus comme les représentants de leur territoire, auxquels ils consacrent pleinement leur action à l’issue d’élections municipales, souvent interprétées comme éloignées des logiques partisanes. Effectivement, dans les villages de quelques centaines d’habitants, une seule liste est le plus souvent proposée aux électeurs. Les études montrent que la réduction de l’offre électorale à une seule liste concerne surtout les localités comptant moins de 500 habitants.
Les édiles de ces villages sont pris dans des conflits propres au monde paysan, liés à la maîtrise du foncier et à leur implication dans des réseaux agricoles (coopératives, syndicats). Le pouvoir local, marqué par la domination de quelques familles et les enjeux de coalition de parentèles, est dominé par les agriculteurs. Leur surreprésentation dans les mairies des villages s’est réduite depuis la fin du XXᵉ siècle mais les scrutins municipaux restent peu concurrentiels, faute de vivier suffisant de candidats. Ces scrutins n’en restent pas moins traversés par des antagonismes interpersonnels, expression de clivages sociaux et de conflits locaux.
Des élections convoitées
La situation est différente dans les bourgs, ces petites villes de quelques milliers d’habitants qui concentrent les services et l’emploi dans les campagnes. Ils se sont développés depuis le XIXᵉ siècle autour de services (école, hôpital, poste, gare, commerce) et d’entreprises artisanales et industrielles. La population de ces chefs-lieux de canton est formée en majorité de classes populaires tandis que les élites sociales y sont diverses (commerçants, artisans, professions libérales, enseignants, cadres et dirigeants d’entreprise).
Dans ces localités, le pouvoir municipal est l’objet de luttes politiques intenses. C’est ce que montre la recherche que nous avons menée sur l’histoire des luttes municipales dans trois bourgs de Bourgogne. Dans ces trois communes, 36 des 42 scrutins municipaux tenus depuis 1945 (soit 86 %) mettent aux prises plusieurs listes de candidats.
Un apolitisme revendiqué
Dans les petites villes rurales, les intitulés des listes mentionnent rarement une orientation politique, tout comme le soutien des partis apparaît peu dans le matériel électoral (bulletins, professions de foi, affiches). Les candidats mettent surtout en avant leur implication dans la vie associative et économique de la commune. Un engagement dans la vie politique est rarement évoqué, car s’il est mis explicitement en avant, il peut être reproché aux candidats d’être motivés avant tout par des considérations partisanes, qui passeraient alors devant les enjeux de développement local. Afficher la défense des intérêts communaux ou les compétences personnelles des candidats vise à ne pas s’aliéner les électeurs dont beaucoup estiment que les affaires municipales, surtout dans les petites villes, doivent échapper aux conflits partisans.
Contrairement aux grandes villes, les partis jouent effectivement un rôle secondaire dans ces bourgs où les trajectoires des élus se construisent dans le cadre de leurs activités professionnelles, syndicales ou associatives. Peu de candidats sont rétribués pour leurs fonctions militantes avant d’être élus. Lorsqu’ils deviennent maires, ils cessent ou réduisent une activité professionnelle qui n’a souvent pas de rapport direct avec le métier politique.
Souvent tues, les étiquettes politiques n’en sont pas moins présentes par intermittence dans les petites villes, contrairement à ce qui se passe dans les villages qui les entourent. En réalité, les élections municipales mettent le plus souvent en compétition au moins une liste associée à la gauche et une liste plus conservatrice. Les forces de gauche sont les plus enclines à mobiliser des marqueurs politiques à certaines périodes, notamment à la Libération et dans les années 1970. Mais c’est aussi le cas à droite, surtout dans les années 1980 avec le Rassemblement pour la République (RPR) qui cherche à contester l’autre parti conservateur bien implanté localement, l’Union pour la démocratie française (UDF), et à jouer sur l’opposition à la présidence de François Mitterrand. Puis lorsque le Front national (devenu Rassemblement national, RN) parvient à constituer des listes dans un contexte de droitisation des électeurs et de déclin de la gauche.
Indices de politisation
Même lorsqu’il n’y a pas de logo de parti sur le matériel électoral, les électeurs peuvent classer politiquement les listes grâce à des indices mis ou non volontairement en avant par les candidats et leurs soutiens. En effet, les affinités politiques personnelles des candidats sont largement connues au sein des espaces d’interconnaissance que constituent les petites villes. Des engagements publics (syndical, religieux, associatif), le choix de l’école privée ou publique pour ses enfants, le type de fréquentation amicale ou encore la profession peuvent être également mobilisés pour situer politiquement un candidat.
Des opinions politiques sont attribuées aux candidats selon des discussions informelles, des propos rapportés, des informations données par les membres de la famille, des voisins ou des commerçants. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains candidats estiment ne pas avoir eu besoin d’afficher leur proximité partisane lors de la campagne. Comme nous l’a exposé le maire d’une commune d’environ 4 000 habitants, membre du parti Les Républicains :
« Les gens ici savent ce que je pense. »
Cette façade apolitique lors de la campagne ne trompe personne, ni les habitants, ni le sous-préfet qui accorde des nuances politiques aux candidats, ni les journalistes qui peuvent indiquer les appartenances politiques des compétiteurs dans la presse locale. En outre, l’attitude des candidats dans d’autres scènes électorales que celle des scrutins municipaux contribue aussi à nourrir les identifications politiques. Les liens qu’ils entretiennent avec le conseiller général, le député ou le maire de la grande ville voisine (dont l’affiliation partisane est connue), donnent des indications de positionnement. Ces liens apparaissent au grand jour lors de la constitution de comités de soutien.
Par ailleurs, le soutien d’un parti est souvent nécessaire dès que l’on dépasse l’échelle communale, un niveau où se projettent souvent les maires des petites villes. Lorsqu’ils sont candidats pour les scrutins cantonaux, législatifs ou régionaux, ils mobilisent alors des appartenances partisanes, celles-là mêmes qu’ils n’affichent guère dans la compétition municipale.
Les élus ruraux face à la croissance du vote RN et à l’abstention
D’après mes recherches, l’appartenance des candidats à un courant politique ne constitue pas véritablement un handicap à l’élection. Elle le devient lorsqu’elle est ostensiblement affichée et qu’elle se cumule avec une absence d’attaches locales, dans le cas par exemple de parachutages. Ce sont les marques de dévouement pour la collectivité et surtout le prestige social, assuré par les parcours professionnels et les réussites personnelles, qui semblent jouer un rôle important dans la construction de l’éligibilité. Les électeurs s’en remettent à des personnes perçues comme compétentes et dévouées pour gérer la collectivité locale et obtenir des subventions, dans un contexte de professionnalisation de la gestion communale.
Il peut ainsi exister un décalage important entre l’orientation politique du maire de la commune et l’expression majoritairement exprimée par les habitants lors des élections nationales. Ce décalage est devenu systématique depuis les années 2000, car la population des campagnes vote de plus en plus pour l’extrême droite lors des élections législatives et présidentielles. Or on ne compte en effet que 16 municipalités dirigées par le RN, bien loin de son poids aux autres élections.
Les élus ruraux font face à la croissance du vote pour le Rassemblement national mais aussi au désintérêt grandissant des habitants vis-à-vis des enjeux municipaux : l’abstention augmente régulièrement depuis une vingtaine d’années lors des scrutins municipaux. Elle reste moins importante dans les petites communes que dans les grandes villes, mais cette démobilisation électorale signale bien que la crise de la représentation politique touche également l’échelon local, y compris en l’absence de présence des partis politiques. Ces derniers ne sont pas à l’origine de la distance grandissante entre les élus ruraux et leurs administrés. Au contraire, ce décalage est en partie nourri par la fragilisation des réseaux militants. Désormais les partis sont surtout organisés dans les grandes villes, il existe rarement des sections dans les petites villes. La présence syndicale s’est également réduite alors que son maintien permet une meilleure implication des classes populaires dans la vie politique locale.
La complexification de la gestion locale est l’un des facteurs de la distance grandissante entre les élus et leurs administrés. Le développement de l’intercommunalité et la nécessité d’une recherche incessante de financement pour contrebalancer la baisse de la dotation d’État favorisent les élus pouvant faire valoir des compétences gestionnaires, acquises dans leurs parcours scolaires et professionnels. Les conseils municipaux peuvent être divers socialement, mais les postes de maire sont très rarement occupés par des catégories populaires pourtant majoritaires dans la population locale.
La masse des habitants s’approprie difficilement les enjeux intercommunaux d’autant qu’ils sont peu abordés dans les campagnes électorales. Or le centre de gravité du pouvoir local se déplace vers des structures intercommunales, instances dépolitisées dont la technicité dépossède les populations mais aussi les maires des villages. Ce sont en effet les maires des petites villes, essentiellement des hommes issus des classes moyennes et supérieures, qui se trouvent le plus souvent à la tête des intercommunalités rurales.
Julian Mischi est l’auteur de Des élus en campagne, Presses de Sciences Po, 2025.
![]()
Julian Mischi a reçu des financements de l’INRAE et de la région Bourgogne-Franche-Comté.
– ref. Les élus ruraux sont-ils vraiment apolitiques ? – https://theconversation.com/les-elus-ruraux-sont-ils-vraiment-apolitiques-271564