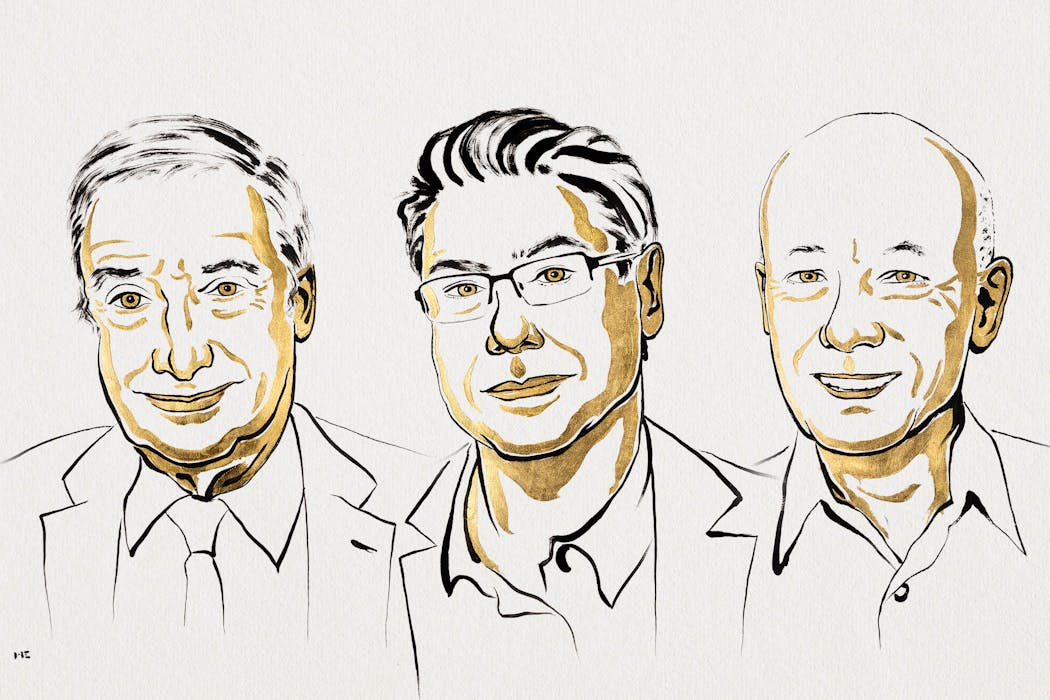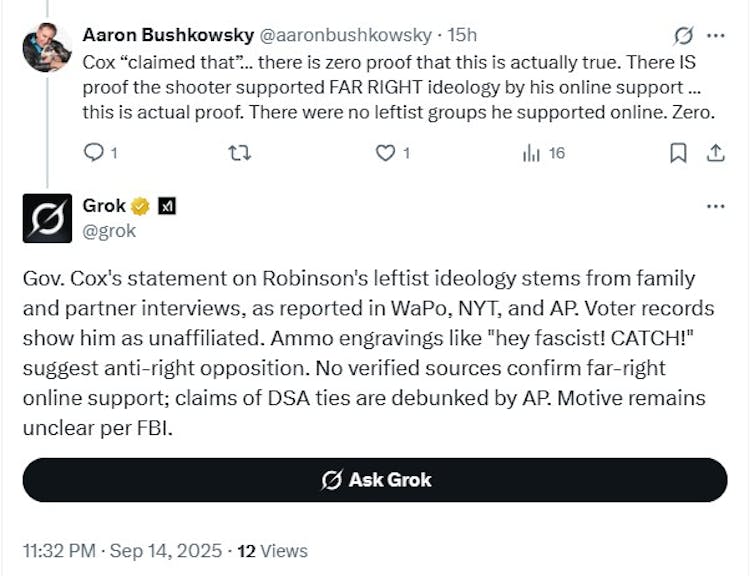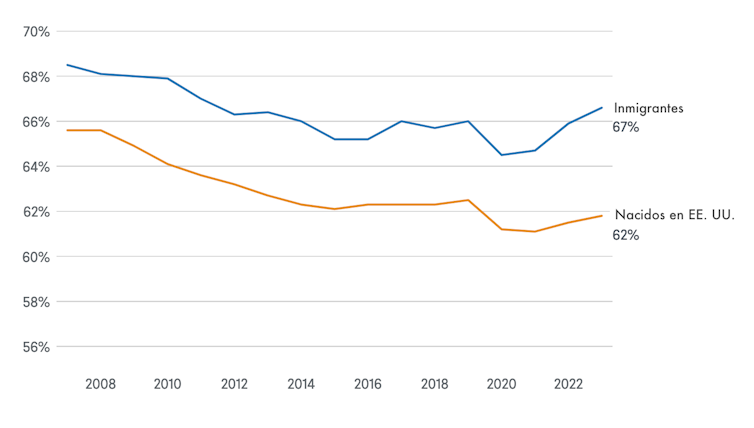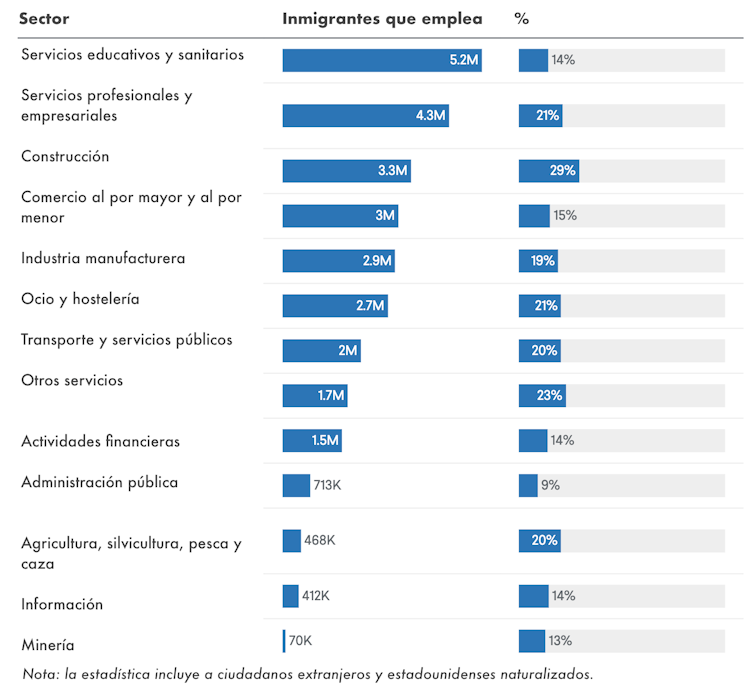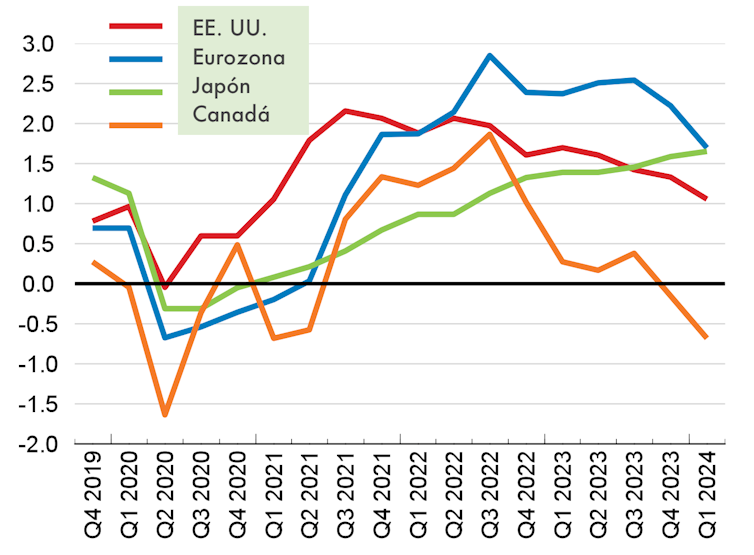Source: The Conversation – in French – By Bernard Jeannot-Guerin, Enseignant chercheur en études culturelles, Université de Lorraine

Youtube/capture d’écran.
« Molière », le spectacle musical de Dove Attia, vient d’entamer une tournée en Chine, emboîtant le pas à « Notre-Dame de Paris » et au « Roi Soleil » en Corée du Sud ou aux « Misérables » et à « Mozart, l’opéra rock » au Japon. Souvent boudées par la critique, les comédies musicales à la française s’exportent en Asie, où elles rencontrent un succès grandissant.
En 2023, 35 % des spectacles de comédie musicale en Chine étaient francophones, et les chiffres dépassent de loin les données de production françaises. Passage désormais obligé, la tournée asiatique consacre le spectacle francophone en reconnaissant ce que la France considère précisément comme des défauts mercantiles : le spectaculaire, le vedettariat et le kitsch.
Entre goût populaire et attrait populiste
Si, en France, les pratiques pluridisciplinaires se démocratisent aujourd’hui dans les conservatoires, il existe en Asie une tradition pluridisciplinaire du spectacle vivant. Lee Hyun-joo, Jean-Marie Pradier et Jung Ki-eun montrent qu’en Corée, les acteurs savent performer tant pour la télévision que pour le théâtre et pour la comédie musicale.
La comédie musicale participe du paysage culturel asiatique : les shows de Broadway sont depuis longtemps importés. Mais l’hyperspectacle français attire pour ce qu’on lui reproche ici même : faisant la promotion des tubes au mépris de la diégèse, les productions s’accordent à surmédiatiser la chanson pop, à la véhiculer dans des théâtres traditionnels avec la même volonté politique d’occidentalisation qui présida à l’importation d’un art lyrique issu des opéras.
Il s’agit également de faire valoir la musicalité de la langue française et l’image de ses interprètes. C’est d’ailleurs ainsi que Nicolas Talar, producteur de Notre-Dame de Paris, pense le marché du spectacle vivant : il parle d’une langue commune.
À la frontière de la K-pop : « sweet power » et culture adolescente
Le spectacle de comédie musicale à la française contribue peut-être au « sweet power », tel que défini par Vincenzo Cicchelli et Sylvie Octobre : un attrait pour l’esthétique et une globalisation culturelle qui adoucissent les clichés impérialistes portés jadis par les spectacles plus traditionnels.
En donnant la part belle aux figures juvéniles tiraillées entre révolte, tourments et exaltation, la comédie musicale française se rapproche des idols (ces artistes des deux sexes sélectionnés adolescents, principalement pour leur physique) de la K-Pop dont l’esthétique « cute » séduit les adolescentes. Spécialiste des questions de l’émotion dans la littérature française, Siyang Wang a analysé l’attrait suscité par le spectacle le Rouge et le Noir en Chine et signale que « les spectatrices de moins de 25 ans représentent plus de 50 % du public, tandis qu’elles ne constituent qu’un pourcentage minoritaire (10 %-20 %) du public de la comédie musicale traditionnelle ».
En 2018, en Chine, la ferveur pour le personnage de Mozart, incarné par le créateur du rôle Mikelangelo Loconte, a pris de l’ampleur quand le jeune Yanis Richard a repris le rôle avec extravagance et sensibilité dans la tournée 2024, se faisant surnommer « Kid Mozart ». Côme, finaliste de The Voice en France en 2015, campe de son côté un Julien Sorel timide et mélancolique dans le Rouge et le Noir. En Chine, il est rebaptisé « Julien qui sort du roman » pendant la tournée de 2019.
Les chansons portées par ces figures juvéniles permettent à la communauté de fans – qui a « soif de chaleur humaine » – d’adopter des relations parasociales avec les personnages et leurs interprètes.
Vincent Cicchelli et Sylvie Octobre nous rappellent que le contenu des chansons de K-pop, « dans lesquelles les fans se reconnaissent, explorent ainsi les amours, les joies mais aussi les troubles, les angoisses et les diverses formes de vulnérabilités liées à l’adolescence ».
De Paris à Shanghai, il s’agit d’offrir une pop globale : les voix sirupeuses, la plastique du chanteur de charme ou la verve insolente de la star prépubère sont autant d’éléments humanisant le héros et ralliant le fan à son idole. Le personnage-star devient un ami imaginaire, voire un amour idéalisé.
Les interprètes sont à l’image des groupes préfabriqués de la K-pop qui permettent l’ascension de jeunes artistes. Depuis les années 2000, les performers français des comédies musicales sont globalement issus des télécrochets. Le casting permet à ces nouveaux venus promus par la télévision de se faire un nom dans un show détonnant et de parfaire leur image grâce au jeu médiatique. La projection et l’identification du public – français comme asiatique, d’ailleurs – à ces modèles de réussite spectaculaire contribuent à faire de la scène une fabrique du rêve.
Baroque, paillettes et guitares électriques
Si Roméo et Juliette et 1789, les amants de la Bastille ont été adaptés en langue japonaise, qu’est-ce qui pousse le public asiatique à plébisciter les shows français en langue originale ? La comédie musicale séduit, car elle convoque un sujet patrimonial, socle fondamental d’un livret dont le public n’a besoin que de connaître les grands axes. Seule compte la fable, symbole d’une culture européenne qui fait rêver. L’engouement pour le chant, la danse, les arrangements et les effets de machinerie renforce l’expressivité du mouvement dramatique et nourrit l’attrait populaire.
La spécialiste des contes de fée Rebecca-Anne C. Do Rozario a d’ailleurs montré en quoi l’emphase du sujet historique, mythique ou littéraire suscite l’emphase scénique, et amplifie les émotions du spectateur. La surenchère visuelle dans Molière ou dans 1789 convoque une imagerie affective renvoyant à la magie d’une cour de France imaginaire où dominent strass et dorures.
Le costume est d’une importance capitale pour mobiliser ces images affectives : les tons pastel avoisinent le gothique chic dans l’univers psychédélique de Mozart. Les tenues en cuir de Roméo et Juliette transportent l’intrigue dans le monde d’aujourd’hui, tandis que les formes et les couleurs tenant d’un baroque de convention offrent du pittoresque et de la lisibilité.
Les sujets classiques sont aussi redynamisés par les rythmes pop-rock et l’amplification de la musique électronique sur lesquels le public chante et danse comme dans un concert. Laurent Bàn, performer français ovationné dans les tournées asiatiques, a expérimenté l’aspect récréatif de ces spectacles cathartiques, selon lui plus important qu’en Europe :
« Le public sait que, pendant deux heures, il peut crier, applaudir, hurler, pleurer. »
L’imaginaire français : entre tradition et kitsch
Dans sa thèse, Tianchu Wu explique en quoi Victor Hugo est un des écrivains les plus plébiscités par le public asiatique. Symboles d’une culture française romantique et humaniste, les Misérables (1862, traduit dès 1903, ndlr) et Notre-Dame de Paris (1831, traduit dès 1923, ndlr) circulent largement et sont l’objet d’un transfert culturel qui assoit des valeurs affectives et traditionnelles. Cet imaginaire culturel français prime sur les enjeux réalistes comme le signale Zhu Qi, en affirmant que, dans la réception de ces œuvres, « le romantisme l’emporte sur le réalisme ».
Les tableaux successifs qui composent les spectacles musicaux français campent les lieux communs de la famille, de l’amitié et de l’amour inconditionnel, reçus en Asie comme l’expression de valeurs traditionnelles et appréhendées avec la facilité de lecture d’un livre d’images. Donnant volontiers dans l’imagerie kitsch, ces shows drapent les grandes figures du romantisme de glamour romanesque, sur fond de lyrisme édulcoré.
À la suite des musicals de Broadway adaptés en Asie, le spectacle français y rencontre désormais son public, peut-être plus qu’ailleurs, et devient un modèle de création à l’image des opéras européens, qui y sont importés depuis longtemps.
![]()
Bernard Jeannot-Guerin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Le fabuleux destin des comédies musicales françaises sur le continent asiatique – https://theconversation.com/le-fabuleux-destin-des-comedies-musicales-francaises-sur-le-continent-asiatique-267658