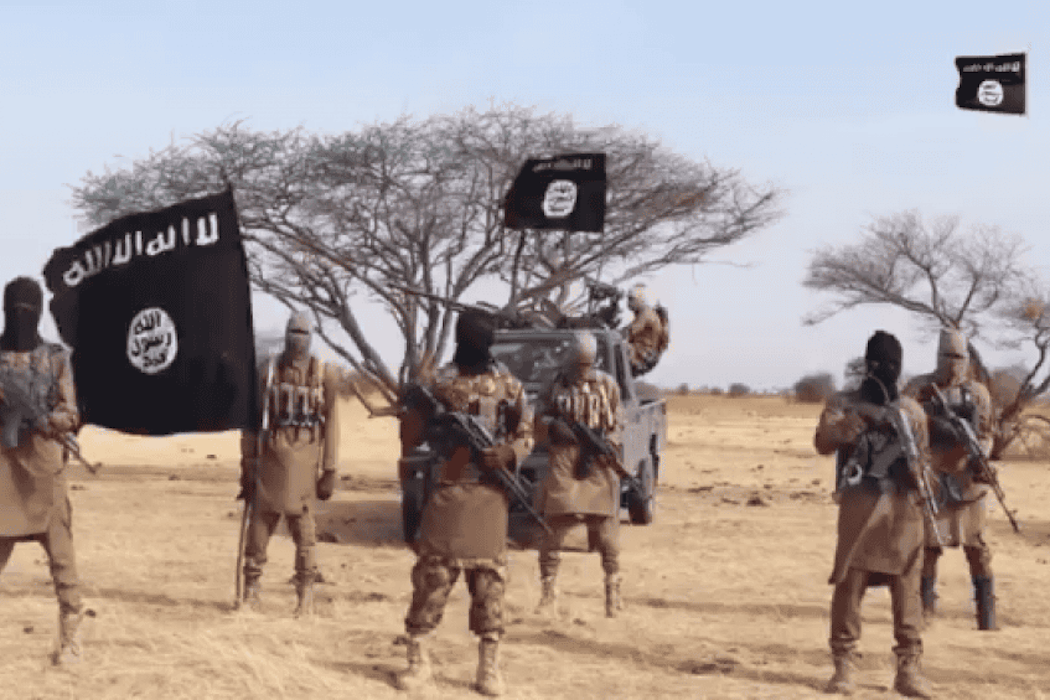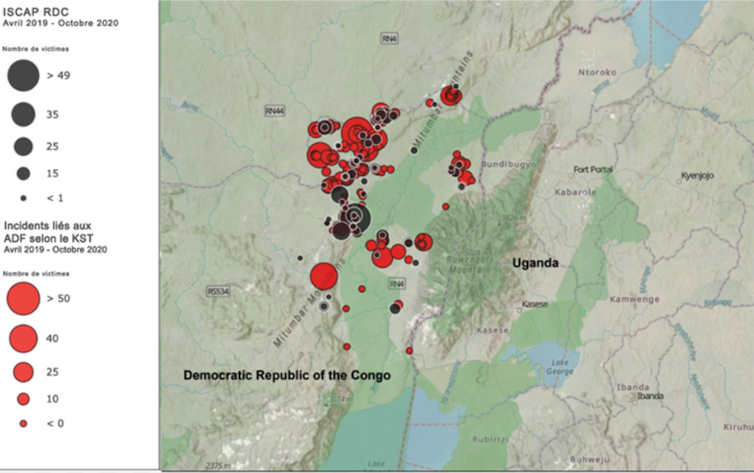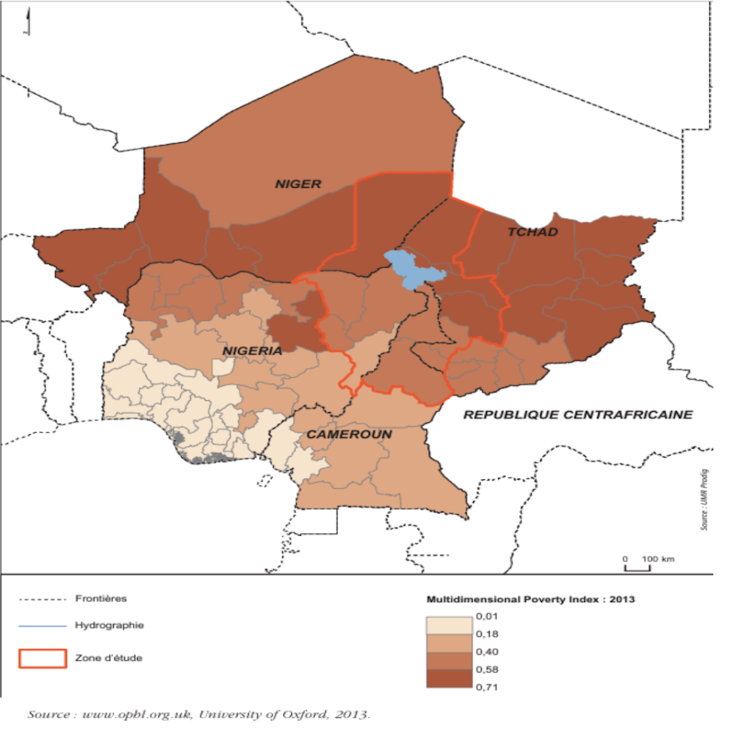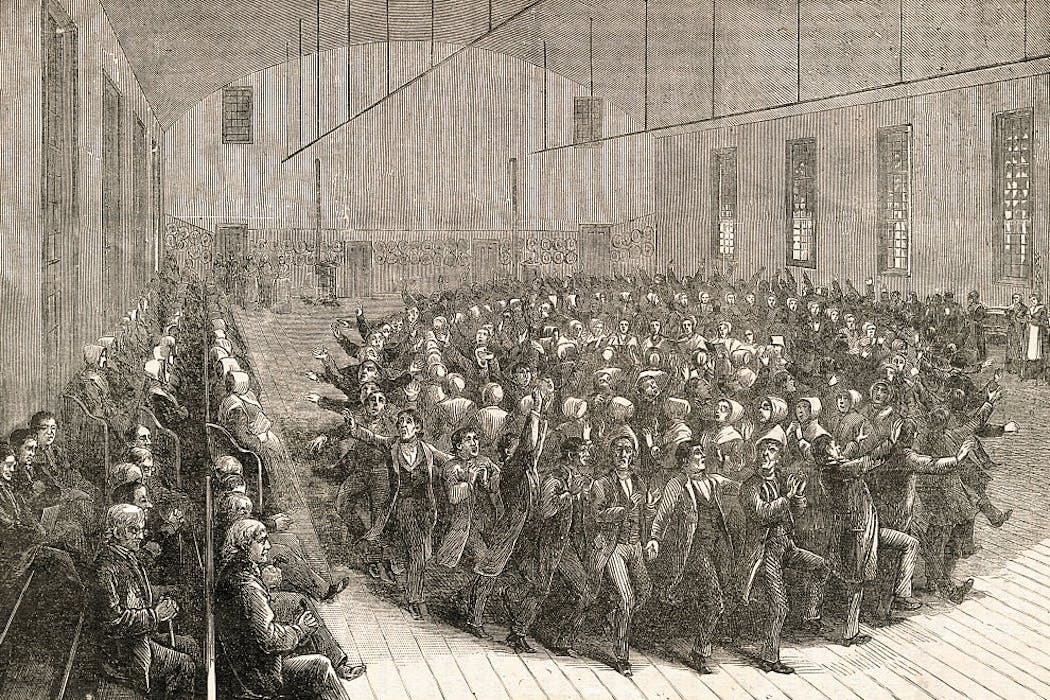Source: The Conversation – in French – By Frédéric Keck, Anthropologie, EHESS, CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France, Auteurs historiques The Conversation France
La dermatose nodulaire, rarement mortelle mais très contagieuse, flambe depuis quelques semaines dans les élevages bovins français. Face à sa diffusion rapide, les autorités ont recours à l’abattage et à la vaccination. La contestation de l’abattage systématique par les éleveurs révèle des tensions profondes dans un monde agricole déjà en crise.
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC), maladie infectieuse qui touche les bovins, a beaucoup fait parler d’elle au cours des dernières semaines. Le virus qui la cause, Capripoxvirus lumpyskinpox, se diffuse dans le sang des animaux et provoque de fortes fièvres et des nodules douloureux pour les animaux. La mortalité est faible, de 1 à 5 % environ des animaux infectés, mais le problème principal tient à sa contagiosité. Les insectes piqueurs (mouches stomoxes, moustiques, taons…) et les tiques transmettent ce virus d’un troupeau à un autre. Le virus peut également survivre plusieurs mois dans les croûtes des animaux, qui se conservent dans les environnements peu éclairés.
Historiquement présente en Afrique, la DNC a été observée en Afrique du Nord dès juin 2024, puis s’est propagée en Europe. La DNC a été détectée en France pour la première fois le 29 juin 2025 en Savoie. Pour contrôler la propagation de la maladie, les autorités se sont à la fois appuyées* sur une politique d’abattage (environ 1 000 bovins) et de vaccination (environ 300 000 doses).
Mais la colère gronde chez les agriculteurs, qui s’opposent désormais aux abattages massifs. Le 10 décembre 2025, des éleveurs dans l’Ariège se sont opposés à l’abattage de 200 bovins touchés par la DNC et ont lancé un mouvement social d’occupation des autoroutes qui a gagné une large part du sud-ouest de la France. Pour limiter ce mouvement, la ministre de l’agriculture Annie Genevard a engagé le financement de la vaccination d’un million de bovins.
À lire aussi :
Ce que la crise agricole révèle des contradictions entre objectifs socio-écologiques et compétitivité
L’enjeu : limiter le risque de transmission à l’humain
Pour comprendre cette mobilisation, il faut d’abord rappeler la distinction entre les zoonoses et les épizooties.
Les zoonoses, tout d’abord, sont des maladies infectieuses qui se transmettent des animaux sauvages aux animaux domestiques, puis aux humains. Elles font l’objet de mesures sanitaires sévères pour éviter la transmission aux humains de pathogènes dont les conséquences immunitaires sont inconnues.

Animalia.bio, CC BY-SA
La grippe aviaire, hautement pathogène, et le Covid-19 sont deux exemples de zoonoses. La première a été transmise par les oiseaux sauvages aux volailles domestiques, avec une mortalité de 60 % lorsqu’elle se transmet aux humains. Le second l’aurait été par l’intermédiaire des chauves-souris et notamment les chiens viverrins, avec une mortalité de 0,5 % lorsqu’elle se transmet aux humains.
Dans ce contexte, l’abattage préventif peut faire partie de l’arsenal déployé par les autorités sanitaires :
-
En 2022, 50 millions de volailles avaient été abattues dans l’ouest de la France pour contenir la grippe aviaire.
-
En 2020, 12 millions de furets avaient été abattus au Danemark pour éviter l’apparition d’une nouvelle forme de Covid-19, au moment où les premiers vaccins humains étaient disponibles.
On peut noter que ces deux virus zoonotiques (H5N1 et SARS-CoV-2) sont venus de Chine, dont les fortes populations animale et humaine connectées par les marchés aux animaux vivants sont favorables à l’émergence de nouveaux virus depuis une trentaine d’années.
À lire aussi :
Maladies émergentes d’origine animale : d’où viendra la prochaine menace ?
De l’autre côté, les épizooties sont des maladies infectieuses transmises par les animaux sauvages aux animaux domestiques, mais sans se transmettre aux humains.
-
Par exemple, la peste porcine africaine est transmise aux cochons par les phacochères et des sangliers, avec une mortalité d’environ 80 % – on estime qu’elle a causé la mort de la moitié du cheptel de porcs en Chine en 2019.
-
La dermatose nodulaire contagieuse, qui se transmet des buffles aux vaches, est un autre exemple d’épizootie.
Ces deux maladies infectieuses ont été découvertes dans les années 1930 en Afrique de l’Est. En effet, les colonisateurs anglais ont implanté dans cette partie du continent les techniques d’élevage industriel qui avaient été développées en Europe au cours du siècle précédent. Or, pour des petits élevages pastoraux de cochons ou de vaches, les épizooties ont peu de conséquences. Mais dans les élevages industriels, elles causent des ravages.
Ainsi, la première grande épizootie dans l’histoire de la médecine vétérinaire est la peste bovine, qui a ravagé l’Europe au XIXᵉ siècle du fait du commerce international du bétail, en commençant par l’Angleterre puis l’Afrique de l’Est au début du XXᵉ siècle. Elle est aujourd’hui considérée comme la maladie du bétail la plus meurtrière de l’histoire.
C’est pour contrôler la peste bovine qu’a été crée l’Office international des épizooties (OIE) à Paris en 1920. La maladie a été maîtrisée grâce à des politiques d’abattage et de vaccination qui ont conduit à son éradication en 2001. En 2003, l’organisation intergouvernementale a été renommée Organisation mondiale de la santé animale.
À lire aussi :
Peste porcine africaine : la flambée des cas en Italie questionne la stratégie européenne d’éradication
Les virus ignorent la distinction faite par les humains entre épizootie et zoonose. Un virus comme celui de la grippe peut devenir épizootique ou zoonotique selon les circonstances, en fonction de ses mutations. Or, une épizootie est gérée comme un problème économique, par le ministère de l’agriculture, alors qu’une zoonose est gérée comme un problème sanitaire par le ministère de la santé.
Pourquoi les politiques d’hier sont inacceptables aujourd’hui
Le contrôle des épizooties est essentiel pour garantir les prix sur le marché international de la viande. En effet, un État indemne d’une épizootie qui circule dans d’autres pays peut vendre ses animaux (vivants ou morts) à un prix plus élevé que ses concurrents s’ils sont infectés.
Mais reste la question de fond : pourquoi cette politique, qui a fonctionné pour d’autres épizooties passées, ne semble-t-elle plus acceptable aujourd’hui ? La mobilisation des éleveurs du sud-ouest de la France s’inscrit dans un triple contexte politique.
-
D’une part, les négociations entre l’Union européenne et le Mercosur concernant les produits agricoles sont perçues par les éleveurs français comme préjudiciables à leurs intérêts. Autrement dit, la DNC survient dans un contexte déjà tendu et a, en quelque sorte, constitué « la goutte d’eau qui fait déborder le vase ».
-
D’autre part, les dernières élections syndicales dans le milieu agricole ont été favorables à la Confédération paysanne et à la Coordination rurale et défavorables au syndicat majoritaire, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Or, le protocole sanitaire actuel a été négocié par le gouvernement avec ce syndicat majoritaire, ce qui a conduit à une alliance inédite entre les deux syndicats minoritaires, situés respectivement à la gauche et à la droite de l’échiquier politique.
-
Enfin, la période des vacances de Noël est favorable à une démonstration de force de la part du monde agricole afin d’obtenir rapidement la fin des abattages et la vaccination de tous les bovins de la part d’un gouvernement fragilisé par l’absence de budget national.
Depuis début décembre 2025, les médias français se sont emparés de ce sujet en diffusant des images spectaculaires d’occupations d’espaces publics et de blocages de routes et de voies ferrées notamment par des agriculteurs venus avec leurs tracteurs et leurs vaches.
À lire aussi :
Colère des agriculteurs européens : traiter l’origine des maux pour éviter la polarisation
Des vaches abattues ramenées à un statut de marchandises
Résultat : le débat politique sur les modes d’élevage des animaux, entre un modèle industriel tourné vers l’exportation et un modèle de plus petite taille tourné vers la consommation locale, se tient désormais dans l’urgence. Il aurait pourtant pu avoir lieu lors des Assises du sanitaire animal qui se sont tenues au niveau national en septembre 2025.
Le nœud du problème ? Le gouvernement demande aux éleveurs de respecter « la science » sans établir les conditions pour une démocratie sanitaire et technique des maladies animales. Il s’agirait de mettre tous les acteurs de l’élevage autour de la table pour évaluer les différentes méthodes scientifiques garantissant la santé de leurs élevages.
Les maladies animales, qu’elles soient épizootiques (comme la DNC) ou zoonotiques, montrent que les animaux ne sont pas seulement des marchandises que les humains peuvent détruire lorsqu’elles ne satisfont plus aux conditions du marché. Ce sont des êtres vivants avec lesquels se sont constitués des savoirs (notamment génétiques) et des affects.
Cet écart entre l’animal-marchandise et l’animal-être vivant s’exprime de diverses façons :
-
Pour les zoonoses, les consommateurs ont peur d’être tués par la viande qu’ils mangent : on a pu parler ainsi de « vache folle » dans les années 1990 ou de « poulets terroristes ».
-
En cas d’épizootie, lorsqu’un éleveur doit faire abattre pour des raisons sanitaires un troupeau qui n’a pas atteint la maturité : on parle alors de « dépeuplement », comme si le « repeuplement » n’était qu’une mesure technique.
-
Le traitement médiatique de la crise de la « vache folle » a ainsi donné lieu à des images bien plus spectaculaires que lors de la crise de la fièvre aphteuse, médiatisée au début des années 2000. La différence tient au fait que l’encéphalopathie spongiforme bovine passe aux humains en causant la maladie de Creutzfeldt-Jakob, alors que la fièvre aphteuse ne se transmet pas aux humains. Les abattages massifs réalisés pour contenir la fièvre aphteuse, elle aussi très contagieuse mais peu létale, semblent inacceptables aujourd’hui.
Les gouvernements savent s’appuyer sur des savoirs virologiques et épidémiologiques pour anticiper les déplacements des populations d’humains, d’animaux et de vecteurs qui vont causer les maladies infectieuses actuelles et à venir. Le réchauffement climatique favorise ainsi la persistance en décembre des mouches porteuses de la DNC.
Mais les autorités ne peuvent pas prédire les réactions des éleveurs et de ceux qui les regardent sur les réseaux sociaux pleurer la mort de leurs vaches. C’est bien ce rapport à l’animal qui se joue dans la crise agricole déclenchée par la dermatose nodulaire contagieuse.
![]()
Frédéric Keck ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Dermatose nodulaire : comprendre les raisons de la mobilisation agricole – https://theconversation.com/dermatose-nodulaire-comprendre-les-raisons-de-la-mobilisation-agricole-272363