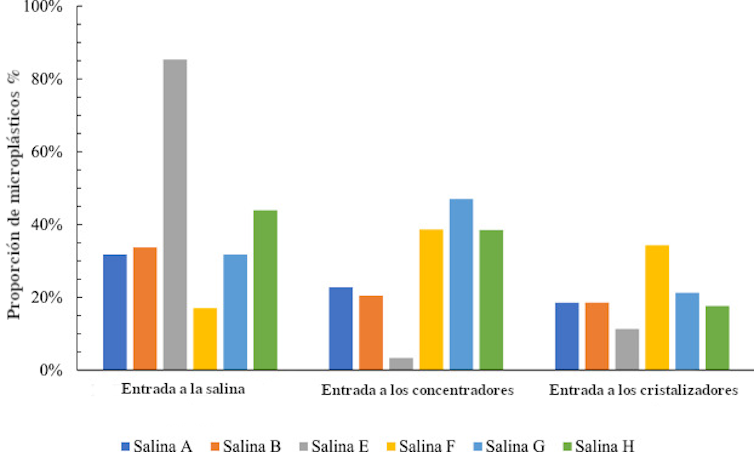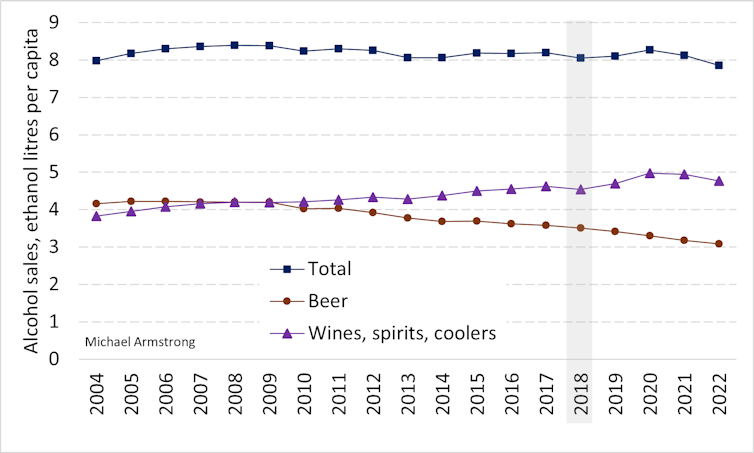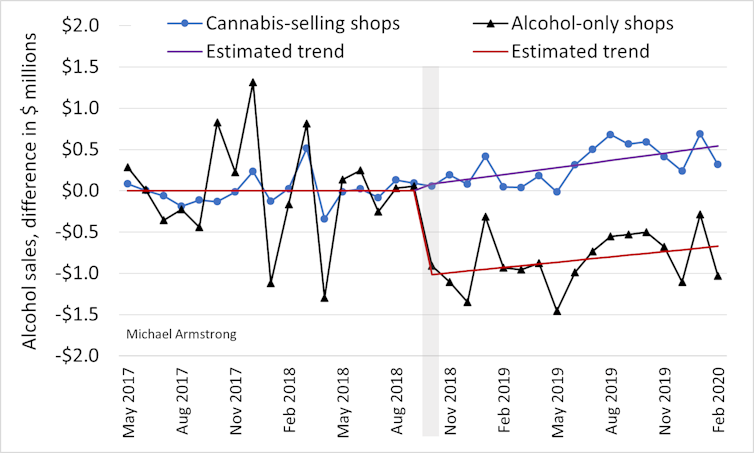Source: The Conversation – (in Spanish) – By Silvia López Larrosa, Profesora del departamento de Psicología, Universidade da Coruña
El verano se extiende ante nosotros. Dos meses de vacaciones escolares y la pregunta: ¿qué haremos en este tiempo? Si hay niños y adolescentes en casa, a menudo la pregunta incluye cierta angustia adulta, pues convivir con los más pequeños cuando nosotros estamos ocupados y ellos ociosos puede convertirse en un reto.
Pero las largas vacaciones infantiles del verano ofrecen grandes oportunidades para hacer todas las cosas que no dan tiempo durante el curso, muchas de ellas sin necesidad de moverse del lugar donde vivimos, pagar campamentos caros o hacer largos viajes.
Encontrar y cultivar nuevos intereses
Una posibilidad es aprender algo nuevo, siempre dependiendo de los intereses de cada persona, de las circunstancias familiares y de las opciones que se ofrezcan en el lugar en que nos encontremos.
Puede ser desde tareas tan asequibles como mantener un diario o ejercitar la imaginación escribiendo historias cotidianas o inventadas, hasta recuperar el arte analógico de hacer fotos, pasando por sencillamente visitar museos.
Leer más:
Cómo mejorar la convivencia en casa durante las vacaciones
El verano es el tiempo perfecto para despertar y cultivar la pasión por la lectura. Aprender rimas, en el caso de los más pequeños, escuchar audiolibros en los viajes en coche, leer en voz alta un rato cada día, intercambiar libros y comentarlos entre los miembros de la familia… todas estas son maneras de ayudar a cimentar un hábito lector, algo con un innegable impacto positivo en el cerebro, el vocabulario, la imaginación o la reducción del estrés, además de que contribuirá a un mejor rendimiento académico cuando comience el nuevo curso.
Redescubrir la naturaleza
Los estudios señalan que el contacto con la naturaleza reporta beneficios para la salud física y mental y mejora el bienestar a cualquier edad. El verano parece una época propicia para reencontrarse con la naturaleza y disfrutar de ella y de la familia.
En la naturaleza podemos realizar actividades físicas como deportes acuáticos, tanto en el mar como en ríos o embalses: nos obligan a aprender técnicas y movimientos para evitar lesiones o accidentes, y son un ejercicio perfecto para el calor. Y en el medio terrestre se puede caminar, correr, montar a caballo o andar en bicicleta.
Leer más:
Niños sin miedo al agua: prevenir los ahogamientos desde la confianza
Atención y ejercicio con plantas y animales
En nuestros paseos por parques, zonas verdes o bosques podemos ver pájaros, flores, árboles, huellas de animales. Si estos paseos se hacen con personas que nos ayuden a leer en la naturaleza y a escucharla, una simple salida al campo puede convertirse en una gran aprendizaje, que nos reporta serenidad y mejora la atención.
Si esta salida se realiza con animales como los caballos, mejoramos nuestro equilibrio, ejercitamos músculos y nos vinculamos con otro ser, al que podemos ensillar, desensillar, bañar o cepillar.
Desarrollar la psicomotricidad fina
En verano, no solo podemos reconectar con la naturaleza, sino que es posible equilibrar la actividad física con otras alternativas de motricidad fina como aprender a coser, dibujar o colorear, hacer manualidades con barro, plastilina, arcilla, hacer cestos, tejer, o usar abalorios para hacer adornos.
Algunas de estas actividades suponen emplear nuevos materiales, pero para otras se usan elementos que nos han acompañado desde hace mucho como el barro, los hilos o el mimbre. Por ello, son una oportunidad para descubrir técnicas antiguas de bordado, cestería o alfarería, y para hablar con nuestros mayores y con los artesanos que mantienen estas tradiciones, que a veces se encuentran precisamente en los lugares donde veraneamos, en pueblos con una tradición, historias y unas costumbres que podemos aprender.
Idiomas veraniegos
En algunos de estos lugares, también es posible adentrarse en su lengua. De hecho, uno de los propósitos del verano suele ser mejorar en un segundo idioma. Viajar permite usar dicha lengua y descubrir formas de vida y costumbres más o menos diferentes.
Para los que prefieran quedarse pero quieran familiarizar el oído a otro idioma, se pueden sintonizar canales de televisión, ver películas, o aprender letras de canciones en otra lengua. Podemos incluso perfeccionar la propia a través, por ejemplo, de clases de oratoria.
Aprender o practicar un instrumento
Un idioma universal es el de la música, que activa nuestro cerebro, produce beneficios atencionales e influye en nuestro estado de ánimo. Los niños más pequeños pueden experimentar creando instrumentos caseros, con elementos como cucharas y vasos, un recipiente con legumbres o una tapa.
Podemos conocer un instrumento para ver si es el que nos gustaría tocar (escuchando, viendo vídeos o localizando a personas que lo toquen) o perfeccionar nuestra técnica en caso de que ya sepamos, adentrarnos en la música de épocas diferentes o en el folclore local, aprender o crear canciones, movernos al ritmo de acordes nuevos e incluso, por qué no, inventar una coreografía.
Tiempo para cocinar y comer mejor
En verano, aunque los adultos estén trabajando, los niños y adolescentes de la casa disponen de más tiempo para disfrutar comprando lo que se va a cocinar, incluso de cultivar a pequeña escala. Aprender a cocinar, a reconocer los alimentos y de dónde proceden son sin duda conocimientos valiosos para adultos y niños que impactan en su salud, autonomía, planificación y organización.
Desaprender también es importante
Como hemos visto, el verano puede ser una época muy propicia para aprender, pero también existe la oportunidad de desaprender. Por ejemplo, desaprender una dependencia excesiva de la tecnología y desaprender la tendencia a hacer las actividades cotidianas a toda prisa y sin pararnos a pensar. Prestar atención a lo que hacemos y disfrutar con ello nos ayuda a estar presentes en el momento y desconectar de los estímulos digitales.
Todo el tiempo que dediquemos a estar en la naturaleza en familia, o permitiendo que los niños exploren y aprendan por sí solos, jugando, haciendo deporte, expandiendo su imaginación, cocinando, escuchando a las personas mayores, haciendo manualidades, cantando o tocando un instrumento, siendo conscientes de dónde estamos y lo que hacemos, es tiempo de calidad que le habremos robado a las pantallas. No se trata de prohibirlas o desecharlas, pero sí de aprovechar para reequilibrar su presencia en nuestra vida.
![]()
Silvia López Larrosa no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Actividades veraniegas para niños y adolescentes al alcance de todos – https://theconversation.com/actividades-veraniegas-para-ninos-y-adolescentes-al-alcance-de-todos-259150