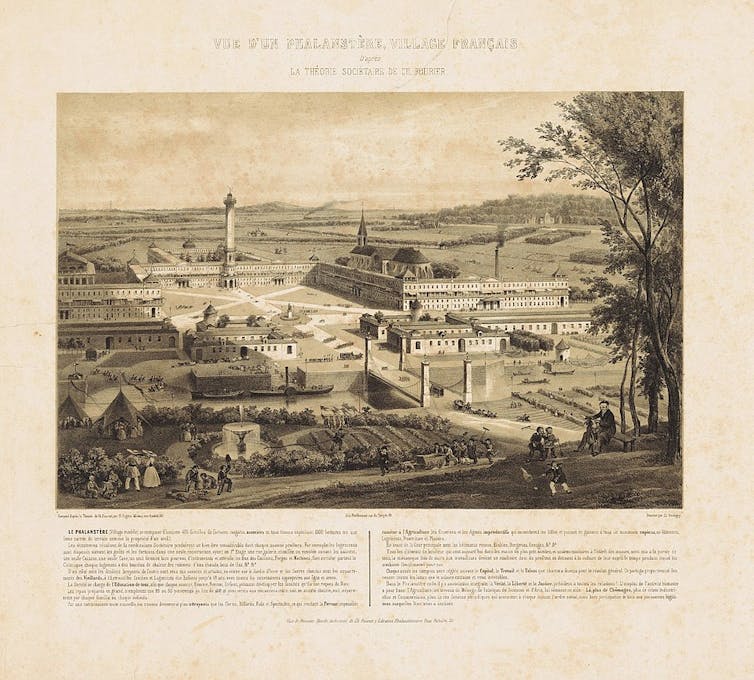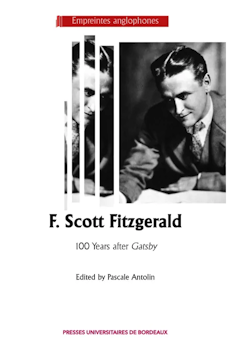Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Miguel Soriano del Castillo, Catedrático de Nutrición y Bromatología del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universitat de València

El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción, una de las festividades marianas más extendidas y arraigadas del calendario litúrgico. Aunque para muchos se trata simplemente de un día festivo que anuncia la llegada inminente de la Navidad, si se observa con detenimiento, esta fecha ha actuado durante siglos como un punto de inflexión cultural: marca el inicio de un tiempo de preparación, de expectación y, sobre todo, de una profunda transformación alimentaria que todavía hoy podemos rastrear en los hábitos gastronómicos de diversos países.
Así, en Colombia, la noche del 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se celebra el Día de las Velitas, que consiste en encender velas y compartir natillas y buñuelos. Mientras, en el sur de Italia, se conserva la costumbre de elaborar pettole o zeppoline dell’Immacolata, un dulce frito típico del 8 de diciembre.
Una tradición que empieza en los conventos
En España, buena parte de la relación entre la Inmaculada y la alimentación se forjó en los conventos de clausura, muchos de los cuales llevan siglos bajo la advocación de la Purísima. La repostería conventual, una de las joyas gastronómicas españolas, surgió como una actividad económica esencial para la vida monástica. Dulces como las yemas, los mazapanes o los mantecados se elaboraban en estas fechas y comenzaban a venderse precisamente alrededor del 8 de diciembre, anticipando la llegada de la Navidad.
La iconografía mariana y la gastronomía: el simbolismo del blanco
Además, la Inmaculada es la advocación que representa la pureza original de María, un concepto ligado históricamente al color blanco. Este simbolismo ha convivido durante siglos con alimentos considerados “puros” o “nutritivos”, especialmente aquellos asociados a la maternidad y la protección.
La leche, presente en numerosas escenas marianas medievales, simbolizaba alimento sagrado, vínculo entre madre e hijo. La almendra, blanca bajo su cáscara, se convirtió en base de muchos de los dulces emblemáticos de diciembre: mazapanes, peladillas o turrones. Y en algunos conventos, preparaciones como las yemas blancas o los bollos glaseados reforzaban esta estética luminosa, vinculando lo culinario a lo espiritual.
Al observar la gastronomía de diciembre desde esta óptica, aparece con claridad cómo la cultura alimentaria europea integró, durante siglos, un lenguaje religioso en aquello que se comía y en cómo se comía.
Principio del “maratón gastronómico navideño”
Aunque hoy los supermercados exhiben turrones desde octubre, la realidad antropológica es diferente. Tradicionalmente, el 8 de diciembre marcaba el principio de la decoración navideña, la compra de dulces, la preparación de platos festivos y los encuentros en torno a la mesa. Era, en la práctica, el “kilómetro cero” de la Navidad gastronómica, el inicio de lo que podríamos denominar el “maratón nutricional navideño”.
Hay razones profundas para ello. En el mundo rural, los primeros días de diciembre coincidían con la reposición de despensas para el invierno, el final de las cosechas y la matanza del cerdo. A partir de esa fecha, la comunidad podía permitirse ciertos excesos culinarios que antes hubieran sido impensables. En muchos pueblos españoles se preparaban platos colectivos, como los potajes y migas, que fortalecían la cohesión social.
La Inmaculada y el desafío nutricional del diciembre moderno
Pero si miramos esta festividad desde la perspectiva de la nutrición, aparece una contradicción interesante: el 8 de diciembre no solo inicia un ciclo de celebraciones religiosas, sino también uno de los periodos más exigentes del año para la salud alimentaria. Entre cenas de empresa, comidas familiares, dulces tradicionales y bebidas, muchos españoles consumen entre un 30 y un 50 % más de calorías en diciembre, pudiendo ganar entre unos 2 y 4 kg en Navidad debido a estos excesos. Y lo hacen justo cuando la actividad física suele disminuir por el frío o la falta de luz.
Esto plantea dos retos. El primero es la moderación: los dulces conventuales o caseros, consumidos puntualmente, no representan un riesgo significativo; el problema aparece cuando se integran en la dieta diaria durante varias semanas.
El segundo reto es la gestión de la abundancia: la apertura del ciclo gastronómico navideño invita a revisar cómo comemos y cuál es el papel cultural de estos alimentos, para encontrar un equilibrio entre tradición y salud.
Una festividad religiosa con impacto cultural, económico y alimentario
Así pues, el Día de la Inmaculada no es solo un episodio devocional: es un marcador cultural que ha influido en la tradición culinaria de España y de buena parte de América Latina durante siglos. Desde la repostería monástica hasta los dulces fritos italianos preservados en el continente americano, desde los simbolismos iconográficos hasta los desafíos nutricionales contemporáneos, esta festividad modela prácticas alimentarias que aún hoy permanecen vivas.
Cada 8 de diciembre, las mesas, en cualquier parte del mundo, siguen recordándonos que la gastronomía es un territorio donde la historia, la identidad y el placer se entrelazan. Y que, más allá de la devoción mariana, esta fecha sigue siendo el punto exacto donde comienza, simbólicamente, la Navidad.
![]()
José Miguel Soriano del Castillo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Día de la Inmaculada: el ‘kilómetro cero’ de la Navidad gastronómica – https://theconversation.com/dia-de-la-inmaculada-el-kilometro-cero-de-la-navidad-gastronomica-271053