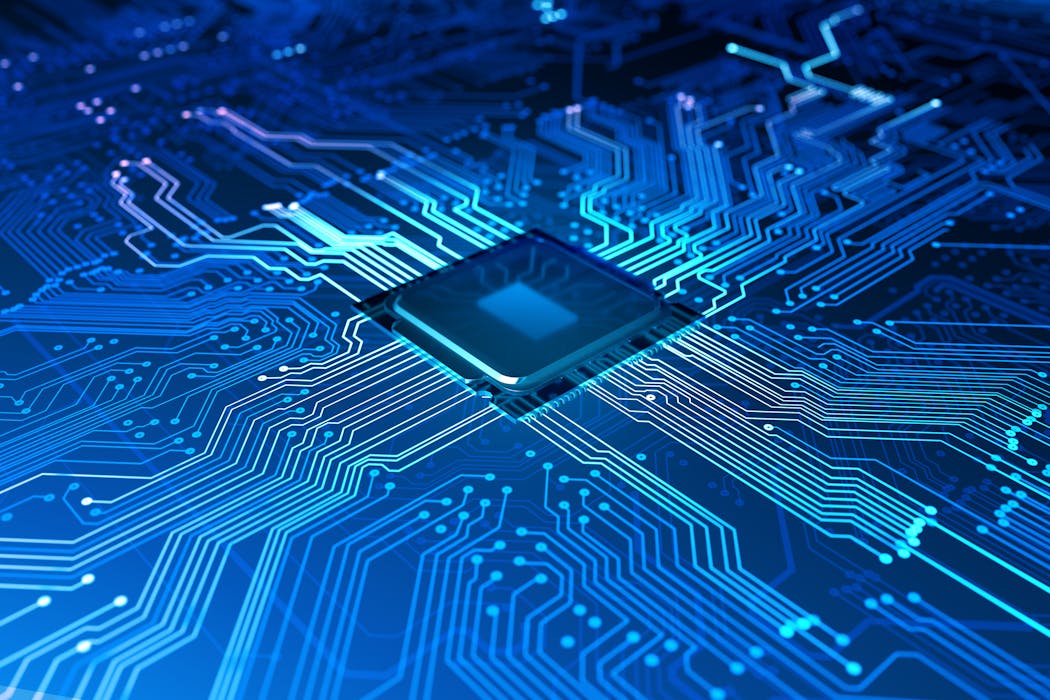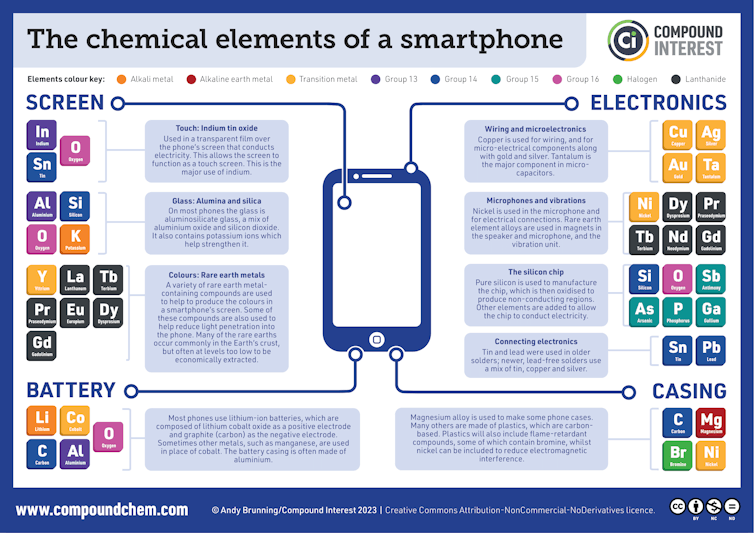Source: The Conversation – in French – By Virginie Uger Rodriguez, Maître de Conférences en marketing, Université d’Orléans
Que disent les détracteurs d’une marque sur les réseaux ? Une nouvelle étude s’est penchée sur la dynamique des groupes de « haters » sur Facebook. En se fédérant, ces internautes engagés pallient certains manquements des marques qui les ont déçus.
D’ordinaire, les marques ont pour habitude de faire rêver ou d’être idéalisées par les consommateurs. Cependant, depuis quelques années, on note une aversion grandissante pour certaines d’entre elles. Aversion pouvant conduire jusqu’à la haine.
Avec 50,4 millions d’utilisateurs en France, les réseaux sociaux sont un terrain favorable à la propagation de cette haine.
Les consommateurs, fans de marques désireux de partager leurs créations, leur passion voire leur amour, n’hésitent pas à se regrouper au sein de communautés en ligne (groupes publics ou privés) hébergées sur ces réseaux.
Mais il est important de noter que les consommateurs ayant vécu une expérience négative avec une marque auront tendance à en parler plus ou à poster plus de commentaires négatifs que les consommateurs ayant vécu une expérience positive. Car il existe des communautés dont le point de convergence s’avère être la haine pour une marque donnée, notamment pour celles qui ne respectent pas le contrat de confiance établi avec les consommateurs : manquements ou défaillances dans les produits ou les prestations de services, retards de livraisons, vols annulés, pièces manquantes, airbags défectueux… Les marques concernées peuvent être issues de tous les secteurs d’activité. Les membres de ces communautés sont couramment appelés des haters, c’est-à-dire des détracteurs d’une marque.
Dans le cadre de nos travaux publiés dans Journal of Marketing Trends et présentés lors de conférences en France et à l’international, nous avons effectué une netnographie (analyse de données issues des médias sociaux, inspirée des techniques de l’ethnographie) au sein de deux communautés en ligne anti-marques (groupes Facebook). À noter que ces communautés étaient indépendantes des marques, ce qui signifie que celles-ci n’avaient aucune prise directe sur elles. Au total, ce sont plus de 1000 publications qui ont été collectées et analysées.
Une haine bien présente dans les discours des consommateurs
Plusieurs marqueurs permettent d’affirmer que les consommateurs au sein de ces groupes expriment leur haine de façon plus ou moins nuancée, allant d’une haine froide (peu vindicative) à une haine chaude (très virulente), par le vocabulaire utilisé, une ponctuation excessive, les émoticônes choisis…
La nature même des échanges peut être catégorisée selon quatre dimensions :
-
une dimension normative se référant aux comportements altruistes et d’entraide des membres pour pallier les défaillances des marques ;
-
une dimension cognitive exprimée à travers la sollicitation du groupe pour répondre à un besoin (question, problème rencontré, démarche à engager…) ;
-
une dimension affective comprenant l’expression des sentiments et des émotions des membres (déception, mécontentement, colère, dégoût, rage, haine) ;
-
et une dimension mixte relative aux discours mêlant des tons normatifs et affectifs.
La mise en place d’une structure organisationnelle et sociale
Les membres des groupes anti-marques s’organisent et se sentent investis de missions au travers des rôles qu’ils s’attribuent :
S’ils ont intégré ces groupes anti-marques, c’est que les consommateurs ont eu une expérience négative avec elles dans le passé ou bien, même s’ils ne sont pas consommateurs, qu’ils rejettent les valeurs qu’elles défendent ou représentent. En fonction de la marque et du caractère du fondateur de la communauté anti-marque, celle-ci est plus ou moins démocratique et tolère plus ou moins les discours antagonistes à la haine anti-marque.
À chaque niveau de haine sa réponse
Les manifestations de la haine au sein des communautés étudiées peuvent être catégorisées ainsi :
Pour pallier les défaillances de la marque, les consommateurs ont tendance à s’entraider au sein de la communauté en ligne anti-marque. Ils se partagent des informations et des bons plans. Ils s’apportent mutuellement du soutien tout en se servant de la communauté comme d’un exutoire. Globalement, les consommateurs réparent ou « bouchent les trous » que la marque aurait dû prendre en charge dans son contrat de confiance.
Quelles réponses apporter aux « haters » ?
Les communautés anti-marques peuvent avoir un potentiel de nuisance important se traduisant, entre autres, par une perte de clients et de fait une diminution du chiffre d’affaires.
Voici quelques pistes pour contenir la haine exprimée par certains consommateurs voire tenter de l’enrayer au sein de ces communautés :
-
une stratégie offensive avec une réponse directe à la communauté et à ses membres lorsque la marque est attaquée directement sur ses réseaux, en apportant des réponses oscillant entre le mea culpa, à travers une « publicité reconnaissant la haine », l’humour et l’entrée en dialogue avec les détracteurs ;
-
ou une stratégie défensive visant à identifier les communautés en ligne anti-marques, à surveiller leur activité, à comprendre leurs critiques et à mettre en œuvre des mesures correctives et/ou instaurer un dialogue.
Que les revendications des haters à l’égard des marques soient légitimes ou non, elles permettent de révéler des défaillances de marques parfois dramatiques voire illégales pouvant faire intervenir, en réaction, les pouvoirs publics.
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Face aux défaillances des marques, les groupes de « haters » organisent leur riposte en ligne – https://theconversation.com/face-aux-defaillances-des-marques-les-groupes-de-haters-organisent-leur-riposte-en-ligne-268783