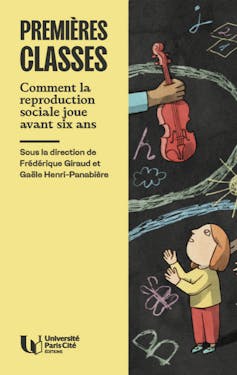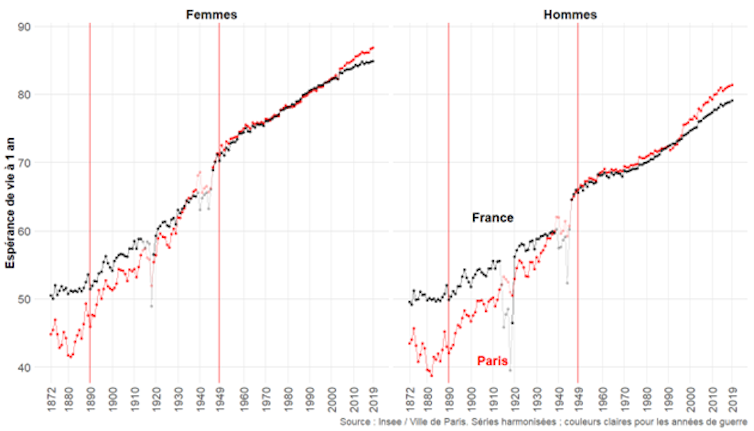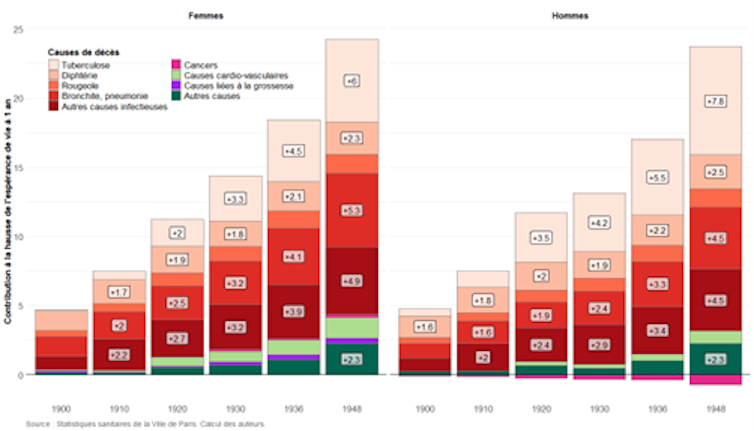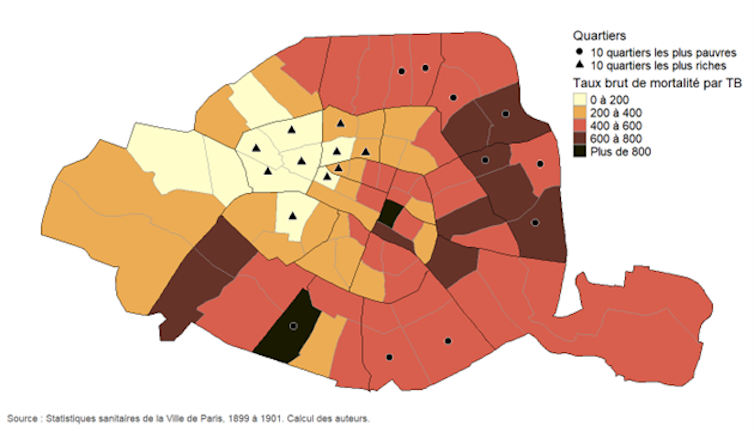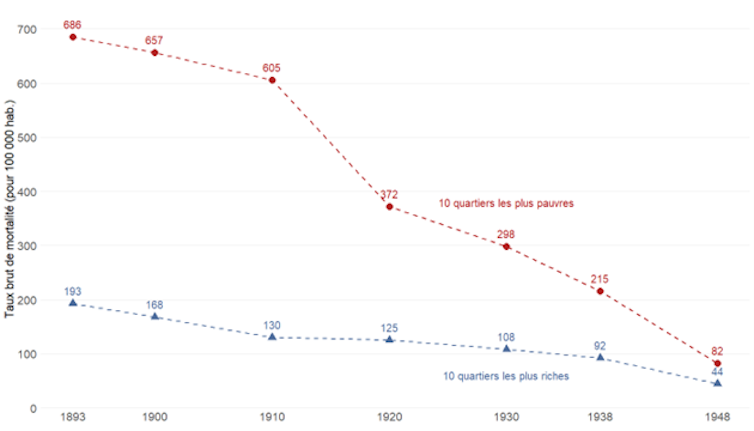Source: The Conversation – in French – By Alexandre Joux, Professeur en Sciences de l’information et de la communication, Aix-Marseille Université (AMU)
En évoquant un « label » pour l’information, le président Macron a déclenché une polémique alimentée par les médias de Vincent Bolloré, qui dénoncent une volonté de museler la presse. Les labels existants sont-ils efficaces pour promouvoir des médias de qualité ? Quels sont les critères de labellisation, et plus largement, comment définir le « bon » journalisme ?
[Note de la rédaction : The Conversation France a reçu le label Journalism Trust Initiative (JTI) en novembre 2025.]
Le vendredi 28 novembre 2025, dans un échange avec les lecteurs du groupe EBRA, Emmanuel Macron, président de la République, évoquait un « label » pour l’information. Il citait celui de la Journalism Trust Initiative (JTI), créé par Reporters sans frontières (RSF), sans en faire la norme par ailleurs, rappelant que l’engagement des rédactions sur la vérification des faits et de la déontologie est essentiel.
Cette déclaration, qui n’avait pas vocation à faire parler d’elle, sera largement débattue dans les médias du groupe Bolloré, qui vont dénoncer une mise sous tutelle de l’information. L’Élysée réagira dès le lundi 1er décembre et dénoncera une « fausse information ». Ainsi, en trois jours à peine, le trio JDD-Europe 1-CNews sera parvenu à mettre la question du « label » à l’agenda, et le président Macron en porte-à-faux. L’opération est réussie puisque la confusion s’est très vite installée entre, d’une part, un label qui garantit l’information produite par des journalistes selon un certain nombre de critères professionnels – que l’on pourrait appeler « vraie information » et, d’autre part, les velléités prétendues de certains politiques sur la sélection de la « bonne » information.
La Journalism Trust Initiative, une réponse aux logiques des plateformes
Le débat est légitime mais il ne porte pas, en fait, sur les médias entre eux, mais sur les réseaux sociaux et les algorithmes de recommandation. Il porte sur la signalisation de la « vraie » information, celle faite par des journalistes, dans des environnements où prolifèrent les contenus en ligne qui n’ont pas pour objectif la véracité des faits.
La Journalism Trust Initiative a été lancée en 2018 « comme dispositif innovant contre la désinformation », deux ans après la première élection de Donald Trump et le vote des Britanniques en faveur du Brexit, deux élections où les « fake news » ont émaillé les campagnes précédant le vote. La JTI n’avait donc pas pour objectif de discriminer entre « bon » et « mauvais » médias dans un contexte de polarisation des opinions, mais à demander « une distribution et un traitement privilégiés des [médias labellisés] par les algorithmes des moteurs de recherche et des réseaux sociaux ». Elle pointait les premiers responsables de l’actuelle foire d’empoigne médiatique : le relativisme informationnel, le grand gloubi-boulga des contenus sur les réseaux sociaux, où tout et n’importe quoi est mis sur le même plan pourvu que cela satisfasse les attentes des « profils ».
Quand les médias du groupe Bolloré envisagent les labels comme un moyen d’identifier les « bonnes » rédactions, et non pas comme un moyen de distinguer la « vraie » information du reste des contenus, ils déplacent le problème. Et dans ce cas, effectivement, les labels soulèvent des questions, avec trois difficultés au moins : celle de la définition du bon journalisme et de l’information vraie ; celle du thermomètre pour le mesurer ; celle des effets possibles du « label » auprès de ceux qui cherchent à s’informer. Avec, en fin de compte, un risque élevé pour la liberté d’expression.
Comment définir la valeur de l’information ?
Première difficulté : le bon journalisme n’existe pas, il n’y a que des bons articles ou de bons reportages, parce que la valeur de l’information est décidée avec les publics, au cas par cas. Cette valeur ne relève pas des règles que la profession se donne, même si ces règles sont essentielles.
Le journalisme a toujours été une profession « floue », qui s’adapte aux évolutions des techniques, des usages, plus largement des sociétés. D’ailleurs, rien ne définit le journalisme en France dans le Code du travail, sauf le fait d’être payé en tant que journaliste (article L7111-3). Ce flou est utile. Il permet parfois de dire que des journalistes payés n’en sont pas, trahissent les règles qu’ils disent respecter, quand d’autres font du journalisme sans véritablement s’en revendiquer.
Aujourd’hui, la chaîne YouTube HugoDécrypte contribue plus à l’information, notamment auprès des jeunes, que de nombreux médias « reconnus » qui font de l’information avec des bouts de ficelle, quand ils ne volent pas le travail de leurs concurrents, comme le soulignent les débats actuels sur le renouvellement de l’agrément de Var Actu par la CPPAP, la commission qui permet de bénéficier des aides de l’État à la presse. Voici un bel exemple des limites de tout processus de labellisation à partir de règles données.
Parce qu’il n’est pas seulement une profession avec ses règles et ses codes, mais parce qu’il a une utilité sociale, le journalisme se doit donc d’être en permanence discuté, critiqué, repensé pour qu’il serve d’idéal régulateur à tous les producteurs d’information. Le journalisme, ses exigences et la valeur qu’on lui accorde se définissent en effet dans le dialogue qui s’instaure entre les professionnels de l’information, leurs publics et la société. Certes, les journalistes doivent s’engager sur la véracité des faits, sur une exigence de rationalité dans le compte-rendu qu’ils en font, ce qui suppose aussi une intelligence a minima des sujets qu’ils doivent traiter mais, une fois ces règles minimales posées, les modalités de leur mise en œuvre vont varier fortement.
C’est la différence entre la « vraie » information, celle qui respecte des normes, des règles, ce que proposent les labels, et l’information « vraie », celle qui est perçue comme solide par les publics, quand ils reconnaissent, par leurs choix de consommation, la qualité du travail journalistique en tant que tel. Ici, l’information « vraie » recouvre finalement le périmètre de la « bonne » information.
C’est pour insister sur cet autre aspect plus communicationnel du journalisme que j’ai introduit la notion de « presque-vérité » journalistique. Elle permet de souligner que la réalité du métier, avec ses contraintes de temps, de moyens, de compétences rend la réalisation de cet idéal d’information « vraie » toujours difficile. Le terme permet également de souligner que l’information des journalistes entretient quand même un rapport avec la vérité, quand d’autres discours dans l’espace public se libèrent des contraintes de la factualité, de l’épreuve du réel. Elle permet enfin de souligner que l’information journalistique est toujours négociée.
Le journalisme et la vérité
Quel est, alors, ce rapport du journalisme à la vérité, quel serait, de ce point de vue, une « bonne » information ? En premier lieu, l’exercice du métier renvoie à des normes collectives d’établissement des faits – ce sur quoi toutes les rédactions peuvent s’accorder en définissant les critères pour un label. C’est ce qui permet de dire que les faits sont vrais, que leur existence doit être reconnue de tous.
En second lieu, toute information est construite à partir des faits, par le journaliste, en fonction d’une ligne éditoriale, d’un angle qu’il choisit, et en fonction des publics auxquels il s’adresse. Il ne s’agit plus des faits mais de leur interprétation. En la matière, on peut attendre d’un journaliste qu’il propose une interprétation la plus cohérente possible des faits, qu’il fasse un vrai effort de rationalisation, mais il n’y a pas de lecture des faits qui soit plus légitime qu’une autre, si l’exigence de rationalité est respectée.
Ici se joue la négociation de l’information avec son public, la définition de sa portée sociale. Ainsi, une lecture hayekienne ou marxiste d’un même fait seront toutes les deux cohérentes et légitimes, même si elles sont en concurrence. Dans les deux cas, l’information est « vraie », appuyée sur des faits établis, inscrite dans une grille de lecture assumée, expliquée de la manière la plus rationnelle possible, pensée aussi pour répondre aux attentes de certains publics. Il s’agit d’une vérité tout humaine, sans cesse renégociée, qui repose sur la reconnaissance de la pertinence du travail fourni par le journaliste. Et cette possibilité se joue sur chaque article, sur chaque reportage, parce que le journaliste remet en jeu, à chaque fois, sa crédibilité, quand il choisit de traiter l’actualité à partir d’un angle, d’une vision, d’une conception du monde.
De ce point de vue, un label ne permettra jamais de mesurer si le journaliste a fait les bons choix pour interpréter le plus correctement possible les faits, parce qu’il n’y a pas d’interprétation qui soit plus correcte qu’une autre dès qu’elle est rationnelle. La valeur sociale de l’information dépend de la relation entre les journalistes et leurs publics, elle n’est pas liée aux conditions professionnelles de son élaboration.
Qui mesure la qualité de l’information et comment ?
Deuxième difficulté, le thermomètre, c’est-à-dire qui mesure la qualité de l’information et comment ? La plupart des tentatives soulèvent la question de la légitimité de ceux qui définissent les critères, et surtout des fins que ces critères viennent servir. C’est toute la différence qui sépare deux autres projets d’évaluation nés après 2016 et le surgissement massif des « fake news », le Décodex d’une part, les avis du Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM) d’autre part.
Lancé en 2017, le Décodex est une initiative des Décodeurs, le service de fact-checking du Monde. Afin de lutter contre la prolifération des fausses informations, signalées jusqu’alors une à une, l’idée fut de catégoriser les sources émettrices, donc de dire quel site est fiable et quel site ne l’est pas. Cette entreprise de labellisation des sources d’information a été finalement très critiquée avant d’être abandonnée, car son résultat le plus évident fut de mettre en avant l’ensemble des médias institués face à des offres qui n’avaient jamais pour elles le journalisme comme étendard.
Au départ, trois pastilles de couleur verte, orange et rouge étaient proposées : tous les médias ont eu leur pastille verte, à de rares exceptions (Fakir, Valeurs actuelles). La confusion s’est donc immédiatement installée entre « vrais » médias et « bons » médias, avec Le Monde en distributeur de bons points, ce qui a conduit les Décodeurs à retirer très vite leurs pastilles. À vouloir qualifier les sources elles-mêmes et pas le travail concret des journalistes, sujet par sujet, le Décodex n’est pas parvenu à discriminer entre « bons » et « mauvais » médias. Il a rappelé que les médias font en général de la « vraie » information, mais il n’a pas pu statuer sur la pertinence de l’information qu’ils produisent. Comme pour le label évoqué par le président Macron, le déplacement du débat de la « vraie » information à la « bonne » information a provoqué une remise en question du « label » imaginé par les Décodeurs.
À l’inverse, le CDJM, lancé en 2019, se prononce bien sur les ratés déontologiques des médias d’information quand il publie ses décisions sur des cas concrets. Il permet de faire le tri entre le bon grain et l’ivraie parmi les informations produites par les rédactions, mais il ne permet pas de statuer sur la qualité des médias et sur les choix des rédactions, considérant que cet aspect de l’information relève de la liberté éditoriale, du jugement aussi des lecteurs (le CDJM inclut d’ailleurs des représentants des lecteurs au côté des professionnels de l’information). Ainsi, le thermomètre fonctionne quand il permet de signaler les manquements de certains journalistes et de leurs rédactions sur des cas concrets, parce que la décision est argumentée, adaptée à chaque cas, et le périmètre bien circonscrit au seul respect des règles qui permettent de garantir la véracité des faits. Mais c’est statuer sur la « vraie » information, et sur ses ratés, jamais sur sa qualité. Or l’idée de « label » véhicule avec elle, de manière latente, un jugement de valeur sur la qualité des médias.
Les risques de l’effet « label »
Le troisième problème d’un label est le label lui-même, comme indication communiquée aux internautes. Quand Facebook a souhaité lutter contre les « fake news », il les a signalées à ses utilisateurs avec un drapeau rouge, ce qui a produit deux résultats très problématiques. Le premier est celui de l’effet de vérité par défaut, un contenu non signalé étant considéré comme vrai par défaut. Dans le cadre d’un label, son absence pourrait signifier « non crédible », ce qui est absurde et confère au journaliste un monopole sur l’information, quand des sources différentes peuvent être très pertinentes. Le second effet est encore plus problématique car les contenus signalés ont été considérés par certains utilisateurs de Facebook comme plus vrais, justement parce qu’ils sont signalés comme problématiques pour et par « le système dominant ». Le non label pourrait dans ce cas devenir l’étendard de tous ceux qui dénoncent le conformisme ou l’alignement des médias sur une idéologie dominante. Et l’on sait combien ce discours est porteur…
En conclusion, le risque est grand de statuer sur les bons et les mauvais médias en transformant le label « info » évoqué par le président de la République en gage de sérieux journalistique. Il a été évoqué dans un contexte de dénonciation de la désinformation sur les réseaux sociaux, pas pour définir un « bon » journalisme réservé aux seules rédactions déclarées vertueuses.
Ce sont la liberté d’expression et la liberté de la presse qui permettent à des voix différentes de rappeler que certains cadrages sont peut-être trop convenus, que certaines sources sont peut-être trop souvent ignorées, soulignant ainsi que le pluralisme, s’il est bien défendu, est une meilleure garantie de qualité pour le journalisme dans son ensemble qu’un label attribué à certains et pas à d’autres. Les publics décideront à la fin car l’information est faite d’abord pour eux.
Il ne faut pas minimiser aussi le risque d’une suspicion accrue face au label, qui produira l’effet inverse de celui souhaité, à savoir mettre sur la touche les médias plutôt que de les replacer au cœur de l’organisation du débat public. C’est ce rôle-là des médias qu’il faut préserver à tout prix, en défendant le pluralisme et l’indépendance des rédactions, quand les plates-formes nous enferment à l’inverse dans des bulles où nos goûts font office de label pour la « bonne » information.
![]()
Alexandre Joux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Faut-il labelliser les médias pour promouvoir une information de qualité ? – https://theconversation.com/faut-il-labelliser-les-medias-pour-promouvoir-une-information-de-qualite-271537