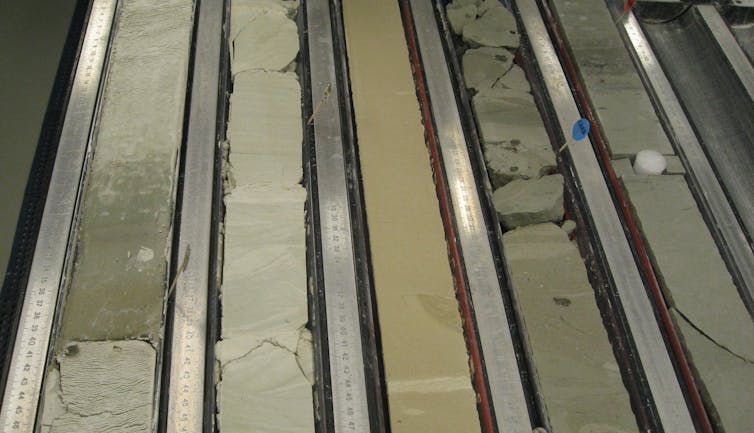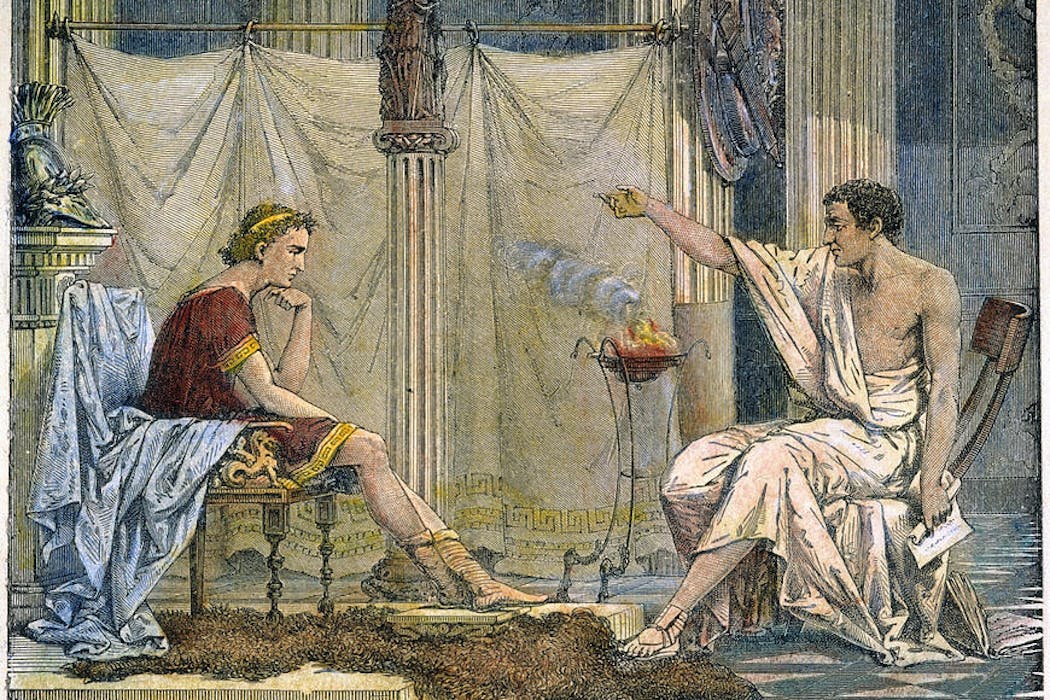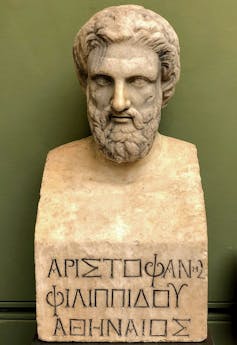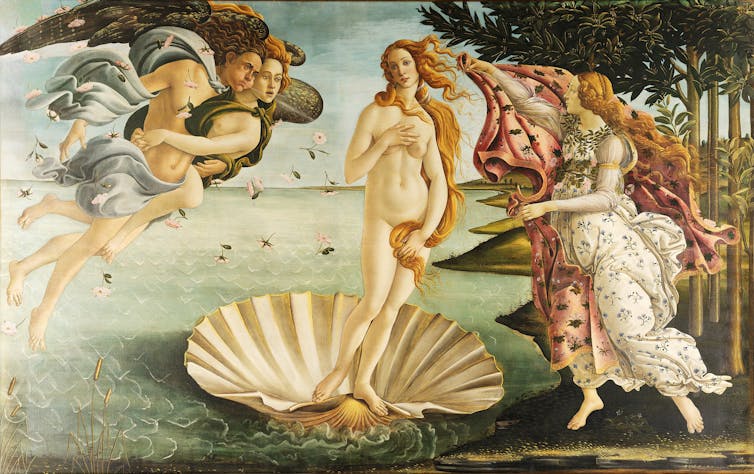Source: The Conversation – France (in French) – By Sandra Gaviria, Professeure de sociologie, Université Le Havre Normandie
Le début des études supérieures n’est pas seulement un cap vers l’autonomie, cela peut être aussi une période de vulnérabilité, surtout lorsque les jeunes découvrent que les choix d’orientation faits en terminale ne correspondent pas à leurs attentes réelles. Se réorienter reste une épreuve, pour eux comme pour leurs familles. Explications.
Trois ans après leur première inscription en licence en 2020-2021, seuls 55 % des bacheliers sont encore en licence. Autrement dit, près d’un jeune sur deux connaît, à un moment de son cursus, une interruption, un réajustement de parcours ou une situation d’échec. Durant cette période, les sentiments éprouvés comme les solutions envisagées tendent à s’individualiser : chacun affronte seul ses doutes, ses inquiétudes et la recherche de voies possibles pour rebondir.
Au bout de quelques mois, les désillusions émergent, la solitude dans le logement ou dans l’établissement peut devenir pesante. Chaque année, en fin de premier semestre, « les décrocheurs », ces étudiants qui découvrent que la formation obtenue via Parcoursup ne correspond pas à leurs attentes ou qui ne se sentent pas bien dans leur vie étudiante, refont surface. Les notes, les partiels et les premiers bilans les obligent à se rendre à l’évidence.
Les établissements mettent en place de nouvelles initiatives pour essayer d’y remédier. Plusieurs travaux ont montré que ce phénomène ne peut être réduit à un simple échec scolaire, d’autres facteurs étant en jeu. En effet, il s’agit d’un phénomène souvent multicausal, où plusieurs éléments se conjuguent au cours de ces premiers mois d’études.
Des démarches de réorientation complexes
Pour une partie de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes commence alors la longue et souvent complexe démarche de réorientation. D’autres entrent dans une période d’attente indéterminée, sans véritable projet, dans l’espoir diffus de trouver leur voie, leur place ou simplement une direction. Cela s’accompagne du sentiment de « ne servir à rien », l’impression de ne pas avoir une place dans ce monde. Marie, 20 ans, explique son ressenti après trois mois passés à Sciences Po :
« J’ai eu tout le temps de me rendre compte que les cours ne m’intéressaient pas autant que ce que je pensais et, en plus, qu’il n’y avait pas la vie étudiante ou les associations à côté pour compenser. En janvier, j’ai décidé d’arrêter les cours à Sciences Po et, à ce moment-là, ce n’était pas très marrant. C’était, je pense, un début de dépression, où j’avais l’impression que rien n’avait de sens, ni les études ni la société. »
Pour certains jeunes, ces doutes s’ajoutent à des contextes personnels déjà fragiles, marqués par des problèmes familiaux, des difficultés matérielles, des histoires personnelles difficiles ou un mal-être antérieur qui empêche d’avancer dans les études. C’est aussi le moment où des fragilités du passé peuvent refaire surface. Carine, inscrite en sciences du langage, aujourd’hui infirmière, l’explique :
« Alors, moi, j’avais demandé les écoles d’infirmière dès la fin du bac, sauf que j’étais sur liste d’attente, et je ne me voyais pas faire autre chose que ça… J’avais une inscription à l’université, sauf que moi, je suis dyslexique et dysorthographique, du coup, je savais que j’allais décrocher tout de suite… Enfin, après, ça dépend des endroits, mais je savais qu’il y aurait eu trop de monde et que ça n’allait pas le faire au niveau de mon apprentissage. »
Le difficile repérage des jeunes en difficulté
Si le phénomène du décrochage est visible et comptabilisé statistiquement, les solutions restent encore limitées pour ces jeunes qui sortent du cadre des études après seulement quelques mois. Lorsqu’ils abandonnent leurs études supérieures, les parcours deviennent difficilement lisibles. Certains s’engagent dans un service civique, d’autres se retrouvent dans la catégorie des « NEET » (« not in employment education or training », « ni en emploi, ni en formation, ni en études »).
Cette répartition entre différentes catégories statistiques ne permet pas un réel suivi des trajectoires. Le repérage de ces jeunes reste difficile, en particulier lorsqu’ils ne sollicitent aucun dispositif d’accompagnement public. Certains peuvent se réorienter, mais devront « rattraper » le travail du premier semestre au second semestre. Les dispositifs sont souvent complexes à mobiliser, peu visibles, ou trop tardifs pour répondre à cette période de vide existentiel et de sentiment d’échec.
À lire aussi :
Choix d’études, orientation professionnelle : « Donnons aux jeunes le droit de se tromper »
À l’incertitude vécue par les étudiants s’en ajoute une autre, plus silencieuse, qui touche leurs parents. Après une année de terminale éprouvante, marquée par la pression du bac – où leurs enfants avaient eu le sentiment de « jouer leur vie » à chaque épreuve, les choix imposés par Parcoursup et la crainte de l’échec, ils se retrouvent face à leurs enfants en souffrance, qui doutent de leur vie et d’eux-mêmes.
Commence un temps où chacun tente de savoir s’il faut encourager la poursuite des études, accompagner un changement de filière ou financer (pour ceux qui le peuvent) une année dans l’attente d’un nouveau projet.
Des différences de ressources sociales
Les enquêtes soulignent la diversité des trajectoires de ces jeunes et mettent en évidence le rôle du milieu social dans la probabilité de décrocher ou, au contraire, de poursuivre des études supérieures. Les ressources familiales, les histoires personnelles et la capacité à se projeter dans l’avenir façonnent des parcours profondément différents.
Il y a une individualisation dans la recherche des solutions. Pour ceux qui sont dotés de ressources économiques et culturelles suffisantes, des alternatives sont envisagées : une prépa privée, une école hors Parcoursup. Trouver la bonne option devient un parcours assez solitaire, où les ressources relationnelles et économiques sont mobilisées pour commencer la chasse aux informations. Ainsi, ces jeunes accompagnés par leurs familles concoctent des recettes variées où interviennent de multiples professionnels, tels que psys, coachs en orientation…
Pour les autres, issus de milieux moins bien dotés, la situation est plus difficile. Les jeunes risquent de se retrouver sans solution claire, oscillant entre petits boulots précaires (le temps de trouver ce qu’ils veulent faire), longues périodes d’attente et, pour une minorité, l’accompagnement des structures du service public.
Un manque de lisibilité des dispositifs
Nous observons la difficulté de tous les parents face à l’impossibilité pour leurs enfants de réaliser leurs projets. Certains n’ont pas les compétences ni les moyens pour les accompagner, d’autres pas d’idées ou de connaissance des dispositifs. Les jeunes, de leur côté, ont aussi des souffrances communes telles que se sentir « en dehors du tapis roulant », à l’arrêt dans la course collective et étant en « retard » par rapport aux autres.
L’analyse de l’abandon après ces premiers mois dans l’enseignement supérieur met en lumière le manque de lisibilité des dispositifs d’accompagnement des jeunes qui n’ont pas trouvé leur voie ou n’ont pas pu accéder à leurs vœux. Pour une partie d’entre eux, cette période restera celle d’un simple ajustement. Pour d’autres, elle marque la première rupture d’un parcours plus long et irrégulier. Cette période entraîne, parfois, une accentuation de leurs dépendances – alcool, drogues, jeux vidéo – et de l’incertitude sur le long terme.
Le début des études supérieures n’est pas seulement le début de l’autonomie, mais aussi un temps de vulnérabilité sous-estimé. Le sentiment d’échec face aux études cristallise l’ensemble des insécurités des jeunes et les plonge dans l’impression d’être seuls face au monde. Ils ont le sentiment que les autres avancent tandis qu’eux restent à l’arrêt, sans possibilité de se projeter, uniquement traversés par des questions : qu’est-ce que j’aime ? Qu’est-ce que je peux faire ? Comment puis-je réussir ?
![]()
Sandra Gaviria ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. La solitude des étudiants décrocheurs : quelques mois de formation et déjà face à l’échec – https://theconversation.com/la-solitude-des-etudiants-decrocheurs-quelques-mois-de-formation-et-deja-face-a-lechec-271871