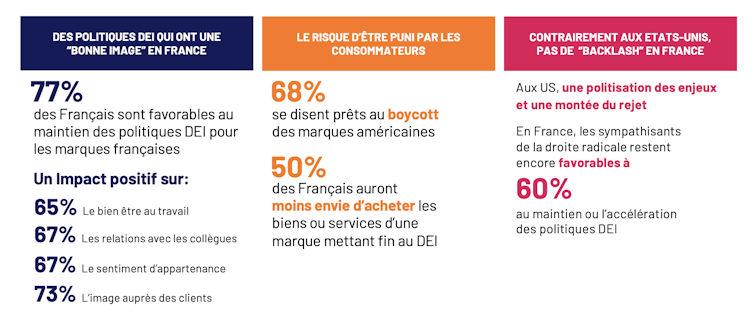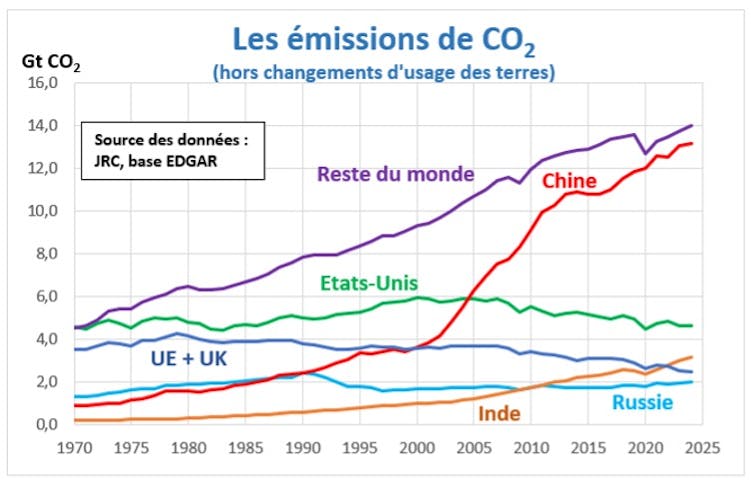Source: The Conversation – in French – By Cathia Papi, Professeure, CURAPP-ESS, Université TÉLUQ
Alors que le ministère de l’Enseignement supérieur du Québec vient de lancer la campagne « Pour toi, plus que tu crois » sur les réseaux socionumériques dans l’espoir d’attirer davantage de jeunes hommes dans l’enseignement supérieur, il semble pertinent de revenir sur le constat suivant : les hommes sont moins nombreux que les femmes sur les bancs de l’université.
Professeure à l’Université TÉLUQ, je me suis penchée ces dernières années avec Dominic Thériault, coordonnateur des statistiques et des indicateurs de gestion au ministère de l’Enseignement supérieur du Québec, sur les données disponibles au Québec concernant la représentativité des hommes dans l’enseignement supérieur et l’éducation.
Un constat général
Bien que, dans l’histoire du XXe siècle, les femmes aient accédé plus tardivement que les hommes à l’enseignement supérieur, un même constat est fait dans la plupart des pays occidentaux : au XXIe siècle, les femmes sont davantage diplômées de l’enseignement supérieur que les hommes.
Cette situation est notamment mise en évidence des deux côtés de l’Atlantique : en France, on recense 54 % de femmes diplômées contre 47 % d’hommes parmi les 25-34 ans, tandis qu’au Québec, on compte 62,6 % de femmes et 51,5 % d’hommes (en incluant le collégial) parmi les 25-64 ans. Ce taux de diplomation reflète une fréquentation universitaire de plus en plus féminisée.
Cette féminisation s’est développée depuis les années 1980. Au Québec, par exemple, les données disponibles au ministère de l’Enseignement supérieur font ressortir que les étudiantes représentaient 51,2 % de l’effectif en 1982-1983, contre 58,9 % en 2022-2023, soit une augmentation de 7,7 points en 40 ans. Depuis cinq ans, la tendance semble s’être stabilisée, les hommes représentant chaque année environ 41 % des étudiants inscrits dans les universités québécoises.
Un écart qui se creuse tout au long de la scolarité
L’écart constaté entre les garçons et les filles trouve son origine dès les premiers instants de la vie. À partir de leur entrée dans le système scolaire, on constate ainsi que les garçons accumulent plus de retard que les filles et sont donc proportionnellement de moins en moins nombreux, quel que soit le milieu socioéconomique, à fréquenter le palier scolaire suivant (soit après le primaire, le secondaire, puis le cégep et in fine l’université).
Si l’on admet généralement que ces écarts peuvent être en partie attribués à la plus rapide maturité des filles, force est néanmoins de remarquer qu’ils varient selon les milieux. En effet, au Québec comme dans d’autres sociétés, le milieu socioéconomique dans lequel évolue un garçon semble avoir une plus grande influence sur son parcours que sur celui d’une fille. Cet écart s’explique entre autres par des différences de socialisation plus marquées.
À lire aussi :
Les inégalités entre les sexes persistent au travail : voici quelques pistes pour les atténuer
Tandis que dans tous les milieux socioéconomiques, les filles sont encouragées à être studieuses, dans les milieux plus défavorisés, les garçons ont souvent des modèles de pères, et surtout de pairs, valorisant davantage des attributs stéréotypiques de la masculinité comme la force physique ou l’habileté sportive, la réussite éducative étant même parfois dépréciée.
Des recherches américaines mettent ainsi en lumière que lorsque le père a un haut niveau d’études, les écarts entre garçons et filles diminuent, en raison du milieu plus favorable à l’apprentissage et du modèle concret de réussite éducative parentale.
Écarts entre le réseau public et le réseau privé
De plus, les écarts entre garçons et filles varient entre le réseau public et le réseau privé comme le met en évidence le graphique ci-dessous :
Ainsi, au Québec, en 2017, l’écart entre les sexes concernant le taux de passage du secondaire au collégial était de 9,8 % dans le réseau public, tandis qu’il était de 3,5 % dans le réseau privé. On constate également que les garçons scolarisés dans le réseau privé subventionné tendent à « dépasser » les filles scolarisées dans le réseau public. En 2017, on observait par exemple que 94,1 % des garçons scolarisés dans le réseau privé, contre 84,2 % des filles scolarisées dans le réseau public au secondaire, ont accédé à des études collégiales.
Comme les différences de milieux socioéconomiques tendent à se cumuler avec l’inscription dans le réseau public ou privé, on comprend que les chances de réussite sont susceptibles de varier fortement selon le genre et le milieu familial et scolaire dans lequel évoluent les enfants. C’est notamment ce que révèlent, année après année, les résultats aux épreuves ministérielles qui font ressortir que « les garçons en arrachant toujours davantage en français que les filles », mais avec des taux de réussite nettement supérieur dans le privé que dans le public.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Des rémunérations différentes
Les garçons sont, pour ces raisons, moins nombreux à avoir le diplôme d’enseignement secondaire nécessaire pour entrer dans l’enseignement supérieur. Ils sont également plus susceptibles d’être attirés par certains métiers ne nécessitant pas de diplôme universitaire. On peut penser à certains métiers de l’industrie, de la construction ou des mines pour lesquels la rémunération est plus élevée que celle de professions de niveau équivalent plus féminisées, comme ceux relatifs aux soins à la personne ou à la garde d’enfants.
Le fait que l’écart salarial en défaveur des femmes diminue au fur et à mesure que l’on monte dans les niveaux d’études peut aussi expliquer qu’elles soient plus nombreuses à fréquenter l’université. En effet, l’obtention d’un diplôme d’enseignement secondaire ou supérieur offre un gain salarial plus important pour les femmes que pour les hommes. Ces dernières gagnent, par exemple, 36,9 % de plus en ayant un diplôme de premier cycle universitaire qu’un diplôme collégial, tandis que l’écart est de 30,3 % pour les hommes, comme le fait ressortir le graphique ci-dessous.
Plus qu’une fatalité, des choix de société
Au-delà des facteurs d’ordres biologiques liés au développement quelque peu différencié des garçons et des filles, notamment concernant leur maturité, il apparaît clairement que les facteurs d’ordre sociologique jouent un rôle prédominant dans les écarts de réussite et parcours scolaires des garçons et des filles.
Dès la fin des années 1980, le sociologue français Roger Establet évoquait ainsi « la progression spectaculaire de la réussite scolaire des filles ». À l’hiver 2001-2002 le magazine Réseau de l’Université du Québec comprenait tout un dossier cherchant à expliquer l’écart entre garçons et filles à l’école et questionnant si cette dernière ne favorisait pas les filles. En 2009, un livre intitulé Sauvons les garçons ! » paraissait en France tel un cri du cœur auquel faisait échos, au Québec, en 2017, Leçons d’éléphants. Pour la réussite des garçons à l’école. Loin d’avoir été pris en compte ou de s’être amélioré, l’écart entre garçons et filles n’a cessé de s’accentuer depuis.
À lire aussi :
Les femmes sont moins intéressées par l’IA que les hommes. Elles auraient pourtant tout avantage à en exploiter le potentiel
Aussi semble-t-il opportun de généraliser des mesures pour soutenir les garçons dès le plus jeune âge, tout particulièrement concernant l’apprentissage de la lecture. Les résultats de plusieurs recherches font ressortir l’importance des modèles masculins dans la scolarité, les initiatives comme « Lire avec fiston » pourraient donc servir de sources d’inspiration.
Enfin, ces constats devraient conduire à des réflexions plus profondes concernant l’ensemble de la société. Il semble impératif d’envisager une nouvelle forme scolaire qui réponde mieux à la diversité des élèves, une forme qui favorise l’égalité et déconstruise les stéréotypes de genre susceptibles de nuire aussi bien à la scolarité des garçons que de restreindre les orientations universitaires et professionnelles des hommes et des femmes.
![]()
Cathia Papi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Il y a notablement moins d’hommes que de femmes à l’université. Est-ce une fatalité ? – https://theconversation.com/il-y-a-notablement-moins-dhommes-que-de-femmes-a-luniversite-est-ce-une-fatalite-266535