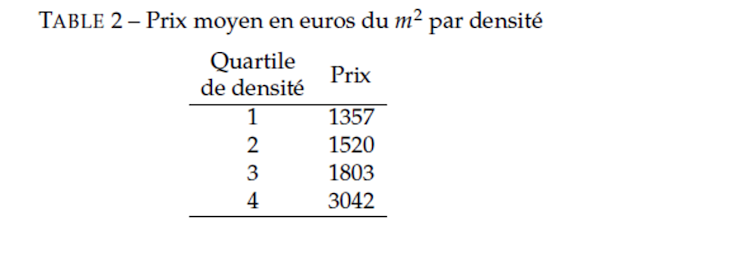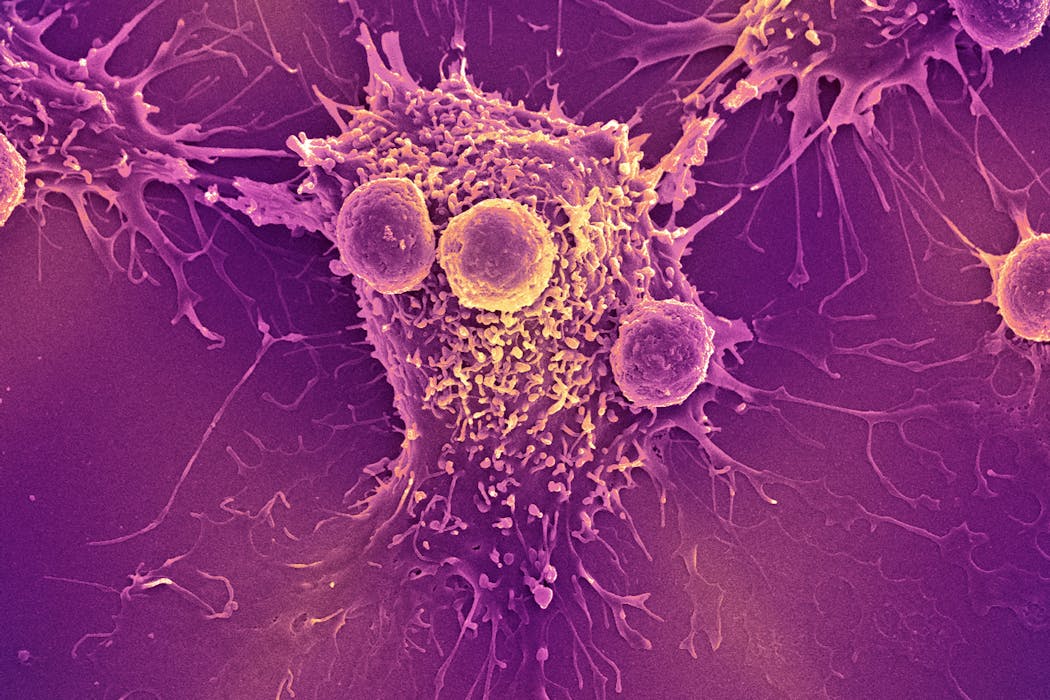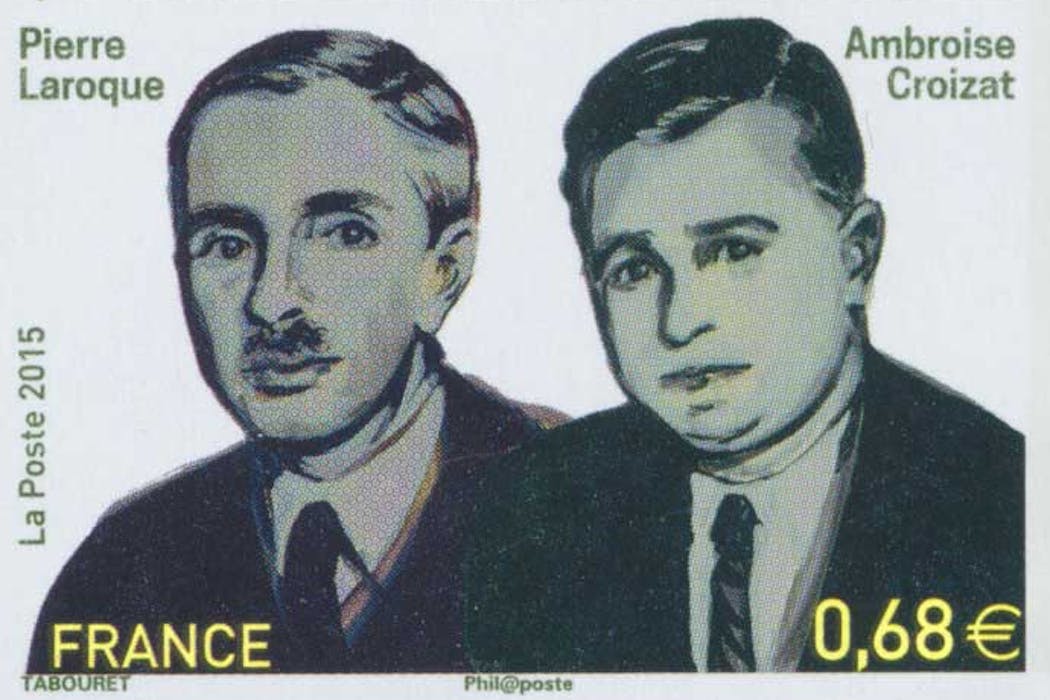Source: The Conversation – France (in French) – By Sarah Pochon, Maîtresse de conférences en STAPS, Université d’Artois
En France, on apprend majoritairement à nager en piscine… mais on se noie le plus souvent en mer, en lac ou en rivière. Entre l’eau chlorée et les vagues, un fossé demeure : comment préparer réellement les nageurs aux imprévus du milieu naturel ?
Les derniers chiffres de l’enquête Santé publique France soulignent qu’en 2025, chez les enfants et adolescents (0-17 ans), plus de 80 % des noyades ayant entraîné un décès ont été recensées hors piscine, en milieu naturel : 56 % en cours d’eau, 15 % dans des plans d’eau, 7 % en mer et 4 % d’autres lieux tels que bases de loisirs, bassins, carrières ou puits. Le reste des noyades (18 %) ont lieu dans des piscines privées familiales. Chez les adultes, le nombre de noyades suivies de décès en mer a augmenté de 40 % en 2025 par rapport à 2024.
Une question se pose alors : et si l’on repensait notre manière d’enseigner le « savoir nager » ? Et si l’on intégrait les milieux naturels (mers, lacs, rivières) dans les enseignements de natation ? Cette démarche, ambitieuse, paraît nécessaire face aux enjeux de sécurité, de santé et d’éducation des jeunes et futures générations.
Apprendre à nager « à ciel ouvert » constitue un atout éducatif majeur pour les élèves, car cela leur permet de consolider les compétences fondamentales du savoir nager en sécurité dans des conditions proches de celles qu’ils rencontreront ensuite dans leurs pratiques personnelles de loisirs.
Ces expériences d’apprentissage en milieu naturel renforcent également leur autonomie et leurs compétences aquatiques, qui englobent non seulement les compétences en natation, mais aussi les connaissances, attitudes et capacités d’évaluation des risques nécessaires pour évoluer en sécurité dans et autour de l’eau.
Les résultats d’une expérience menée en Martinique
Diverses enquêtes menées sur les compétences aquatiques des enfants en milieu scolaire montrent que l’exposition à différents milieux aquatiques et dispositifs pédagogiques contribue à la prévention des noyades mais qu’enseigner en milieu naturel ne se résume pas à transposer les contenus habituels « à l’extérieur ».
Une enquête exploratoire ayant donné lieu à un court-métrage documentaire, conduite par l’Université d’Artois sur l’apprentissage du « savoir-nager en sécurité » auprès de classes de sixième en milieu marin, dans le sud de la Martinique, a mis en lumière plusieurs opportunités d’apprentissage offertes par le milieu naturel.
En évoluant dans un milieu instable, les élèves peuvent par exemple améliorer leur proprioception, c’est-à-dire la perception de leur corps dans l’espace. Ils peuvent aussi apprendre à ressentir des sensations qui leur permettent d’ajuster leur équilibre dans l’eau et maintenir une trajectoire efficace malgré l’absence de repères classiques comme les fanions ou les lignes d’eau des piscines. Sur le plan des capacités d’adaptation, les élèves doivent prendre en compte les vagues et les courants pour ajuster leur motricité en temps réel.

Steward Masweneng/Unsplash, CC BY
Par ailleurs, la nage en milieu naturel constitue une véritable opportunité d’éducation à l’environnement. Les élèves sont au contact direct de la nature et du vivant. Dans ce contexte particulier de la Martinique, ces expériences prennent une dimension singulière : ils peuvent observer des étoiles de mer au fond de l’eau, apprendre à nommer les poissons qui frôlent leurs jambes et développer une sensibilité particulière pour le milieu marin. Mais plus largement, ces expériences peuvent contribuer à la construction d’un rapport sensible et attentif au vivant.
Mais ces premières observations ont aussi souligné des contraintes auxquelles sont confrontés les enseignants d’éducation physique et sportive (EPS).
Les difficultés liées à l’apprentissage en milieu naturel
Ces contraintes, principalement liées à la sécurité et à la gestion de l’espace aquatique, font que les élèves évoluent majoritairement en zone peu profonde, délimitée par un périmètre sécuritaire. Or, cette possibilité de reprendre appui au sol empêche les élèves d’explorer la grande profondeur : ils ne peuvent donc pas expérimenter la remontée longue et passive sans signe de panique. Ces expériences sont essentielles pour prévenir la noyade, car elles permettent aux élèves de prendre conscience de leurs limites, de gérer leur peur éventuelle et d’adapter leur comportement face aux situations imprévues dans l’eau.
De même, la lecture de la motricité des élèves se révèle complexe. La houle, les vagues et le sable remué au fond de l’eau rendent l’observation difficile. Les enseignants, dans l’eau pour certains, à distance pour d’autres, peinent à analyser avec précision les comportements moteurs des élèves : la réverbération du soleil empêche de distinguer si les corps sont totalement allongés, de suivre les mouvements de bras ou encore les battements de jambes. Comment, dans ces conditions, valider le franchissement des obstacles en immersion complète, comment lire la motricité des élèves et vérifier qu’ils réalisent des sur-place verticaux sans reprise d’appuis, alors qu’ils ont toujours pied ?
Ce type d’expérience, particulièrement favorable en Martinique grâce à la douceur du climat et à la proximité du littoral, se heurte de surcroit, dans d’autres contextes, à des contraintes plus fortes comme la température de l’eau ou des conditions météo particulières (qui permettent aussi d’expérimenter un certain « rapport au vivant »).

Stas Ostrikov/Unsplash, CC BY
Ces situations mettent en évidence la nécessité de concevoir des contenus d’enseignement spécifiques, de les tester et les analyser, ce qui ouvre ainsi de nombreuses perspectives de recherche en didactique. Des expérimentations menées à l’étranger se multiplient et permettent de comparer les approches et d’enrichir les stratégies pédagogiques pour développer l’éducation au savoir nager en sécurité en milieu naturel. En France, à ce jour, le ministère de l’éducation nationale n’a pas communiqué d’exigences particulières sur le savoir nager en milieu naturel.
Sur le plan de l’éducation à l’environnement, offrir des occasions d’apprendre en milieu naturel pourrait favoriser un retour à une sensibilité écologique que beaucoup d’individus des sociétés modernes auraient perdu.
Le milieu naturel peut devenir une véritable ressource pour permettre aux élèves de s’approprier leur environnement, de découvrir et mieux connaître la nature, la faune, la flore, le milieu marin ou sous-marin, et d’y revenir. L’EPS peut constituer un espace privilégié où les élèves développent une nouvelle écologie corporelle : une pratique corporelle d’activité physique en relation avec des éléments naturels, avec l’environnement, avec la nature.
![]()
Sarah Pochon a reçu des financements de l’Université d’Artois.
Muriel Surrans ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Savoir nager en piscine, se noyer en mer : faut-il réinventer l’apprentissage de la natation ? – https://theconversation.com/savoir-nager-en-piscine-se-noyer-en-mer-faut-il-reinventer-lapprentissage-de-la-natation-265109