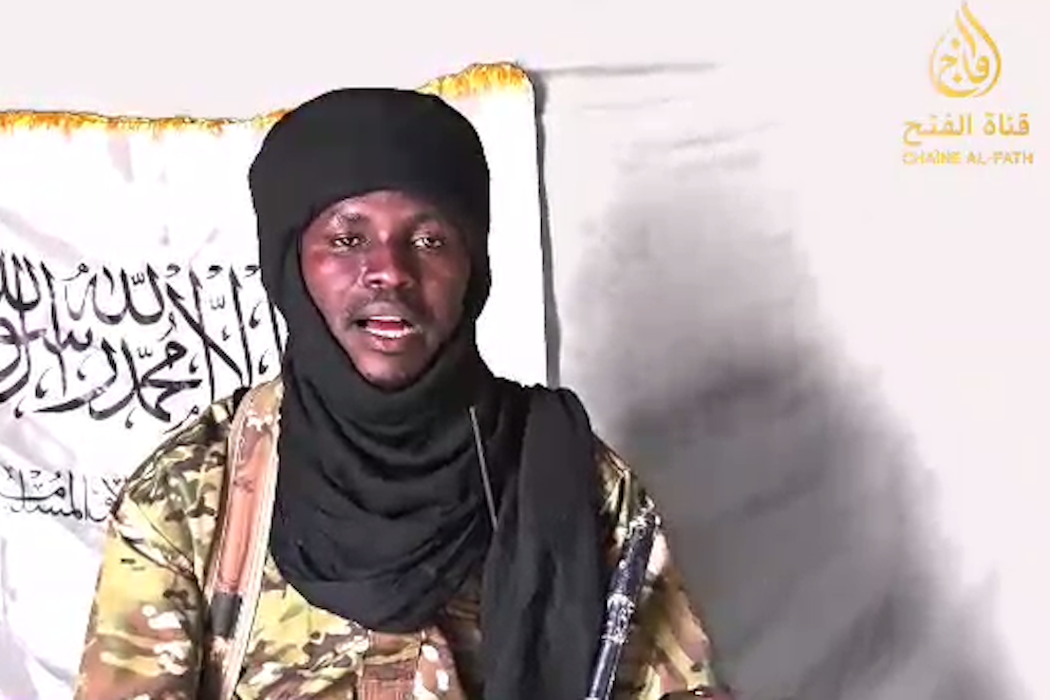Source: The Conversation – France in French (3) – By Rosa Bortolotti, Docteure en Sciences de l’éducation et de la formation, chercheuse au Laboratoire ÉMA (École, Mutations, Apprentissages), CY Cergy Paris Université

On les dit désengagés, indifférents, repliés sur leurs écrans. Et si les jeunes, notamment ceux des quartiers populaires, inventaient simplement d’autres manières de s’impliquer ? Sur les réseaux sociaux, leurs « likes », partages et prises de parole esquissent une nouvelle forme de citoyenneté, plus diffuse mais bien réelle.
L’engagement est souvent entendu comme une participation pérenne à une organisation syndicale ou partisane. Focalisée sur le capital politique, cette conception ignore les formes d’engagement émergentes dites « par le bas ». Elle se limite à considérer l’habitus politique qui se manifeste à travers l’investissement associatif, la prise de parole publique, le goût du débat, et repose sur une disponibilité matérielle et temporelle au bénévolat.
Mais alors, qu’en est-il de celles et ceux qui ne présentent pas ces dispositions et ces ressources ? Sont-ils dépourvus de toute capacité de réflexion critique et de participation au monde qui les entoure ?
C’est précisément autour de ces interrogations que j’ai centré une partie importante de mon travail doctoral. Si les jeunes de classes populaires s’inscrivent peu dans des collectifs associatifs traditionnels, ils n’en sont pas moins animés de combats et de convictions.
En m’inspirant d’un ensemble de travaux qui étudient les mobilisations juvéniles, je montre qu’ils développent de nouvelles formes d’engagement à travers leurs sociabilités numériques. C’est l’un des enseignements que je tire d’une ethnographie en ligne, menée pendant un an sur les comptes Snapchat de 14 jeunes (8 filles et 6 garçons) de cités de Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France hexagonale ?
L’engagement des jeunes aujourd’hui : associations et causes partagées sur les réseaux sociaux
L’engagement se définit comme la capacité d’une personne à s’impliquer volontairement, dans une certaine durée, en faveur d’une cause. Il implique une forme de contrat moral qui unit une personne à ce qu’elle entend défendre. L’engagement ne repose donc pas systématiquement sur la participation à des collectifs associatifs – même si cette dimension demeure essentielle dans certains contextes –, mais sur la défense d’une cause en laquelle on croit, quels qu’en soient les voies et les moyens.
Aujourd’hui, divers chercheurs de la jeunesse s’accordent à dire que les formes d’engagement se sont transformées, non seulement dans les causes qui en sont l’objet, passant de luttes sociales à des enjeux civils, mais aussi dans leurs modes d’expression. Ces travaux montrent que les réseaux sociaux numériques offrent un terrain privilégié de visibilité et de socialisation.
Pour étudier l’engagement des jeunes, il ne suffit plus en effet de mesurer leur taux de participation aux élections politiques ou leur mobilisation associative. Il convient également de prendre en compte des formes d’investissement liées aux loisirs (sport, art, culture) ainsi qu’à d’autres actions moins visibles : être délégué de classe ou signer une pétition en ligne par exemple. En élargissant le spectre, on constate aisément que les jeunes ne se désintéressent pas des causes sociales qui traversent leur quotidien.
Le dernier rapport de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), « État d’esprit et engagement des jeunes en 2025 » enseigne que trois jeunes âgés de 15 à 30 ans sur dix déclarent avoir consacré bénévolement du temps à une association au moins une fois par mois au cours des douze derniers mois.
Si l’engagement est plus important chez les jeunes ayant de bonnes conditions matérielles, autrement dit du temps et de l’argent, le rapport souligne la réalité d’un engagement « multidomaines » : éducation, culture ou loisirs, environnement, causes humanitaires ou sociales, etc. La principale forme de participation à la vie citoyenne et politique tient même dans la signature de pétitions ou la défense d’une cause en ligne : une pratique qui concerne 40 % des jeunes de 15 à 30 ans.
L’engagement des jeunes sur les réseaux sociaux : solidarités et dénonciation des injustices
Les jeunes de quartiers populaires développent sur leurs espaces numériques de véritables pratiques engageantes. Différents profils se dégagent : ceux qui dénoncent directement les injustices, ceux qui préfèrent en rester spectateurs, et ceux qui cherchent à élargir leur audience en partageant massivement des informations qui circulent. Parcourant leur quotidien, leurs combats vont du soutien au commerce local à la dénonciation d’inégalités de genre (notamment pour les filles), de violences commises par la police, jusqu’à l’expérience du racisme.
Les jeunes partagent également des informations pour promouvoir des initiatives locales : une mère qui vend des gâteaux, un voisin qui ouvre son restaurant, un nouveau garage de bricolage dans le quartier… En rendant visibles ces activités, ils cherchent à « donner de la force » à ceux qui essaient de s’en sortir. C’est le cas de Zayan (19 ans) :
« Un chanteur du quartier va sortir une musique, il va nous dire de partager, on va partager. Quelqu’un du quartier commence à travailler dans un garage, là il travaille, on va partager son garage. On va donner de la force un peu. On va faire en sorte que son nom soit entendu sur les réseaux. »
Des filles investies dans le féminisme antiraciste
Concernant la thématique des injustices sociales, deux grandes causes ressortent. Les filles, particulièrement les majeures, font en ligne l’apprentissage d’un féminisme antiraciste. Certaines suivent plusieurs pages de collectifs ou de personnalités militantes (par exemple, la page d’Assa Traoré rencontre un grand succès).
Dans leurs échanges, la sémantique rappelle les milieux militants comme l’expression « beauty privilege ». Celle-ci renvoie au combat des femmes noires, longtemps réduites au statut d’objet sexuel et exclues du cercle des « beautés nobles ». Cherchant à renverser les stigmates dont elles sont la cible, elles utilisent les réseaux sociaux pour affirmer leur présence : elles y publient des photos d’elles très maquillées, parfois sexualisées, là où elles se voient opprimées dans un espace public contrôlé par le machisme. Par cette pratique défiant la culture traditionnelle, elles revendiquent une liberté d’existence. Comme le dit Lisa, 18 ans :
« Avant je me sentais pas bien, je publiais rien et je jugeais aussi les filles qui publiaient des photos d’elles. Après j’ai appris qu’elles étaient vraiment jugées de faire ça. Maintenant que je sais qu’est-ce que ça fait, par exemple une personne va me dire que c’est pas bon je vais le faire pour nous soutenir. »
Jade, 18 ans, appuie cette idée d’émancipation :
« Par exemple une fille ronde et qui se dit : “J’ai pas envie de montrer tout ça”, ou comme une fille très mince elle va se dire “Ouais, je suis très mince, je ne me plais pas car j’ai pas de masse, en gros, c’est pas bien.” Mais moi, je montre que je m’en fous, que je suis ronde et je vais me montrer comme une fille mince peut se montrer aussi. Ça ne change rien. »
Une dénonciation des violences policières
Les violences commises par la police à l’encontre des jeunes garçons racisés (noirs ou maghrébins) et l’expérience du racisme forment une autre thématique qui mobilise fortement. La médiatisation massive des faits, relayés aussi bien par les chaînes télévisées que par les réseaux sociaux, contribue à attester leur gravité. Par leurs publications, les jeunes nourrissent l’espoir d’une reconnaissance de ces injustices en même temps qu’ils se construisent une communauté de vécu face à des réalités qui les encouragent à se soutenir les uns entre les autres :
« Eux, les gens riches, ils ne vont pas poster des voitures cramées, des voitures qui brûlent. Eux, ils vont poster des trucs simples, des trucs beaux, de l’art par exemple. Les gens de cités vont publier la police qui est en train de passer, de les insulter, c’est pour ça qu’après, certains adultes vont critiquer les jeunes de cités. » Umar, 17 ans.
Le terreau de luttes émancipatrices ?
Les résultats de ma thèse rejoignent ainsi des conclusions exprimées par diverses recherches : ils démontrent une véritable capacité d’agir des jeunes par rapport à leur vie dans la cité.
Sur les réseaux sociaux, ces jeunes apprennent entre eux, partagent leurs modes d’existence et leurs combats quotidiens, comme autant de prémisses d’une conscientisation des rapports de domination qui les entourent. Le processus s’accompagne parfois d’un esprit de révolte susceptible d’encourager des mouvements de protestation violents.
Il suffit d’observer l’actualité récente – qu’il s’agisse du soulèvement de la génération Z au Népal, au Maroc ou des émeutes en France à l’été 2023. Ces mobilisations urbaines ont été largement orchestrées via les réseaux sociaux numériques.
N’en déplaise à ceux qui jugent de façon péremptoire que la jeunesse « n’est plus ce qu’elle était », ces épisodes démontrent que l’engagement de la jeunesse n’est pas en voie de disparition. Elle se manifeste dans d’autres espaces de socialisation que la recherche, mais, surtout, les acteurs éducatifs devraient plus prendre au sérieux et de façon désensibilisée.
![]()
Rosa Bortolotti a reçu des financements du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis pour la réalisation d’une partie de la recherche doctorale.
– ref. Jeunesse populaire : sur les réseaux, un nouvel art de l’engagement – Exemple en Seine-Saint-Denis, avec Snapchat – https://theconversation.com/jeunesse-populaire-sur-les-reseaux-un-nouvel-art-de-lengagement-exemple-en-seine-saint-denis-avec-snapchat-265609