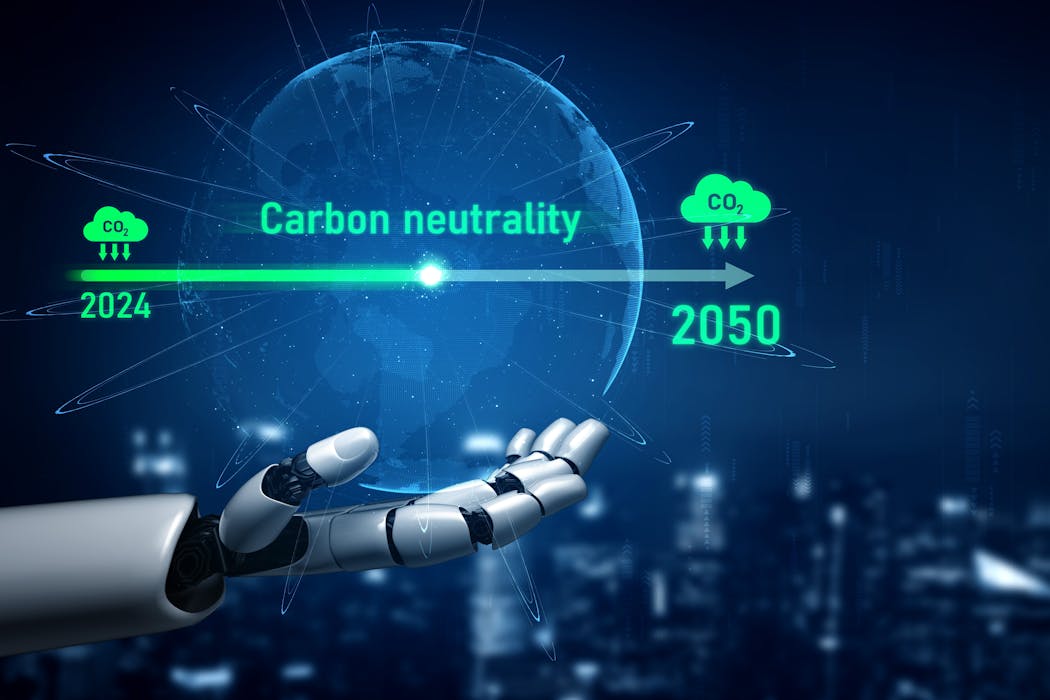Source: The Conversation – France in French (3) – By Fabrice Lollia, Docteur en sciences de l’information et de la communication, chercheur associé laboratoire DICEN Ile de France, Université Gustave Eiffel
Antananarivo, 12 octobre 2025, le président Rajoelina a pris la fuite et l’armée s’est emparée du pouvoir, à l’issue d’une vaste mobilisation de la jeunesse, largement alimentée par la circulation d’images et d’informations sur les réseaux sociaux. Une enquête conduite peu après les événements montre la façon dont les Malgaches construisent leur vision de la vie politique dans l’espace numérique.
En septembre 2025, alors que la crise socio-politique s’intensifie à Madagascar, une réalité s’impose discrètement mais puissamment : l’essentiel du débat public ne se joue plus sur les ondes ni dans les colonnes des journaux, mais dans les flux rapides et émotionnels de Facebook et WhatsApp. En quelques minutes, une rumeur peut mobiliser, inquiéter, rassurer ou diviser. En quelques heures, elle peut redessiner la perception collective d’un événement.
Les résultats de notre récente enquête menée auprès de 253 répondants, complétés par 42 contributions qualitatives, révèlent que la crise est autant une crise politique qu’une crise de médiation où les réseaux sociaux deviennent les principaux architectes du réel. Derrière la simple perception de réseaux sociaux dédiés à la transmission d’informations, ils façonnent les émotions, orientent les interprétations et reconfigurent la confiance.
Ce basculement, largement anticipé par les sciences de l’information et de la communication (SIC), s’observe ici avec une netteté particulière. Les médiations traditionnelles (radio, télévision, presse) cèdent du terrain à des dispositifs socio-techniques qui redéfinissent la manière dont les citoyens perçoivent, réagissent… et croient.
Derrière la crise malgache, c’est donc une transformation plus profonde qui apparaît. C’est celle d’un espace public recomposé où l’attention, l’émotion et la vitesse deviennent les nouveaux moteurs de l’opinion malgache.
La fin des médiations traditionnelles : vers un nouvel environnement cognitif
Le déplacement observé dans l’enquête – de la radio et de la presse vers Facebook et WhatsApp – illustre ce que Louise Merzeau appelait une médiation environnementale. C’est-à-dire que l’information ne circule plus dans des canaux distincts mais s’inscrit dans un environnement continu, ubiquitaire, où chacun est simultanément récepteur et relais.
Dominique Cardon rappelait que les plateformes numériques transforment la visibilité publique selon des logiques de hiérarchisation algorithmique qui ne reposent plus sur l’autorité éditoriale mais sur la dynamique attentionnelle.
L’enquête confirme ce point : les Malgaches ne s’informent pas sur les réseaux, ils s’informent dans les réseaux, c’est-à-dire dans un écosystème où la temporalité, la viralité et l’émotion structurent la réception de l’information.
Conformément à un phénomène analysé dans les travaux de Manuel Castells, nous passons d’un modèle de communication de masse vertical à un modèle de « mass self communication », intensément horizontal, instantané et émotionnel.
Les plateformes comme infrastructures du réel : une crise des médiations
Yves Jeanneret indiquait que la communication n’est pas un simple transfert d’informations mais un processus qui transforme les êtres et les formes. Les résultats de l’enquête malgache confirment cette thèse.
L’enquête montre que 48 % des répondants déclarent avoir modifié leur opinion après avoir consulté des contenus numériques. Ce chiffre illustre ce que Jeanneret appelle « la performativité des dispositifs » : les messages ne se contentent pas de signifier ; ils organisent des parcours d’interprétations, orientent des sensibilités et éprouvent des affects.
La crise malgache est ainsi moins une crise de l’information qu’une crise des médiations, où l’autorité symbolique se déplace vers des acteurs hybrides (groupes WhatsApp, influenceurs locaux, communautés émotionnelles, micro-réseaux sociaux affinitaires).
L’espace public affectif : l’émotion comme norme d’intelligibilité
Les données de l’enquête – les répondants disent éprouver colère, peur, tristesse mais aussi espoir – confirment le constat formulé par Yves Citton selon lequel nous vivons dans un régime d’attention émotionnelle où les affects structurent la réception bien plus que les faits.
La viralité observée relève de ce que Morin nommait la logique dialogique. C’est-à-dire que le numérique agrège simultanément les forces de rationalisation (recherches d’informations, vérification) et les forces d’irrationalité (panique, rumeurs, indignation…). Ce qui circule, ce ne sont pas seulement des informations, ce sont des structures affectives, des dispositifs d’émotion qui modulent les perceptions collectives. Danah Boyd évoquait à ce propos le « context collapse », à savoir l’effondrement des cadres sociaux distincts qui expose les individus à des flux ininterrompus d’émotions hétérogènes sans médiation contextuelle.
Dans ce paysage, l’émotion devient un raccourci cognitif, un critère de vérité, voire un mode d’appartenance.
Une crise de confiance plus qu’une crise d’information
Dominique Wolton insistait sur le fait que la communication politique repose d’abord sur un contrat de confiance et non sur la quantité d’information disponible. L’enquête malgache montre que ce contrat est rompu : il en ressort que les réseaux sociaux sont jugés peu fiables (2,4/5) mais sont massivement utilisés ; que les médias traditionnels sont perçus comme prudents ou silencieux ; que la parole institutionnelle est jugée trop lente ; et que les algorithmes sont accusés de censure.
En résulte une fragmentation du récit national, chaque groupe social reconstruisant son propre réel, comme l’ont montré Alloing et Pierre dans leurs travaux sur les émotions et la réputation numérique. La crise révèle ainsi une dissociation entre l’autorité de l’information (affaiblie) et l’autorité des narratifs (renforcée).
De la désinformation à la fragilité cognitive : une lecture écosystémique
Réduire la situation à un phénomène de « fake news » serait, pour reprendre Morin, une « erreur de réduction ». La désinformation n’est ici que la surface visible d’un phénomène bien plus profond, qui est celui de la vulnérabilité cognitive structurelle. Elle repose sur : la saturation attentionnelle, la rapidité des cycles émotionnels, la fragmentation des médiations, le déficit de littératie médiatique et l’architecture algorithmique des plates-formes.
L’ensemble de ces éléments forment un écosystème au sens de Miège, dans lequel l’information et la communication ne peuvent être séparées des logiques techniques, économiques et sociales qui les produisent. C’est dans ce cadre que la souveraineté cognitive devient une question stratégique comparable à ce que Proulx appelait la nécessité de « réapprendre à habiter en réseaux ».
La nécessité d’une transition cognitive révélée par la crise
L’enquête révèle l’urgence, à Madagascar, d’opérer une transition cognitive. Cela implique une veille capable de détecter rapidement les signaux faibles, une communication publique adaptée au rythme émotionnel des plateformes, une éducation critique aux biais de réception et une coopération structurée entre État, régulateurs, société civile et plateformes pour encadrer la circulation des contenus.
Ces pistes s’inscrivent dans la perspective d’un « État élargi », c’est-à-dire un État qui reconnaît que la stabilité collective dépend désormais de nouveaux acteurs : infrastructures numériques, entreprises technologiques, médias sociaux, communautés connectées. Dans ce modèle, la confiance devient une infrastructure qui est le socle indispensable au fonctionnement de la vie publique, à l’image de l’électricité ou des réseaux de communication.
La crise malgache de 2025 n’est pas un accident. C’est un révélateur des transformations profondes de nos sociétés numériques. Elle montre un espace public recomposé où s’entremêlent architectures techniques globales, émotions collectives locales et médiations affaiblies. Elle a aussi entraîné une prise de conscience au sein des médias malgaches, qui développent désormais une approche plus réflexive sur ces enjeux. Comme l’écrivait Merzeau, « la mémoire est un milieu » ; en 2025, à Madagascar, le réel l’est devenu aussi.
Le défi dépasse largement la lutte contre la désinformation. Il s’agit désormais de reconstruire des médiations fiables, capables d’articuler faits, émotions et légitimité dans une écologie informationnelle où le vrai ne circule plus seul, mais au milieu de récits concurrents, d’affects partagés et d’algorithmes invisibles.
![]()
Fabrice Lollia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Ce que révèle l’enquête sur le rôle des réseaux sociaux dans la crise de Madagascar 2025 – https://theconversation.com/ce-que-revele-lenquete-sur-le-role-des-reseaux-sociaux-dans-la-crise-de-madagascar-2025-271152