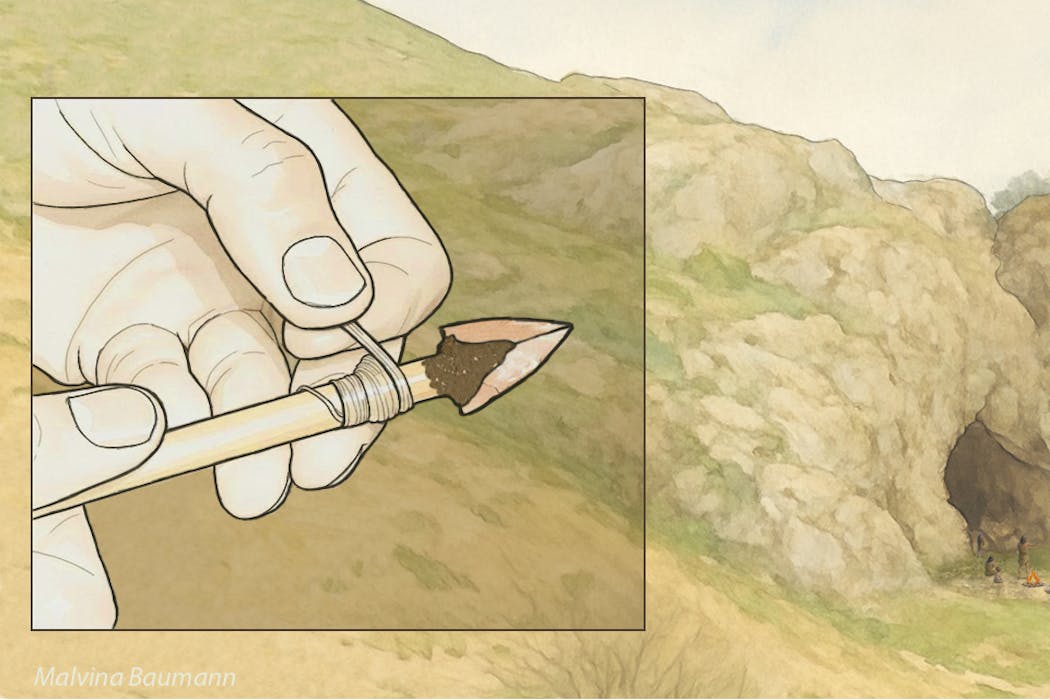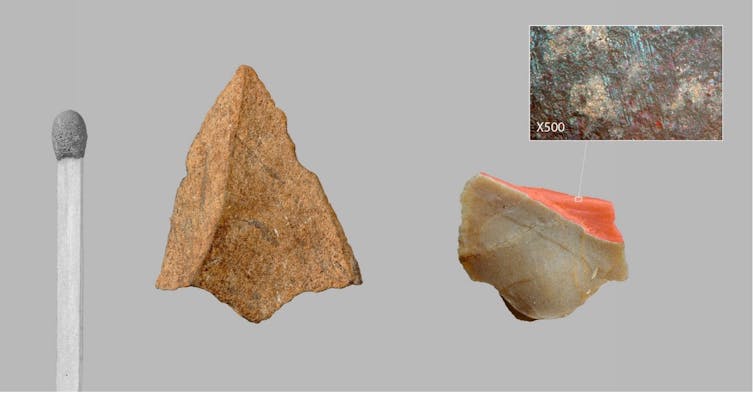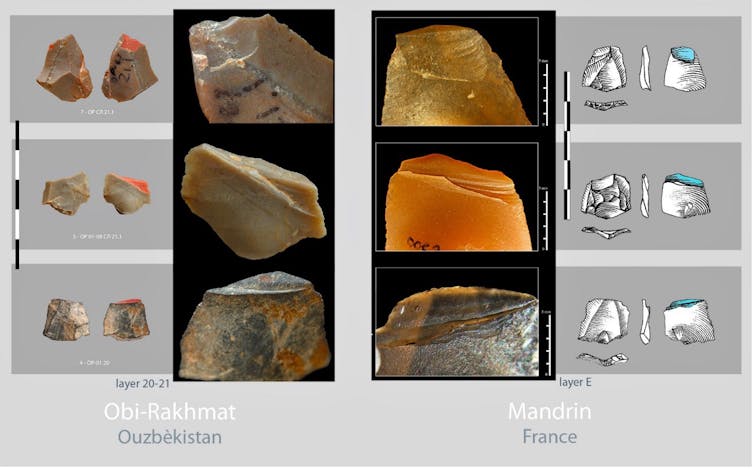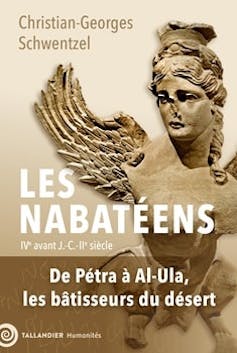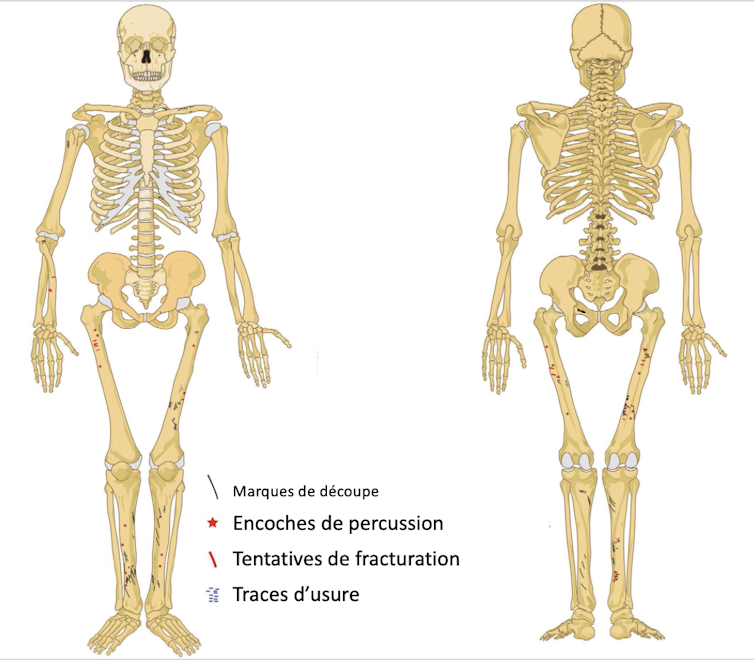Source: The Conversation – in French – By Olga Gille-Belova, Maître de conférences au Département d’Études slaves, Université Bordeaux Montaigne
Plus de mille prisonniers politiques croupissent toujours dans les geôles d’Alexandre Loukachenko, au pouvoir sans discontinuer depuis 1994. Mais 123 d’entre eux, dont de nombreux responsables d’opposition de premier plan, viennent d’être libérés, en contrepartie de la levée de certaines sanctions américaines. Un « deal » qui s’inscrit dans le contexte plus large de l’implication de Minsk aux côtés de Moscou face à l’Ukraine.
La libération de 123 prisonniers politiques, le 13 décembre 2025, constitue un événement majeur pour le Bélarus, par son ampleur, par la notoriété de plusieurs détenus concernés, mais aussi par le contexte : cette vague s’inscrit dans une séquence de négociations et de marchandage diplomatique entre l’administration Trump et le régime d’Alexandre Loukachenko.
Selon Viasna, principale ONG bélarusse de défense des droits humains, il restait encore 1 110 prisonniers politiques au 15 décembre 2025. Depuis 2020 et la répression massive du mouvement de contestation né pour dénoncer le trucage par Alexandre Loukachenko de l’élection présidentielle tenue le 9 août de cette année-là, qui lui avait permis d’obtenir un sixième mandat consécutif, 4 288 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme pour des raisons politiques.
Une répression née en 2020 et devenue structurelle
En 2020, les arrestations ciblées avaient débuté dès le printemps, pendant la période préélectorale, dans une logique préventive visant à neutraliser des adversaires jugés dangereux – comme Viktor Babaryko ou Sergueï Tikhanovski, condamnés à respectivement 14 et 18 ans de prison en 2021.
Le pic correspond toutefois à l’après-élection présidentielle du 9 août 2020, période marquée par une mobilisation durable contre Alexandre Loukachenko, officiellement déclaré vainqueur – malgré les multiples preuves de fraude massive – avec 80 % des voix face à Svetlana Tikhanovskaïa, épouse de Sergueï et soutenue par l’ensemble de l’opposition démocratique.
Durant plusieurs mois, l’objectif du pouvoir est clair : étouffer une contestation perçue comme une menace pour la survie du régime. Arrestations, violences, condamnations : l’appareil coercitif est mobilisé pour briser la dynamique de rue et dissuader toute possibilité de protestation. Les années suivantes, la répression se poursuit, mais de manière plus diffuse : l’arbitraire et l’intimidation deviennent des instruments de contrôle, destinés à empêcher toute remobilisation.
Cette répression marque un durcissement du régime autoritaire bélarusse, qui se traduit également dans les modifications législatives : les infractions existantes voient leur définition élargie, et de nouvelles sont incluses dans le code pénal ; les peines sont alourdies ; des restrictions administratives et des outils de « labellisation » (extrémisme, terrorisme) permettant de criminaliser des actes ordinaires (reposts sur Internet, dons à des organisations indésirables, etc.) sont mis en place.
La répression ne vise plus seulement les personnes arrêtées à l’intérieur du pays. Depuis juillet 2022, une procédure pénale spéciale permet de juger un accusé en son absence, notamment lorsqu’il vit à l’étranger. Les procès par contumace deviennent ainsi un outil majeur de répression transnationale contre l’opposition en exil (responsables politiques, journalistes, activistes, chercheurs).
Dans ce cadre, 18 personnes – dont Svetlana Tikhanovskaïa (pour 14 ans) et son allié Pavel Latouchko (18 ans) – sont condamnées en 2023, et 114 autres en 2024.
Des libérations sous contrôle : de la mise en scène intérieure au marchandage externe
Les premières libérations significatives interviennent en 2023, avec un objectif d’abord tourné vers le public intérieur : montrer la « magnanimité » du bat’ka (« petit père », surnom de Loukachenko promu par la propagande), à l’égard de ceux qui acceptent de « se repentir ». Le régime met en scène ces séquences de manière spectaculaire, comme une véritable pédagogie de la soumission.
La libération, le 22 mai 2023, de Roman Protassevitch, qui avait été arrêté après l’atterrissage forcé d’un vol Ryanair en 2021, illustre cette logique : le détenu libéré a offert, face caméra, un récit de repentance, largement médiatisé, voué à servir d’exemple à tous ceux qui seraient tentés de se rebeller contre le régime.
Dans le même esprit, une « commission de retour » a été créée par le décret présidentiel n° 25 du 6 février 2023. Elle ne correspond pas à une commission de grâce au sens strict : il s’agit d’une structure interinstitutionnelle destinée à traiter les demandes des Bélarusses vivant à l’étranger (un demi-million de personnes ont émigré depuis 2020) et souhaitant rentrer, en particulier ceux qui reconnaissent avoir commis des infractions et demandent pardon. Parallèlement, des détenus arrêtés lors des manifestations commencent à être libérés progressivement, notamment parce qu’ils arrivent au terme de leur peine (plus de 50 libérations en septembre 2023).
En 2024, les libérations prennent la forme de « vagues de grâce » associées à des moments symboliques (commémorations du 9 mai, événements politiques). L’année 2024 consacre aussi une consolidation institutionnelle après la réforme constitutionnelle adoptée par référendum le 27 février 2022.
Dans une apparente normalité, un nouveau cycle électoral s’ouvre le 25 février 2024, par un « jour de vote unique » qui combine élections législatives (110 députés) et municipales (plus de 12 000 sièges). Les scrutins offrent une large victoire aux forces pro-gouvernementales, en particulier à Belaïa Rous’. Puis, les 24–25 avril 2024, la première réunion de l’Assemblée populaire pan-bélarusse (Vsebelorusskoe narodnoe sobranie, VNS), élevée au rang d’organe constitutionnel, se conclut par la désignation de Loukachenko à la tête de son présidium. Le 26 janvier 2025, l’élection présidentielle entérine sa reconduction pour un septième mandat, avec un score officiel proche de 87 % et une participation dépassant les 85 %.
En 2025, la logique change : les libérations s’inscrivent davantage dans une stratégie de marchandage externe, principalement avec l’administration de Washington, et traduisent la volonté de Minsk de tester une normalisation des relations avec les pays occidentaux sans susciter la désapprobation de Moscou.
Après la visite, le 12 février 2025, du diplomate américain Christopher Smith (chargé du dossier bélarusse au Département d’État), trois détenus sont libérés le même jour (dont un citoyen des États-Unis) et transférés vers la Lituanie. La visite de l’envoyé spécial Keith Kellogg, accompagné de son adjoint John Cole et de Christopher Smith, les 20–21 juin 2025, est suivie par la libération de 14 prisonniers, dont Sergueï Tikhanovski (époux de Svetlana Tikhanovskaïa).
Les 10–11 septembre 2025, une nouvelle visite permet la libération négociée de 52 prisonniers, transférés vers la Lituanie, en échange d’un assouplissement des sanctions américaines, notamment visant la compagnie aérienne Belavia. On note également la présence de militaires américains comme observateurs lors des exercices militaires russo-bélarusses Zapad-2025, organisés près de Borisov.
Finalement, le 12 décembre 2025, le retour de John Cole à Minsk se solde par la libération de 123 personnes, dont Ales Bialiatski (prix Nobel 2022, fondateur de Viasna), Viktor Babaryko, ou encore les éminents représentants de l’opposition Maria Kolesnikova et Maxim Znak.
Cent quatorze d’entre eux sont ensuite transférés vers l’Ukraine et reçus par le président Volodymyr Zelensky le 13 décembre.
Cette libération s’est faite en échange d’une levée des sanctions américaines sur la potasse. John Cole s’est dit confiant quant à la libération de milliers de prisonniers politiques restants dans les mois à venir.
Le troc libérations/sanctions : un mécanisme déjà éprouvé avec l’UE
Ce mécanisme n’est pas nouveau. Après l’élection du 19 décembre 2010, plus de 700 personnes avaient été arrêtées lors de la répression d’une manifestation de contestation, dont plusieurs candidats. Par la suite, au moins 40 avaient été condamnées à des peines de prison ferme. Elles seront libérées entre 2011 et 2015 via la grâce présidentielle, généralement à condition de reconnaître les faits, demander la grâce et promettre de cesser toute activité politique.
Après la répression de 2010–2011, l’UE lie explicitement toute amélioration durable des relations avec Minsk à des progrès en matière de droits fondamentaux – au premier rang desquels figure la libération des prisonniers politiques. Ces libérations conduisent à un assouplissement des sanctions de l’UE, puis à une relance à partir de 2015 d’une coopération (Partenariat oriental, discussions sur facilitation des visas et réadmission, etc.).
Plusieurs analyses soulignent toutefois qu’à l’époque l’UE privilégie une logique de stabilité régionale plutôt qu’un changement structurel du régime bélarusse.
Le retour américain : dividendes diplomatiques rapides et divers gains pour Minsk
Cette fois, ce n’est pas Bruxelles, mais Washington qui prend l’initiative. Ses démarches s’inscrivent dans un cadre plus large – celui des discussions autour d’un règlement de la guerre en Ukraine –, mais elles produisent des résultats rapides.
D’un côté, l’administration Trump peut revendiquer des « dividendes » visibles : des libérations, médiatisées, présentées comme des avancées en matière de droits humains. De l’autre, Loukachenko remporte une victoire diplomatique : l’accueil de délégations américaines le repositionne comme interlocuteur « fréquentable » et contribue à sa légitimation internationale après des années d’ostracisation.
Minsk gagne aussi sur le terrain économique, tant la potasse occupe une place structurante dans l’économie bélarusse. Pour rappel, le chlorure de potassium entre dans les engrais « potassiques » largement utilisés en agriculture. Sa disponibilité et ses prix ont une répercussion directe sur les coûts des produits agricoles au niveau mondial. Il est également utilisé en industrie chimique, notamment dans la fabrication de savons/détergents, et de manière plus marginale dans l’industrie alimentaire comme substitut de sel ou additif. En 2019, Belaruskaliï (monopole d’État) représentait près de 20 % de la production mondiale de potasse, environ 4 % du PIB et 7 % des exportations bélarusses, constituant une source majeure de recettes fiscales et de devises, aux côtés de la transformation du pétrole russe.
Les sanctions américaines (août 2021), puis européennes (2022), ont entraîné une chute importante de la production, une réorientation des exportations vers la Russie et la Chine à partir de 2023 et une pression sur les prix. En ce sens, la levée des sanctions sur la potasse peut améliorer les finances publiques et desserrer la dépendance accrue de Minsk vis-à-vis de Moscou.
La coopération américaine avec Minsk a déjà été perçue comme un moyen d’éloigner le Bélarus de la Russie. Durant le premier mandat Trump, la visite à Minsk de Mike Pompeo, alors secrétaire d’État, le 1er février 2020, s’inscrivait dans une tentative de normalisation après des années de gel diplomatique. Elle était intervenue à un moment de tensions entre Minsk et Moscou, notamment autour de l’énergie. Pompeo avait alors annoncé que les producteurs américains seraient prêts à fournir au Bélarus jusqu’à 100 % de ses besoins en pétrole à des prix « compétitifs », ce qui avait irrité la Russie. Ce rapprochement Washington-Minsk avait été mis à l’arrêt à partir de la répression à grande échelle déclenchée par Loukachenko à partir d’août 2020.
Une fracture possible entre Washington et Bruxelles ?
Commentant la levée partielle de sanctions, la cheffe de l’opposition en exil Svetlana Tikhanovskaïa a déclaré :
« Les sanctions américaines visent des personnes. Les sanctions européennes visent un changement systémique : mettre fin à la guerre, permettre une transition démocratique et garantir que les responsables rendent des comptes. Ces approches ne sont pas contradictoires ; elles se complètent mutuellement. »
Jusqu’ici, les positions américaine et européenne étaient globalement alignées (non-reconnaissance de la légitimité de Loukachenko, sanctions, soutien à l’opposition). Les initiatives de l’administration Trump ouvrent néanmoins une brèche : si Washington assouplit sa posture, combien de temps les Européens pourront-ils maintenir une ligne ferme – sanctions, soutien à l’opposition, refus de légitimation – dans un climat transatlantique plus incertain ?
Les responsables européens ont salué les libérations et la médiation américaine, tout en réaffirmant que les sanctions de l’UE relèvent de décisions européennes et qu’elles restent en place au regard des objectifs stratégiques de l’Union. Par ailleurs, d’après les informations publiques disponibles, l’UE ne semble pas avoir été associée aux négociations elles-mêmes ; elle aurait plutôt été informée et consultée en aval, notamment pour organiser l’accueil des personnes libérées.
De son côté, Loukachenko s’est empressé de dissiper tout doute quant à sa fidélité vis-à-vis de Moscou. Il a insisté publiquement sur le fait qu’un « gros deal » avec Washington ne se ferait « pas aux dépens de la Russie » et qu’il est « en plein accord » avec Vladimir Poutine. En l’absence de commentaire officiel du Kremlin, on peut supposer que les dirigeants russes ont été informés des négociations.
Quel impact sur le régime et sur l’opposition en exil ?
La rapidité des libérations interroge sur la perception que le régime a de l’opposition. Loukachenko semble suffisamment assuré de la solidité du système pour ne plus craindre une déstabilisation intérieure. À ses yeux, l’opposition en exil serait marginalisée, sans relais dans la société, et divisée par des rivalités internes. Le pouvoir n’a jamais cherché à emprisonner tous ses opposants : il leur a souvent laissé la possibilité de quitter le pays – ou l’a imposée (Maria Kolesnikova avait été emprisonnée après avoir déchiré son passeport à la frontière afin d’éviter une expulsion).
L’opposition s’est reconstituée à l’étranger, notamment entre Vilnius et Varsovie, avec des structures quasi gouvernementales : le bureau de Sviatlana Tikhanovskaïa, à la fois plate-forme de coordination des forces démocratiques, vitrine internationale et point de contact institutionnel ; le Cabinet transitoire unifié, conçu comme un « gouvernement en exil » préparant une éventuelle transition ; le Conseil de coordination, pensé comme une alternative au Parlement, malgré la difficulté à maintenir un lien organique avec la société restée au pays, comme l’a montré la faible mobilisation lors des élections qu’il a organisées en mai 2024. Dans ce contexte, l’action de l’opposition en exil se concentre sur le lobbying pour maintenir ou durcir les sanctions, la documentation des violations des droits humains et la préparation de scénarios de transition. Sa capacité à peser sur l’intérieur demeure limitée, faute de relais organisés et face au coût très élevé de l’engagement politique au Bélarus.
On peut toutefois se demander si Loukachenko n’est pas aveuglé par son opportunisme de court terme et s’il ne sous-estime pas les risques à long terme de ces libérations qui vont redynamiser l’opposition en exil. La diaspora bélarusse n’a jamais été aussi nombreuse (plus d’un demi-million de Bélarusses ont quitté le pays depuis 2020), l’opposition en exil n’a jamais été aussi bien structurée et institutionnalisée, et elle n’a jamais bénéficié d’un soutien aussi important de la part de la communauté internationale – ou, du moins, de l’UE.
Une nouveauté symbolique : l’Ukraine comme pays d’accueil
Si les prisonniers libérés lors des premières vagues ont été transférés vers la Lituanie, la majorité de ceux libérés en décembre 2025 a été, nous l’avons dit, accueillie par l’Ukraine – un fait symboliquement fort. Après 2020, de nombreux Bélarusses avaient fui vers l’Ukraine ; après le début de la guerre en février 2022, une partie a réémigré vers la Pologne et la Lituanie.
Jusqu’ici, l’attitude ukrainienne envers Minsk a été marquée par la prudence, afin d’éviter de pousser Loukachenko vers une implication plus active aux côtés de la Russie. Si Zelensky a condamné la répression de 2020, Kiev ne s’est pas engagé de manière systématique auprès de l’opposition bélarusse en exil. La séquence de décembre 2025 pourrait-elle ouvrir un changement ? Kiev pourrait-il devenir, aux côtés de Vilnius et Varsovie, un troisième pôle politique de l’opposition bélarusse ?
![]()
Olga Gille-Belova ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Libération massive de prisonniers politiques au Bélarus : le deal de Loukachenko avec Washington – https://theconversation.com/liberation-massive-de-prisonniers-politiques-au-belarus-le-deal-de-loukachenko-avec-washington-272185