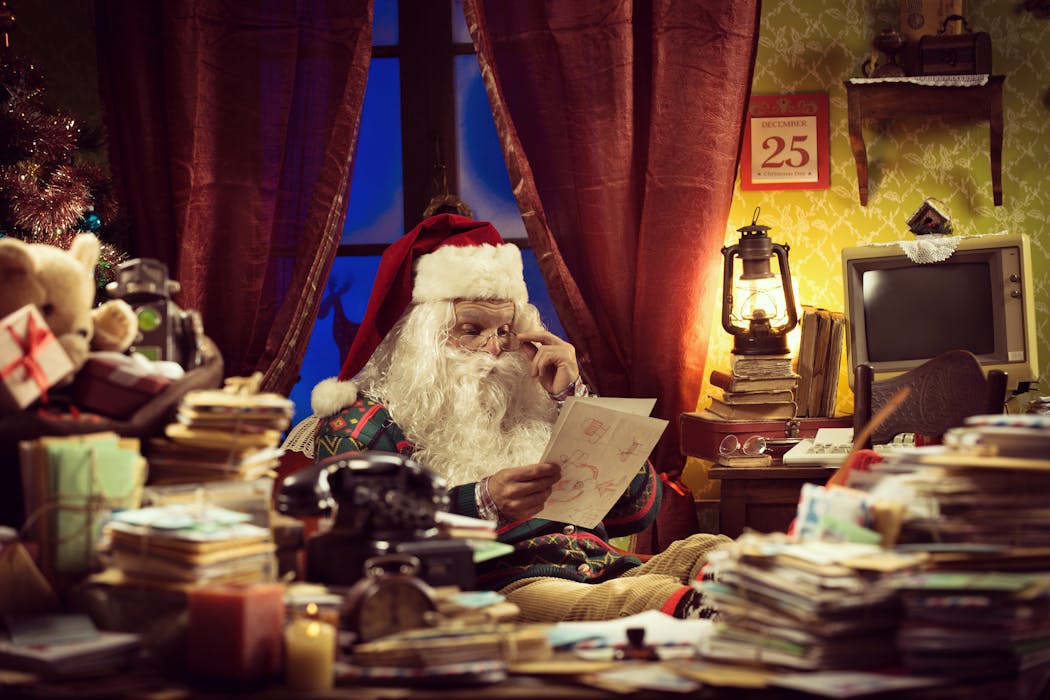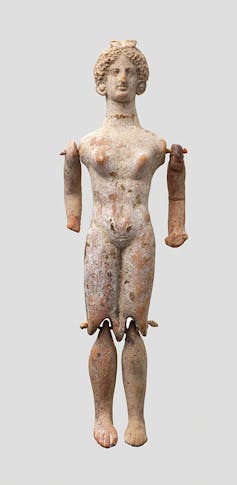Source: The Conversation – in French – By Richard Fosu, Lecturer in International Relations, Monash University
Il ne se passe pratiquement pas un mois sans qu’on apprenne un nouveau changement de gouvernement anticonstitutionnel sur le continent africain.
Ces changements peuvent prendre l’une des trois formes suivantes.
La première est un coup d’État militaire ou un changement violent d’un gouvernement (démocratiquement) élu. La deuxième est le refus d’un gouvernement en place de céder le pouvoir après avoir perdu une élection. Et enfin, la manipulation des Constitutions pour gagner ou prolonger le mandat d’un gouvernement en place.
Nous étudions la paix et les conflits en Afrique, ainsi que le droit de l’Union africaine. Nous avons présenté ces trois catégories dans un article publié en 2023. Nous y avons analysé les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique entre 2001 et 2022.
Nous avons recensé 20 coups d’État, six cas de manipulation constitutionnelle et quatre tentatives de maintien au pouvoir par des dirigeants sortants après avoir perdu les élections.
Ces tendances persistent depuis la publication de notre étude. Le plus récent est le coup d’État militaire en Guinée-Bissau fin novembre 2025.
Face à la persistance des changements anticonstitutionnels de gouvernement, en particulier ce qui a été décrit comme une résurgence des coups d’État en Afrique, nous avons analysé la position de l’Union africaine sur ces trois formes de changement de régime.
La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance de 2007 interdit les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Elle prévoit des sanctions pour rétablir l’ordre constitutionnel lorsqu’ils se produisent.
Nous avons constaté que pour la majorité des coups d’État (17 sur 20 dans notre base de données), l’UA a appliqué strictement les sanctions prévues par la charte afin de rétablir l’ordre constitutionnel. En revanche, le bilan est mitigé lorsque les dirigeants sortants s’accrochent au pouvoir à la suite d’une défaite électorale ou tripatouillent les Constitutions pour prolonger leur mandat.
Read more:
Limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique : la route est encore longue
Ces conclusions nous ont amenés à examiner comment l’UA peut renforcer les mécanismes démocratiques continentaux afin d’empêcher que la « ceinture des coups d’État africains » ne s’étende davantage.
Nous concluons de nos résultats que l’UA doit prendre deux mesures.
Premièrement, éviter les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Pour ce faire, il convient :
-
de favoriser une véritable culture démocratique dans les États africains
-
d’établir des règles claires sur des questions telles que les changements constitutionnels, qui sont souvent instrumentalisés par les dirigeants en place pour rester au pouvoir
-
d’appliquer ces règles sans crainte ni favoritisme.
Deuxièmement, l’UA, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et d’autres organismes régionaux doivent appliquer des sanctions fermes non seulement aux auteurs de coups d’État militaires mais aussi aux dirigeants civils qui manipulent la loi pour rester au pouvoir.
Une histoire marquée par des coups d’État
L’euphorie des indépendances dans toute l’Afrique, après l’indépendance vis-à-vis de la domination coloniale européenne à la fin des années 1950 et dans les années 1960, a été de courte durée.
De nombreux pays africains ont sombré dans des décennies d’instabilité politique, de crises socio-économiques et de guerres civiles. L’un des principaux facteurs à l’origine de cette période a été l’absence de systèmes solides de participation démocratique et de transferts pacifiques du pouvoir.
Sans véritables espaces de participation politique, les coups d’État et contre-coups d’État militaires, les mouvements rebelles et autres moyens violents d’accéder au pouvoir sont devenus la norme.
Entre 1956 et 2001, il y a eu 80 coups d’État réussis, 108 tentatives de coup d’État échouées et 139 complots de coup d’État en Afrique subsaharienne.
Read more:
Afrique de l’Ouest : cinq leçons pour comprendre la vague de coups d’État et préserver la démocratie
En 2000, les dirigeants africains ont décidé, lors d’un sommet au Togo, d’adopter la Déclaration de Lomé. Celle-ci condamnait les coups d’État et autres changements anticonstitutionnels de gouvernement. Il s’agissait du premier instrument continental à établir un cadre pour une réponse collective africaine aux changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Elle a été suivie par la Charte africaine de la démocratie de 2007 et le Protocole de Malabo sur une cour pénale africaine en 2014.
Ces trois instruments prévoient diverses sanctions à l’encontre des États africains et des individus complices de violations des principes démocratiques.
Malgré cela, plusieurs États africains ont encore enregistré des transitions de pouvoir anticonstitutionnelles. Et la réponse de l’UA a été mitigée.
La réponse mitigée de l’UA
Voici quelques exemples que nous avons identifiés.
En 2010, l’UA a soutenu une initiative internationale visant à destituer Laurent Gbagbo après son refus de céder le pouvoir malgré sa défaite à la présidentielle en Côte d’Ivoire.
Le refus de Yahya Jammeh de quitter le pouvoir après avoir perdu les élections de 2016 en Gambie a également suscité une réaction sévère de la part de l’UA. Celle-ci a déclaré qu’elle « ne reconnaîtrait pas » Jammeh. La Cedeao a envisagé de « le destituer par la force militaire » s’il refusait de céder le pouvoir pacifiquement.
Cela dit, il y a eu des manquements notoires, ce qui est regrettable.
Par exemple, la victoire électorale contestée d’Ali Bongo au Gabon en 2016 n’a pas donné lieu à des mesures concrètes de la part de l’UA. Aucune mesure n’a non plus été prise concernant le report des élections en République démocratique du Congo sous Joseph Kabila en 2018.
L’échec le plus flagrant dans la mise en place des principes démocratiques en Afrique a été l’absence de sanctions de la part de l’UA lorsque les dirigeants en place ont manipulé les Constitutions pour prolonger la durée de leur mandat.
Du Burundi à la Côte d’Ivoire, en passant par le Togo et le Zimbabwe, nous n’avons trouvé aucune preuve dans notre base de données que l’UA ait réagi directement à des cas de manipulations constitutionnelles.
Pourtant, dans l’histoire récente, les manipulations constitutionnelles ont été les principaux facteurs déclencheurs d’interventions militaires. Les récents coups d’État au Gabon, en Guinée, au Tchad et au Soudan ont tous été précédés par des manipulations constitutionnelles visant à prolonger ou à abolir la limitation du nombre de mandats.
Nous avons constaté que lorsque l’espace démocratique se réduit et que les citoyens ont le sentiment de ne plus pouvoir exprimer leur désaccord, le risque de soulèvements populaires augmente. L’armée profite souvent de ces moments pour intervenir.
Ce qu’il faut faire
Les traités continentaux sur la démocratie et la bonne gouvernance exigent le strict respect des principes démocratiques et des principes de transfert pacifique du pouvoir.
Pour qu’ils soient efficaces, les mesures suivantes doivent être prises.
Tout d’abord, les principes démocratiques doivent être clairement définis. Par exemple, le fait de modifier la constitution pour supprimer la limitation du nombre de mandats présidentiels au profit d’un président sortant viole-t-il ces principes ? Qu’en est-il de l’élimination des candidats de l’opposition par des manœuvres telles que des poursuites judiciaires motivées par des raisons politiques ?
Deuxièmement, des règles claires doivent être établies sur des questions telles que la limitation du nombre de mandats.
Troisièmement, l’UA, la Cedeao et d’autres organismes régionaux doivent cesser de ménager les pseudo-démocrates dont le comportement invite aux coups d’État. Ils doivent cesser de superviser et d’approuver les élections truquées qui maintiennent ces dirigeants au pouvoir.
Enfin, l’UA peut démontrer son engagement en faveur de la démocratie et de la bonne gouvernance en refusant de récompenser les autocrates. Cela pourrait se traduire par le refus de nommer des autocrates à des organismes importants, tels que le Conseil de paix et de sécurité de l’UA (chargé de surveiller la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent), ou de leur attribuer des présidences tournantes.
Le Dr Christopher Nyinevi, qui travaille à la Cour de justice de la Cedeao à Abuja, au Nigeria, est coauteur de cet article.
![]()
Richard Fosu does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
– ref. Les prises de pouvoir se multiplient en Afrique : la réponse mitigée de l’UA aggrave la situation – https://theconversation.com/les-prises-de-pouvoir-se-multiplient-en-afrique-la-reponse-mitigee-de-lua-aggrave-la-situation-271683