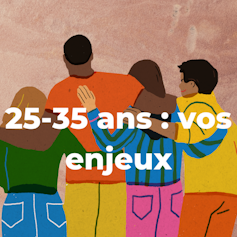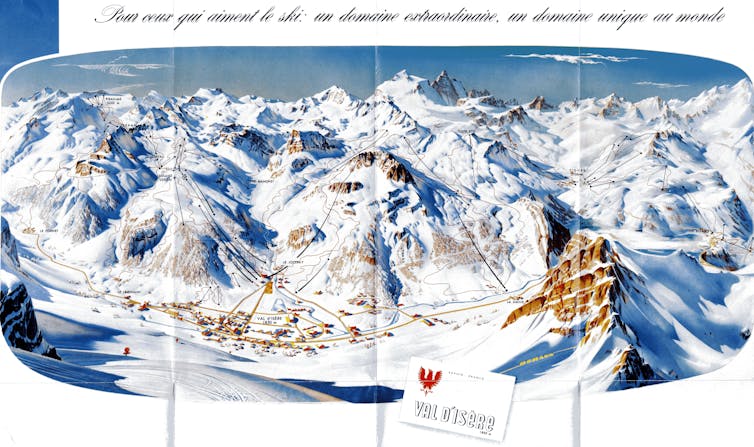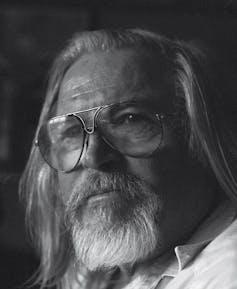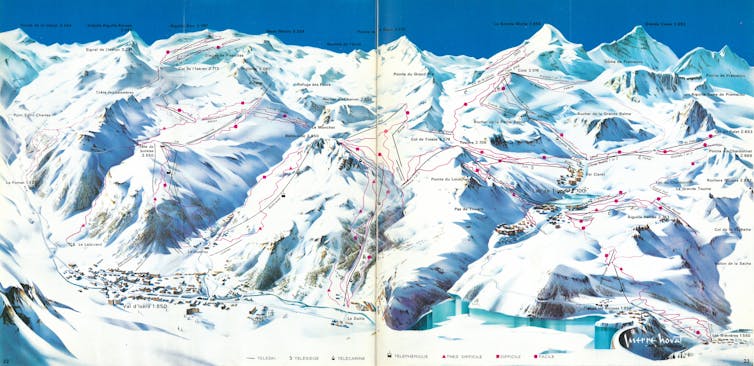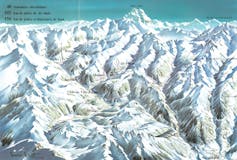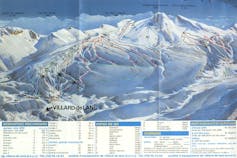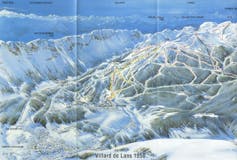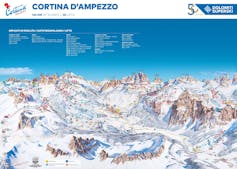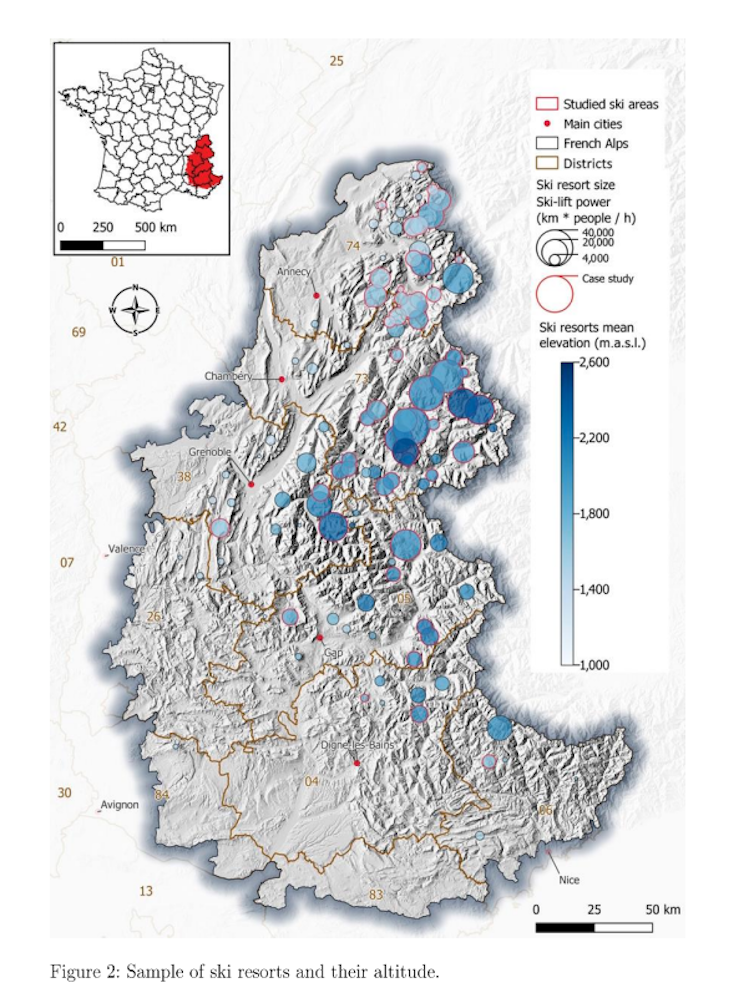Source: The Conversation – France in French (3) – By Pauline Guillou, Chargée de projet scientifique, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
À la maison, les nettoyants en tout genre nous exposent à des substances potentiellement toxiques. Dans la lignée notamment du Nutri-Score -cette échelle qui évalue les aliments en fonction de leur valeur nutritionnelle-, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), propose de noter les produits ménagers en fonction des dangers qu’ils font courir sur la santé humaine et sur l’environnement et de l’afficher sur les emballages. Les ministères concernés doivent désormais se prononcer sur la mise en place d’un tel score, la méthode à retenir et le type d’affichage à apposer.
Les produits ménagers que nous utilisons au quotidien peuvent contenir des substances toxiques pour la santé et l’environnement. Les consommateurs sont d’ailleurs en demande d’informations toujours plus précises sur les impacts des produits qui les entourent, afin d’acheter en toute conscience les produits les moins toxiques.
Pour autant, l’ensemble des substances qui entrent dans la composition de ces produits n’est pas systématiquement affiché sur les emballages. Les obligations en matière d’étiquetage varient en fonction des types de produits et de leurs usages.
(Les emballages des détergents – c’est-à-dire les produits chimiques destinés au lavage et au nettoyage des surfaces, du linge, de la vaisselle, etc.- doivent par exemple indiquer les substances parfumantes et les agents conservateurs qu’ils contiennent, conformément à la réglementation, ndlr).
Enfin, les informations sur les étiquettes sont souvent peu compréhensibles pour les consommateurs. Comment savoir alors quels produits acheter pour limiter les effets nocifs sur sa santé ou l’environnement ?
L’exemple du Nutri-Score appliqué aux produits ménagers
De nombreux scores relatifs aux propriétés de nos produits du quotidien ont vu le jour ces dernières années, le plus connu d’entre eux étant probablement le Nutri-Score, le système d’étiquetage nutritionnel développé pour faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs et ainsi les aider à faire des choix éclairés.
Dans ce contexte, un des objectifs du Plan national santé environnement (PNSE 4) était de renforcer la lisibilité de l’étiquetage des produits ménagers, afin de mieux informer les consommateurs de leurs dangers sur la santé et l’environnement.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a donc proposé un référentiel d’étiquetage pour les produits ménagers afin de guider les consommateurs dans leur acte d’achat.
Différents types de produits ont été considérés dans ces travaux : ceux destinés à l’entretien du linge, des surfaces, des sanitaires et de la vaisselle, ainsi que les insecticides, les répulsifs, les rodenticides (produits biocides utilisés contre les souris, les rats et autres rongeurs, ndlr) et les désodorisants d’atmosphère.
Molécules cancérogènes, reprotoxiques, persistantes dans l’environnement et autres substances nocives
Deux méthodes différentes ont été élaborées afin de catégoriser ces produits selon leur niveau de danger pour la santé et l’environnement. À l’instar du Nutri-Score, un objectif était l’élaboration d’un score facilement calculable par les acteurs industriels afin de leur permettre une meilleure appropriation de l’outil et les encourager à améliorer la composition de leurs produits.
La première méthode se fonde principalement sur les dangers sanitaires et environnementaux de l’ensemble des substances entrant dans la composition des produits. La seconde sur la classification des produits eux-mêmes, selon le règlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage (CLP).
Ces méthodes s’appuient principalement sur des bases de données d’organismes reconnus, par exemple les classifications établies dans le cadre du règlement européen CLP ou la classification du Centre international de recherche sur le cancer (Circ).
L’accent a été mis sur la présence de substances ayant des propriétés particulièrement préoccupantes : cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR), allergisantes respiratoires, perturbation endocrinienne (PE), persistantes, bioaccumulables, mobiles et toxiques. Parmi les molécules qui peuvent être citées, on peut nommer le butylhydroxytoluène (BHT), potentiel perturbateur endocrinien, la famille des salicylates, susceptibles d’effets sur la reproduction ou certains détergents à base d’enzymes qui sont des allergisants respiratoires.
Il est important de savoir que les substances classées comme cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) selon le règlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage (CLP) sont interdites dans les produits ménagers. Cependant, cette interdiction ne s’applique qu’au-delà d’une certaine concentration, ce qui signifie qu’il est donc malgré tout possible de les retrouver en faible quantité dans ces produits.
Sprays, « effet cocktail »… ces usages et compositions qui augmentent le danger
En plus de ces critères de danger, l’Anses propose de tenir compte dans le calcul du score d’autres critères en lien avec le mode d’utilisation et la composition du produit. Par exemple, un produit sous forme de spray, ou qui génère des aérosols, expose davantage son utilisateur qu’un produit sous forme de gel. En effet, du fait de la mise en suspension de particules dans l’air intérieur, ces produits peuvent exposer l’utilisateur par voies respiratoire, cutanée ou oculaire et sont incriminés dans la survenue de pathologies respiratoires notamment l’asthme chez les jeunes enfants.
La présence d’un grand nombre de substances dans un produit peut également constituer un risque supplémentaire puisqu’il augmente la probabilité d’un « effet cocktail » dû à l’interaction des substances. En effet, l’augmentation du nombre de substances accroît la probabilité d’interactions entre celles-ci, et donc l’apparition de nouveaux dangers au-delà même de ceux relevant des substances présentes dans la composition considérée individuellement.
Ceci est également vrai lorsque le produit contient des mélanges inclus, c’est-à-dire préfabriqués. Les responsables de la mise sur le marché du produit final ne connaissent pas nécessairement la composition exhaustive de ces mélanges.
Enfin, la présence de substances considérées comme d’intérêt limité pour l’efficacité du produit, comme les parfums ou les colorants, peut également augmenter la toxicité de certains produits.
Deux scores – environnement et santé – pour des notes de « A » à « E »
À partir de ces différents critères, chaque méthode propose donc le calcul d’un score de « A » à « E » permettant de catégoriser les produits selon leur niveau de danger. Le score « E » correspond au plus haut niveau de préoccupation. Le score « A », associé au plus faible niveau de préoccupation, ne correspond pas pour autant à une absence de danger. Un produit de score « A » se révélera toujours une meilleure option pour le consommateur qu’un produit moins bien classé présentant un danger plus important.
Pour une information claire du consommateur, l’Anses a recommandé que chaque méthode conserve deux scores distincts pour chaque produit, l’un reflétant son impact sur la santé humaine et l’autre celui sur l’environnement. Le choix de maintenir deux scores distincts permet de rendre l’information au consommateur plus transparente. De plus, le choix de ne pas « moyenner » ces deux scores évite une possible compensation, par exemple d’un score défavorable pour la santé par un score favorable pour l’environnement.
Ces méthodes pourront également permettre aux fabricants d’améliorer la composition de leurs produits ménagers. Plusieurs leviers peuvent être envisagés tels que : limiter voire supprimer les substances les plus préoccupantes, diminuer le nombre de substances dans le produit ou encore retirer les substances considérées comme d’intérêt limité.
Une première phase de test sur un panel de produits
L’Agence a testé ces méthodes sur un panel de produits, sélectionnés afin de présenter des caractéristiques différentes les unes des autres : formes (poudres, liquides, sprays…), fonction (désodorisant d’ambiance, nettoyant spécifique ou multi-usage), etc.
Les deux méthodes présentent entre elles des résultats très comparables. Environ 80 % des produits obtiennent un score « E » pour le volet sanitaire contre 15 % pour le volet environnement.
Cette forte disparité entre le volet sanitaire et le volet environnement est frappante mais a une explication : il y a encore trop peu d’évaluations des effets des substances sur l’environnement, jugés moins prioritaires par rapport aux effets sur la santé humaine. Ainsi, de nombreuses substances ne sont pas présentes dans les sources de données consultées, faute d’avoir été évaluées.
À quand un score sur les produits ménagers vendus en magasins ?
Pour rester pertinentes, les méthodes devront évoluer avec les connaissances scientifiques et ainsi améliorer la connaissance du danger réel des produits. Au même titre que les données écotoxicologiques doivent être renforcées, d’autres paramètres pourraient être inclus dans ces méthodes si les sources de données le permettent, par exemple la présence de substances à l’état de nanoparticules ou ayant d’autres effets sur la santé (par exemple une neurotoxicité, c’est-à-dire une toxicité qui affecte le système nerveux).
Les ministères doivent désormais se prononcer sur la mise en place d’un tel score, la méthode à retenir et le type d’affichage à apposer.
En attendant de voir de tels scores sur les étiquettes de nos produits, quelques conseils peuvent d’ores et déjà être suivis par les consommateurs.
Comment limiter son exposition aux substances potentiellement toxiques des produits ménagers
- Adoptez une attitude raisonnée. Par exemple, l’utilisation d’un désinfectant pour nettoyer une surface n’est pas toujours nécessaire, un détergent peut être suffisant;
- Lisez bien les étiquettes des produits et respectez les conditions d’emploi: quantités à appliquer, dilution nécessaire, port de gants ou de lunettes, rinçage, etc. qui limiteront l’impact possible sur votre santé mais aussi sur l’environnement;.
- Favorisez des produits sans parfums et sans colorants: cela garantit un nombre de composants plus réduit dans le produit et, notamment, moins de substances irritantes ou allergisantes;
- Évitez le recours aux produits ménagers sous forme de sprays ou générateurs d’aérosols;
- Aérez votre logement après nettoyage ou après utilisation d’un désodorisant d’intérieur, afin de disperser les substances émises par les produits appliqués;
- Ne mélangez jamais plusieurs produits et ne déconditionnez jamais de produit dans un emballage alimentaire;
- Enfin, gardez toujours tous ces produits hors de portée des enfants.
Cet article s’appuie sur un rapport d’expertise de l’Anses publié en 2025 auquel ont contribué des agents de l’Anses et les experts suivants : Luc Belzunces (INRAE), Alain Aymard (retraité DGCCRF), Nathalie Bonvallot (EHESP), George De Sousa (INRAE), Guillaume Karr (INERIS), Jean-Pierre Lepoittevin (Université de Strasbourg), Christophe Minier (Université Le Havre), Mélanie Nicolas (CSTB), Emmanuel Puskarczyk (CAP Nancy).
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Un score pour noter les produits ménagers en fonction de leur impact sur la santé et l’environnement – https://theconversation.com/un-score-pour-noter-les-produits-menagers-en-fonction-de-leur-impact-sur-la-sante-et-lenvironnement-271650