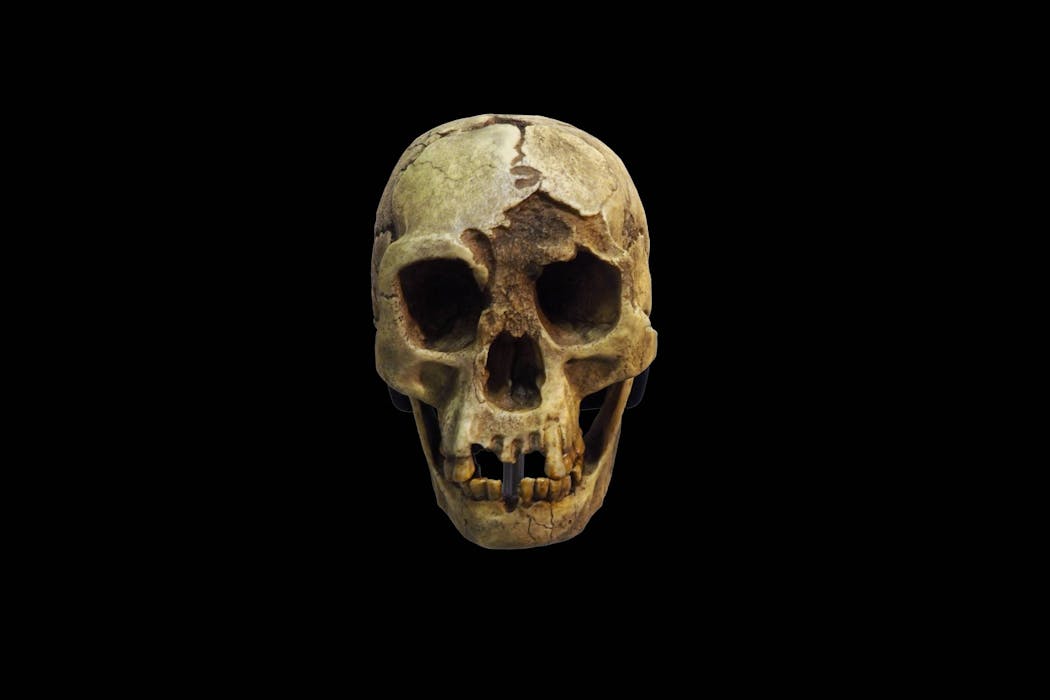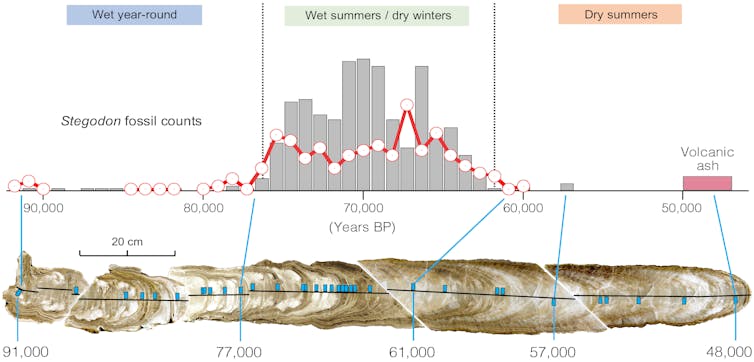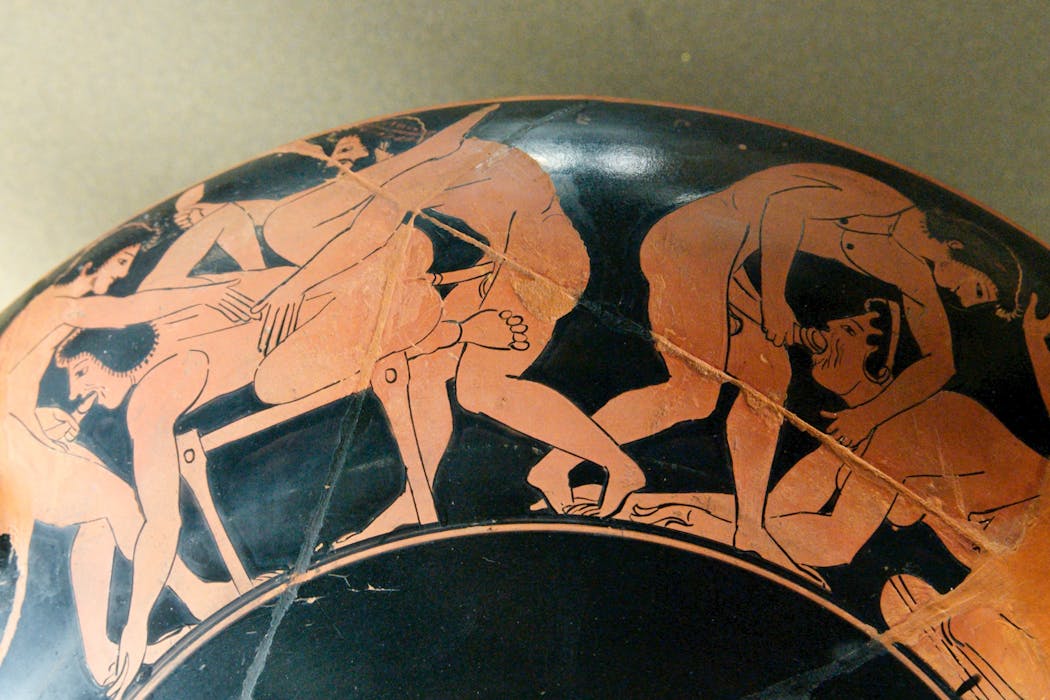Source: The Conversation – in French – By Jana Boeckx, Assistant Professor of Finance, IÉSEG School of Management

Une étude met en lumière le lien entre hausse du prix du carbone et suppressions d’emplois. Depuis 2017, une augmentation significative du prix des émissions est en cours, désormais 17 fois plus élevé en 2025 qu’en 2017. Si toutes les entreprises affichent leur mécontentement, elles n’adoptent pas les mêmes stratégies selon qu’elles sont cotées en bourse ou non. Avec pour principaux perdants, les cols bleus.
En 2017, le Conseil européen a introduit des réformes majeures dans le système européen d’échange de quotas d’émission, provoquant une forte hausse du prix du carbone. Le prix d’une tonne d’émissions équivalentes en CO2 a doublé, passant de 5,15 euros par tonne d’émissions le 1er janvier 2017 à 11,06 euros le 1er janvier 2018, puis à 22,23 euros le 1er janvier 2019.
L’objectif est clair : rendre la pollution plus coûteuse, afin d’inciter les entreprises à réduire leurs émissions. Mais cette hausse des coûts a eu un effet inattendu, certaines entreprises ont réagi en supprimant des emplois.
Dans notre étude, nous mettons en évidence un lien clair entre la hausse des prix du carbone et les suppressions d’emplois et les ventes d’actifs de production (machines, équipements) par les entreprises.
Alors, la transition climatique se fait-elle au prix de l’emploi ?
Voici quelques entreprises bien connues qui relèvent de ce système : Carrefour, Sanofi, TotalEnergies, Engie, etc.
Hausse du prix du carbone
L’un des outils politiques largement utilisés pour atteindre cet objectif est le système de plafonnement et d’échange, ou cap-and-trade system. L’exemple le plus marquant est le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE), souvent considéré comme une référence.
Malgré sa réputation mondiale, le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne a eu du mal pendant des années à fixer des prix significatifs pour le carbone. Au cours de sa phase initiale de 2005 à 2007, beaucoup de permis de pollution ont été distribués, ce qui a entraîné une faible demande et fait baisser les prix.
La période suivante de 2008 à 2012 a coïncidé avec la crise financière mondiale, qui a fortement réduit l’activité industrielle et, par conséquent, les besoins en quotas d’émission. Même si le plafond d’émissions a été réduit de 6,5 %, les prix sont restés obstinément bas. Pendant plus d’une décennie, le système n’a pas réussi à créer la pression financière nécessaire pour entraîner des réductions importantes des émissions.
En 2017, l’Union européenne a corrigé cette situation en réduisant l’offre de quotas (the cap) par 2,2 % annuelle. L’enjeu : doubler la canalisation des quotas vers une nouvelle réserve de stabilité du marché, ou Market Stability Reserve, jusqu’à 2023 et ajouter un mécanisme d’annulation pour supprimer définitivement les quotas inutilisés lors de la phase suivante. L’impact a été immédiat puisque le prix d’émission est passé d’un peu plus de 5 euros début 2017 à 11 euros un an plus tard, puis à environ 32 euros en 2020.
Les industriels du carburant vent debout
Cette intervention a suscité une opposition importante de la part des entreprises, des syndicats et des groupes d’intérêt industriels. Ils craignent que l’augmentation des coûts du carbone ne pousse la production et les emplois hors d’Europe. Par exemple FuelsEurope, qui représente l’industrie européenne des carburants, et les producteurs d’acier ont exprimé leurs préoccupations, avertissant que les coûts supplémentaires les rendraient moins compétitifs à l’échelle mondiale
Pourtant, il existe peu de preuves tangibles pour étayer ces affirmations. Les entreprises soumises au SEQE-UE sont 3,4 % plus susceptibles de réduire leurs effectifs que leurs homologues non soumises au SEQE-UE.
À lire aussi :
Histoire des crédits carbone : vie et mort d’une fausse bonne idée ?
Distinction entre entreprises cotées et non cotées
Cette tendance est loin d’être uniforme. Les entreprises cotées en bourse ne réduisent pas leurs effectifs, tandis que les entreprises non cotées les diminuent de manière plus marquée, avec des baisses pouvant atteindre 3,5 % dans les entreprises les plus polluantes. Les petites entreprises cotées (en dessous de la moyenne de l’échantillon en termes d’actifs totaux) qui disposent d’une marge de manœuvre financière limitée réduisent également leurs effectifs, mais dans une moindre mesure que leurs homologues non cotées.
Qu’ajustent ces entreprises en réponse à la hausse des coûts liés au carbone ? Cherchent-elles à maintenir leur production à un niveau stable, mais avec moins de travailleurs et d’actifs ? Ou bien produisent-elles moins globalement, et ont donc besoin de moins de ressources ?
Nos conclusions révèlent une distinction nette. Les entreprises privées ont tendance à réduire leurs activités, en supprimant à la fois des emplois et des actifs, ce qui suggère une réduction délibérée de leur champ d’action global. En revanche, les petites entreprises cotées en bourse, qui disposent de peu de liquidités, réduisent principalement leurs effectifs, sans diminuer leur base d’actifs.
En d’autres termes, les entreprises privées non cotées réduisent leurs effectifs en faisant moins, tandis que les entreprises cotées en bourse réduisent leurs effectifs en essayant de faire la même chose avec moins de personnel.
Les cols bleus sont les plus touchés
Afin de mieux cerner les employés les plus touchés par ces changements, nous avons également examiné les conséquences de la flambée des prix du carbone dans le cadre du SEQE-UE en Belgique.
À partir de données administratives détaillées, nous avons constaté que l’impact est loin d’être réparti de manière uniforme. Les cols bleus, les hommes ayant un faible niveau d’éducation (généralement avec diplôme secondaire ou sans) sont les plus touchés. L’effet est particulièrement prononcé chez les personnes sous contrat à temps partiel.
Ces résultats ont des implications importantes pour les décideurs politiques qui pilotent la transition écologique en Europe. Bon nombre des nouveaux emplois verts créés exigent des employés hautement qualifiés. Ce décalage pourrait créer des déséquilibres sur le marché du travail, soulignant le besoin urgent de programmes de formation et de reconversion.
![]()
Jana Boeckx ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. La hausse du prix du carbone conduit-elle à supprimer des emplois ? – https://theconversation.com/la-hausse-du-prix-du-carbone-conduit-elle-a-supprimer-des-emplois-268598