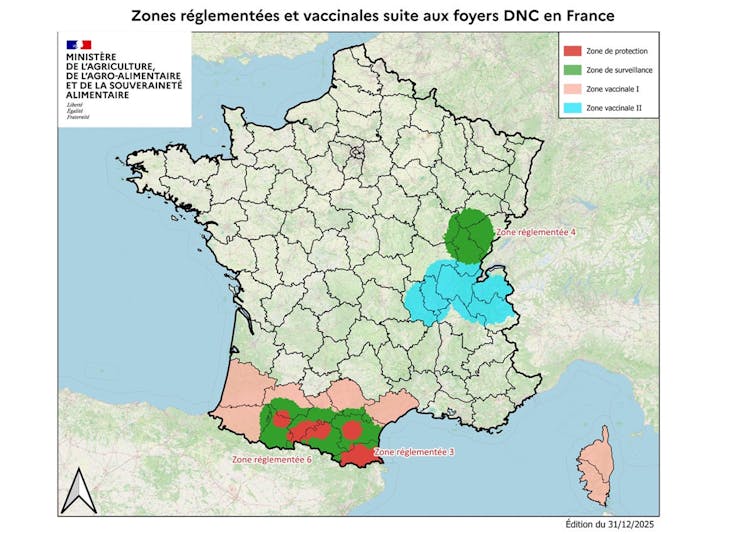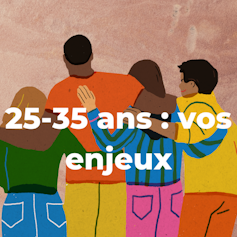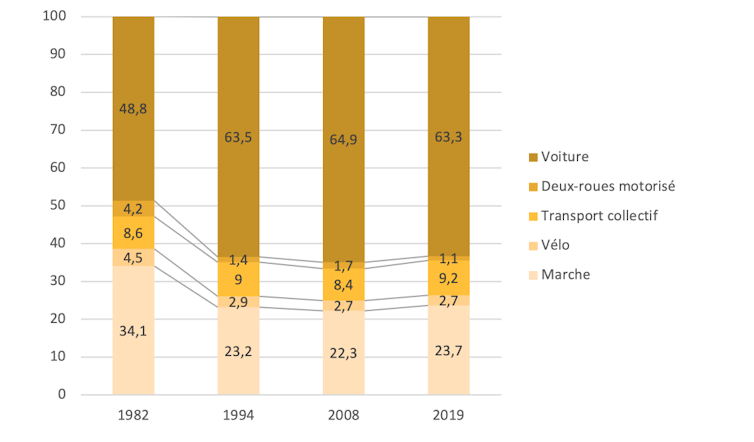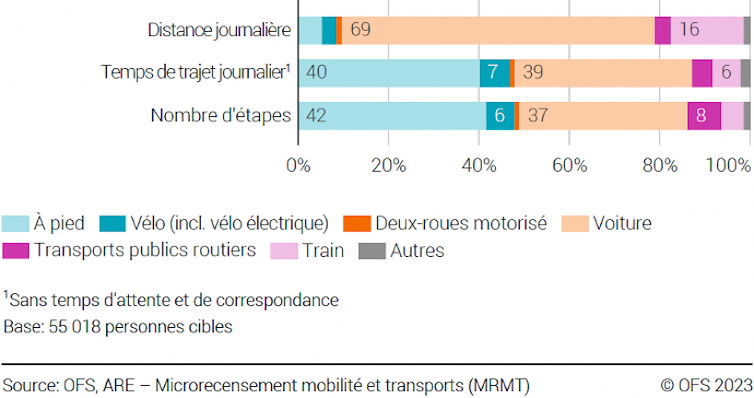Source: The Conversation – in French – By Abdelwahab Biad, Enseignant chercheur en droit international, Université de Rouen Normandie
Bombarder un pays étranger sans mandat de l’ONU, capturer son dirigeant, quand bien même sa légitimité est douteuse, et proclamer qu’on va dorénavant diriger le pays en question : tout cela contrevient à de nombreuses normes du droit international détaillées dans la Charte de l’ONU et dans les Conventions de Genève.
L’Opération « Absolute Résolve » qui a impliqué le déploiement d’une force aéronavale sans précédent dans les Caraïbes depuis la crise des missiles de Cuba en 1962 illustre la détermination du président Trump à capturer le président Nicolas Maduro et son épouse, en exécution d’un mandat d’arrêt de la justice américaine pour « narco-terrorisme ». Au-delà de la méthode et des raisons invoquées pour la justifier, il s’agit d’une intervention armée sur le territoire d’un État étranger sans fondement juridique. C’est une nouvelle manifestation d’un interventionnisme décomplexé depuis l’adoption de la Doctrine Monroe il y a deux siècles.
Celle-ci, énoncée par le président James Monroe en 1823, visait à dissuader les puissances européennes d’intervenir dans l’hémisphère occidental, considéré comme chasse gardée des États-Unis. Elle s’est traduite notamment par le soutien aux républicains mexicains pour mettre fin à l’éphémère royaume de Maximilien voulu par Napoléon III (1861-1867), ainsi que l’appui aux indépendantistes cubains au prix d’une guerre hispano-américaine (1898) à l’issue de laquelle l’île de Porto Rico a été annexée par les États-Unis et Cuba est devenue formellement indépendante.
La Doctrine Monroe version Trump (« Trump Corollary » dans la Stratégie de sécurité nationale 2025) est désormais définie comme visant à restaurer la prééminence de Washington dans son arrière-cour en s’assurant qu’aucun rival extérieur ne soit en mesure d’y déployer des forces ou de contrôler des ressources vitales dans la région. Une allusion à peine voilée à la Chine dont l’activisme économique dans la région et singulièrement au Venezuela (qui intéresse avant tout Pékin pour son pétrole) est perçu comme une menace pour cette prééminence.
Un précédent : Panama, 1989
« Absolute Resolve » ressemble par son modus operandi à l’opération « Just Cause » décidée par le président George W. Bush en 1989 pour capturer et traduire devant un tribunal américain le dirigeant du Panama, Manuel Noriega, sous la même inculpation de trafic de drogue.
L’Assemblée générale des Nations unies avait qualifié cette intervention à Panama de « violation flagrante du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de Panama » (Résolution 44/240 du 29 décembre 1989).
Une différence réside dans le fait que le général Manuel Noriega – un dictateur responsable d’exécutions extrajudiciaires et de tortures – fut un allié de Washington, mais qui avait fini par s’avérer encombrant. A contrario, Nicolas Maduro – qui est également considéré par de nombreux États, ONG et observateurs comme un dictateur ayant mis en place une large répression et s’étant fait réélire en 2024 de façon totalement frauduleuse – incarne une gauche révolutionnaire que Washington n’a cessé de combattre depuis la guerre froide.
Une violation manifeste de la Charte des Nations unies
L’intervention armée sur le territoire vénézuélien constitue sans discussion une violation de la Charte des Nations unies. Celle-ci dispose que « les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toutes autres manières incompatibles avec les buts des Nations unies » (article 2, § 4).
Les exceptions compatibles avec un recours à la force se limitent à la légitime défense ou à une action conforme à une décision du Conseil de sécurité. Dans cette circonstance, les États-Unis ne peuvent se prévaloir ni d’une action en légitime défense ni d’un mandat du Conseil de sécurité.
La Cour internationale de Justice avait relevé que le non-recours à la force relevait d’un principe essentiel et fondamental du droit international (arrêt du 27 juin 1986, qui concernait déjà une confrontation entre les États-Unis et un pays des Amériques, en l’occurrence le Nicaragua).
L’interdiction de l’emploi de la force peut être déduite d’une autre disposition de la Charte (Article 2, § 7) invitant les États à recourir au règlement pacifique des différends (chapitre 6), ce qui manifestement n’a pas été mis en œuvre ici.
Ces principes ont pour finalité de préserver la stabilité de l’ordre international et de prévenir le règne de la loi de la jungle dans les relations internationales. Or, faut-il le rappeler, dans la mesure où ils ont adhéré à la Charte des Nations unies, dont ils furent les rédacteurs en 1945, les États-Unis sont tenus d’en respecter et appliquer les dispositions.
Le « régime change » n’a pas de fondement en droit international
Le président Trump a justifié son intervention armée contre un président qu’il considère comme « illégitime » par l’accusation selon lequel Nicolas Maduro se serait livré, des années durant, au « narco-terrorisme ». La méthode utilisée, l’enlèvement d’un chef d’État en exercice, est doublement contraire au droit international : d’une part, en raison de l’immunité attachée à la fonction présidentielle (ce que semble ignorer l’application extra-territoriale de la justice américaine) ; d’autre part parce que la Charte, dans son art. 2, § 7, stipule clairement la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.
Le principe de souveraineté n’autorise pas un État à intervenir militairement sur le territoire d’un autre État en vue d’en changer le système politique, quand bien même le régime de Nicolas Maduro s’est rendu coupable de fraude électorale et de graves violations des droits humains à l’égard de l’opposition, qui font l’objet d’une enquête conduite par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.
Il reste que l’emploi de la force armée n’est pas la méthode la plus appropriée pour promouvoir les droits de l’homme dans un autre pays. Il existe des mécanismes internationaux compétents dans ce domaine (ONU, CPI) qui devraient pouvoir poursuivre leurs missions d’enquête sur les crimes commis par le régime de Maduro.
Les Conventions de Genève régissant le droit des conflits armés
Le droit applicable à l’intervention armée à Caracas est le droit des conflits armés encadrant la conduite des opérations militaires et la protection des biens et des personnes, même si les États-Unis nient être en guerre contre le Venezuela.
Les Conventions de Genève et le Protocole 1 s’appliquent s’agissant d’un conflit armé international même si l’une des parties ne reconnaît pas l’état de guerre (art. 2 commun des Conventions), comme l’attestent les déclarations de Washington.
Dès son arrestation, Nicolas Maduro peut se prévaloir de la protection de la 3ᵉ Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. En outre, la brièveté de l’opération militaire américaine n’exclut pas l’application de la 4ᵉ Convention de Genève si des victimes civiles sont à déplorer ou des biens civils ciblés.
D’autre part, Donald Trump a déclaré vouloir « diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse ». Cela peut être un motif d’inquiétude si un projet d’occupation est envisagé (la Charte des Nations unies le proscrit si l’occupation découle d’un recours à la force illicite). Cela dit, un tel scénario semble improbable compte tenu de l’expérience des fiascos en Afghanistan et en Irak, des réactions internationales majoritairement hostiles à l’intervention militaire, ainsi que de la montée des critiques au sein même de sa base MAGA, à qui Trump avait promis avant son élection de mettre fin aux guerres extérieures.
L’intervention armée et l’arrestation d’un chef d’État étranger en vue de le juger par un tribunal états-unien sont un message sans ambiguïté adressé par le président Trump à la communauté internationale : son pays n’hésitera pas à faire prévaloir le droit de la force sur la force du droit. Le droit international doit impérativement prévaloir comme contrat social liant les nations pour prévenir le chaos ou « l’homme est un loup pour l’homme » pour reprendre la formule de Thomas Hobbes. s’est déclaré à Fuerte Tiuna, le plus grand complexe militaire du Venezuela, après les frappes de l’armée des États-Unis à Caracas le 3 janvier 2026.
![]()
Abdelwahab Biad ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. L’intervention des États-Unis au Venezuela au prisme du droit international – https://theconversation.com/lintervention-des-etats-unis-au-venezuela-au-prisme-du-droit-international-272929