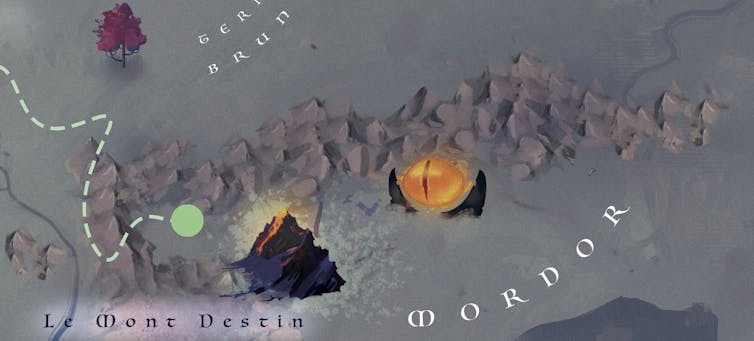Source: The Conversation – in French – By Firouzeh Nahavandi, Professeure émérite, Université Libre de Bruxelles (ULB)
En Iran, les manifestants, et spécialement les manifestantes, font l’objet d’une répression extrêmement violente, avec cette spécificité que les tirs prennent souvent pour cible leurs yeux. En aveuglant l’« ennemi » qui ose les contester, les autorités inscrivent leur action dans la longue histoire du pays.
Au cours des mobilisations iraniennes de ces dernières années, et plus encore depuis celles du mouvement Femme, Vie, Liberté déclenché en 2022, la fréquence élevée de blessures oculaires infligées aux manifestants interpelle les observateurs. Femmes, jeunes, étudiants, parfois simples passants, perdent un œil – voire la vue – à la suite de tirs de chevrotine ou de projectiles à courte distance. Une pratique des forces de sécurité que l’on observe de nouveau actuellement : l’avocate Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix en 2003, a ainsi estimé ce 9 janvier que depuis le début des protestations en ce début d’année, « au moins 400 personnes auraient été hospitalisées à Téhéran pour des blessures aux yeux causées par des tirs ».
Ces violences ne relèvent pas de simples bavures. Elles s’inscrivent dans une logique politique qui trouve un écho dans l’histoire longue du pouvoir en Iran, où viser les yeux signifie symboliquement retirer à la victime toute capacité d’existence politique.
Le regard comme attribut du pouvoir
Dans la culture politique iranienne prémoderne, le regard est indissociable de l’autorité. Voir, c’est savoir ; voir, c’est juger ; voir, c’est gouverner. Cette conception traverse la littérature et l’imaginaire politiques iraniens. À titre d’exemple, dans le Shahnameh (Livre des rois), de Ferdowsi (Xe siècle), la cécité constitue un marqueur narratif de déchéance politique et cosmique : elle signale la perte du farr (gloire divine), principe de légitimation du pouvoir, et opère comme une disqualification symbolique durable de l’exercice de la souveraineté. Être aveuglé, c’est être déchu.
Dans le Shahnameh, l’aveuglement d’Esfandiyar par Rostam constitue une scène fondatrice de l’imaginaire politique iranien : en visant les yeux, le récit associe explicitement la perte de la vue à la disqualification du pouvoir et à la fin de toute prétention souveraine.

San Diego Museum of Art/Bridgeman Images
Historiquement, l’aveuglement a été utilisé comme instrument de neutralisation politique. Il a permis d’écarter un rival – prince ou dignitaire – sans verser le sang, acte considéré comme sacrilège lorsqu’il touchait les élites. Un aveugle n’était pas exécuté : il était rayé de l’ordre politique.
Le chah Abbas Iᵉʳ (au pouvoir de 1587 à sa mort en 1629) fait aveugler plusieurs de ses fils et petits-fils soupçonnés de complot ou susceptibles de contester la succession.
En 1742, Nader Shah ordonne l’aveuglement de son fils et héritier Reza Qoli Mirza, acte emblématique des pratiques de neutralisation politique dans l’Iran prémoderne.
De l’aveuglement rituel à l’aveuglement sécuritaire : pourquoi les forces de sécurité iraniennes visent-elles si souvent les yeux des manifestants ?
La République islamique ne revendique pas l’aveuglement comme châtiment. Mais la répétition massive de blessures oculaires lors des répressions contemporaines révèle une continuité symbolique.
Autrefois rare, ciblé et assumé, l’aveuglement est aujourd’hui diffus, nié par les autorités, produit par des armes dites « non létales » et rarement sanctionné.
La fonction politique demeure pourtant comparable : neutraliser sans tuer, marquer les corps pour dissuader, empêcher toute réémergence de la contestation.
Dans l’Iran contemporain, le regard est devenu une arme politique. Les manifestants filment, documentent, diffusent. Les images circulent, franchissent les frontières et fragilisent le récit officiel. Toucher les yeux, c’est donc empêcher de voir et de faire voir : empêcher de filmer, d’identifier, de témoigner.
La cible n’est pas seulement l’individu, mais la chaîne du regard reliant la rue iranienne à l’opinion publique internationale.
Contrairement à l’aveuglement ancien, réservé aux élites masculines, la violence oculaire actuelle frappe majoritairement des femmes et des jeunes. Le regard féminin, visible, autonome, affranchi du contrôle idéologique, devient politiquement insupportable pour un régime fondé sur la maîtrise du corps et du visible.
Un continuum de violences visibles
La répression actuelle, qui fait suite aux protestations massives déclenchées fin décembre 2025, s’est intensifiée avec une coupure d’Internet à l’échelle nationale, une tentative manifeste d’entraver la visibilité des violences infligées aux manifestants.
Des témoignages médicaux et des reportages indépendants décrivent des hôpitaux débordés par des cas de traumatismes graves – notamment aux yeux – alors que l’usage croissant d’armes à balles réelles contre la foule est documenté dans plusieurs provinces. Ces blessures confirment que le corps, et particulièrement la capacité de voir et de documenter, reste une cible centrale du pouvoir répressif.
Au-delà des chiffres, les récits des victimes féminines racontent une autre dimension de ces pratiques contemporaines. Alors que la société iranienne a vu des femmes à la pointe des mobilisations depuis la mort de Mahsa Jina Amini en 2022 – dont certaines ont été aveuglées intentionnellement lors des manifestations –, ces blessures symbolisent à la fois l’effort du pouvoir pour effacer le regard féminin autonome, source de menace politique, et la résistance incarnée par des femmes blessées mais persistantes, dont les visages mutilés circulent comme des preuves vivantes de répression.
L’histoire ne se limite donc pas à un passé lointain de neutralisation politique : elle imprègne l’expérience corporelle des femmes aujourd’hui, où l’atteinte à l’œil se lit à la fois comme une violence instrumentale et un signe que la lutte politique se joue aussi sur le champ visuel.
Le corps comme dernier champ de souveraineté
La République islamique a rompu avec le sacré monarchique, mais elle a conservé un principe ancien : le corps comme lieu d’inscription du pouvoir. Là où le souverain aveuglait pour protéger une dynastie, l’État sécuritaire mutile pour préserver sa survie.
Cette stratégie produit toutefois un effet paradoxal. Dans l’Iran ancien, l’aveuglement faisait disparaître politiquement. Aujourd’hui, il rend visible la violence du régime. Les visages mutilés circulent, les victimes deviennent des symboles et les yeux perdus témoignent d’une crise profonde de légitimité.
L’histoire ne se répète pas, mais elle survit dans les gestes. En visant les yeux, le pouvoir iranien réactive une grammaire ancienne de domination : empêcher de voir pour empêcher d’exister politiquement.
![]()
Firouzeh Nahavandi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Répression en Iran : pourquoi les forces de sécurité visent les yeux des manifestants – https://theconversation.com/repression-en-iran-pourquoi-les-forces-de-securite-visent-les-yeux-des-manifestants-273244