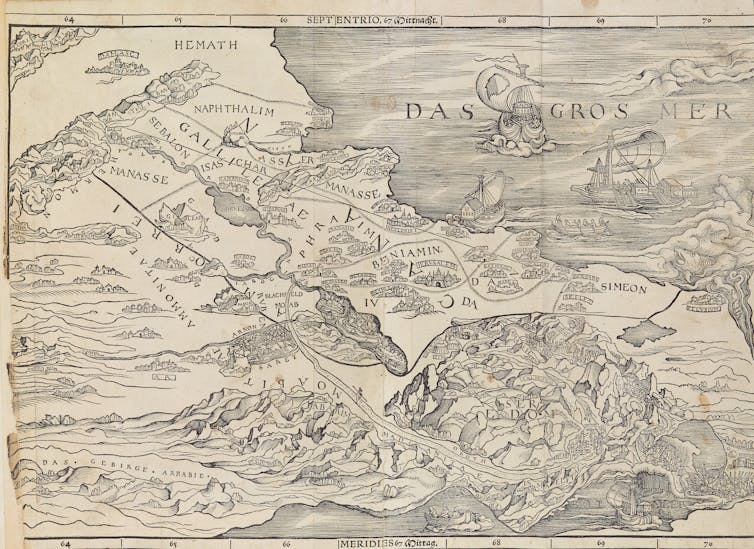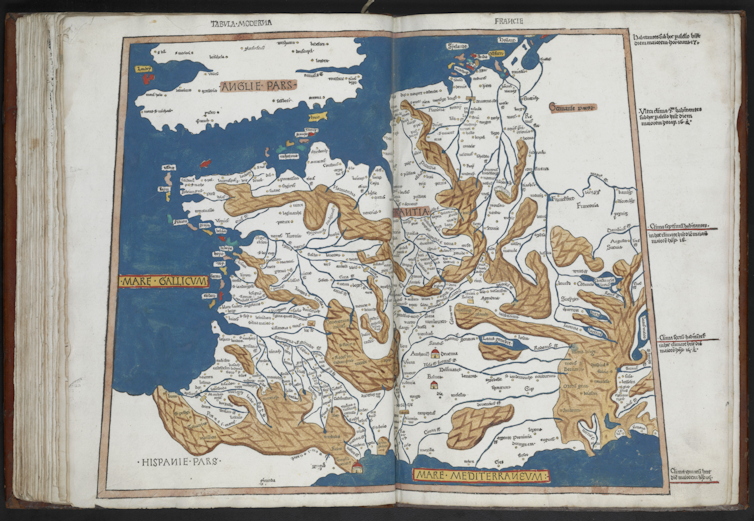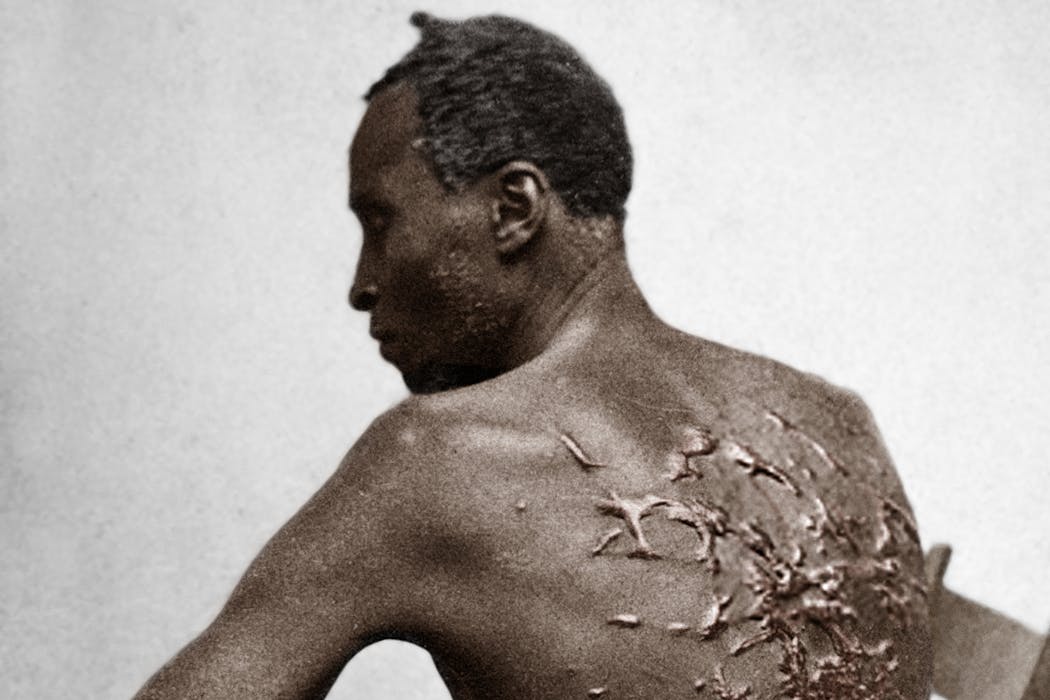Source: The Conversation – in French – By Thomas Stocker, Emeritus Professor of Climate and Environmental Physics, University of Bern
Le mercredi 14 janvier 2026, la première bibliothèque de carottes de glace au monde a été inaugurée à Concordia, en Antarctique. Des échantillons provenant de glaciers du monde entier commencent à y être stockés. Ils permettront notamment aux générations futures de continuer à étudier les traces des climats passés piégés dans la glace, alors que les glaciers de tous les continents fondent à un rythme effréné.
Grâce à sa température moyenne de -50 °C, cette carothèque souterraine pourra préserver du réchauffement climatique des carottes de glace déjà prélevées dans les Andes, au Svalbard (archipel norvégien en mer du Groenland), dans les Alpes, dans le Caucase ou dans les montagnes du Pamir au Tadjikistan, et ce, sans assistance technique ni réfrigération.
Ancien coprésident du groupe de travail Science du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), le climatologue et physicien suisse Thomas Stocker est aujourd’hui président de la Fondation Ice Memory, à l’initiative de ce projet en collaboration avec l’Université Grenoble Alpes et l’Université Ca’ Foscari de Venise. Il explique l’urgence de cette initiative qui se projette sur le temps long.
The Conversation : Pouvez-vous nous donner un exemple concret de la façon dont ces carottes de glace stockées en Antarctique pourraient être utilisées par les scientifiques du futur ?
Thomas Stocker : Prenons l’exemple d’un nouveau composé chimique présent dans l’atmosphère, comme un pesticide. Si, dans cinquante ans, un ou une scientifique souhaite connaître la concentration de ce composé en 2026, par exemple dans les Alpes européennes ou en Asie, il se tournera vers une carotte de glace.
Mais si la carotte de glace n’a pas été prélevée et stockée en Antarctique, ce ou cette scientifique sera incapable de répondre à cette question. Grâce aux carottes de glace stockées à Concordia, cependant, il ou elle pourra prélever un échantillon, mesurer la concentration de ce composé dans la glace prélevée il y a cinquante ou cent ans, reconstituer les données et répondre à cette question.
Mais pour permettre aux futurs scientifiques de répondre à toutes les questions qu’ils se poseront, nous devons agir rapidement. Un article scientifique très récent, publié dans Nature, s’est penché sur l’évolution globale de la fonte des glaces et prévoit que le nombre de glaciers qui disparaissent augmentera jusqu’en 2040 environ, ce qui représenterait le pic annuel de la fonte des glaciers dans le monde.
À partir de là, la fonte des glaciers se réduira. Les chiffres vont baisser, non pas parce qu’on aura arrêté le réchauffement climatique, mais parce que, un par un, ces glaciers auront disparu, et il restera de moins en moins de glaciers qui fondent. Donc, vers 2040, on va atteindre un pic de fonte des glaciers, ce qui détruira au passage les archives environnementales prestigieuses et précieuses qu’ils représentent.
Dans les Alpes, nous avons connu un réchauffement environ deux fois plus rapide que le réchauffement moyen mondial, et nous sommes donc entrés dans une véritable course contre la montre. Nous devons prélever ces carottes de glace avant que l’eau provenant de la fonte estivale pénètre dans la glace.
Depuis vos premiers travaux, vous avez pu bénéficier de nombreuses avancées méthodologiques et technologiques qui nous permettent de « faire parler » la glace. Quels sont vos espoirs en la matière ? Quels facteurs pourraient contribuer à exploiter encore davantage les échantillons de glaciers qui seront conservés à Concordia ?
T. S. : Je ne peux qu’extrapoler à partir de ce que nous avons appris et expérimenté en science au cours des cinquante dernières années. Nous avons effectivement assisté à l’arrivée de nouvelles technologies qui permettent d’analyser les paramètres de la composition élémentaire, la concentration des gaz stockés dans la glace et qui, comme des clés, vous ouvrent soudainement la porte à toute une série d’informations inédites sur notre système environnemental.
Ce que je peux donc imaginer à partir de là, ce sont de nouvelles méthodes optiques permettant de déterminer la composition isotopique de différents éléments dans diverses substances chimiques, des outils d’analyse de haute précision qui pourraient être inventés dans les prochaines décennies et qui permettraient d’atteindre le niveau du picogramme, du picomole ou du femtomole, afin de nous renseigner sur la composition de l’atmosphère, sur ses composants, tels que la poussière, les minéraux provenant de diverses régions qui se sont déposés dans ces carottes de glace, afin de nous informer sur la situation, l’état de l’atmosphère dans le passé.
Vous êtes professeur émérite de physique climatique et environnementale. Pour quelles autres disciplines le projet Ice Memory est-il utile ?
T. S. : On peut penser à la biologie. Si vous trouvez des restes organiques ou de l’ADN dans ces carottes de glace, c’est de la biologie. On peut aussi étudier la composition chimique de l’atmosphère. C’est alors de la chimie. On peut même se demander quelle est la composition minérale des petites particules de poussière qui se déposent dans ces carottes de glace. C’est un travail de géologue. Vous disposez donc de toute une gamme de domaines scientifiques différents qui peuvent tirer de nouvelles informations à partir de ces carottes de glace.
Le projet Ice Memory ne fait pas que rassembler différentes disciplines scientifiques, il aspire aussi à fédérer des scientifiques du monde entier. Quel défi cela représente-t-il à une époque où les tensions géopolitiques ne cessent de croître ?
T. S. : Ice Memory est l’un de ces exemples où le multilatéralisme est activement mis en pratique par la communauté scientifique. Il s’agit d’une offre faite aux scientifiques du monde entier, dans tous les pays, afin qu’ils puissent utiliser ce sanctuaire unique situé à Concordia. Pour nous, il s’agit vraiment d’une activité emblématique qui dépasse les frontières et les divisions politiques afin de préserver les informations provenant de la planète Terre, non seulement pour la prochaine génération de scientifiques, mais aussi pour l’humanité en général.
Nous invitons également tous les pays qui possèdent des glaciers sur leur territoire à participer et à soutenir leur communauté scientifique afin de forer des carottes de glace dans ces régions et de suivre l’exemple du Tadjikistan. ce dernier est le premier pays à avoir fait don d’une carotte de glace, 105 mètres de glace précieuse provenant d’un site unique, le glacier Chukurbashi, à la fondation Ice Memory afin qu’elle soit stockée en Antarctique.
Pendant la guerre froide, l’Antarctique était l’un des rares endroits sur Terre où Russes et Américains pouvaient échanger leurs idées et mener ensemble des recherches scientifiques. L’Antarctique peut-elle encore être un lieu où le dialogue remplace la rivalité ?
T. S. : Je suis absolument convaincu que l’environnement unique de l’Antarctique, si riche en nature et en vie, et si particulier sur notre planète, fait que les considérations relatives à la position et aux valeurs de chaque pays sont secondaires. La priorité absolue, comme nous l’avons pratiquée au cours des cinquante dernières années d’activité scientifique sur le terrain, est vraiment de comprendre notre système climatique, d’observer la nature du point de vue de l’Antarctique et de la protéger.
Cela nous donne l’occasion de nous immerger véritablement, de collaborer et d’échanger des idées sur des questions scientifiques spécifiques qui nous concernent tous, car elles concernent l’avenir de cette planète que nous partageons.
Propos recueillis par Gabrielle Maréchaux.
![]()
Thomas Stocker est président de la Fondation Ice Memory.
– ref. La première bibliothèque de carottes glaciaires en Antarctique pour protéger la mémoire climatique de l’humanité – https://theconversation.com/la-premiere-bibliotheque-de-carottes-glaciaires-en-antarctique-pour-proteger-la-memoire-climatique-de-lhumanite-273377