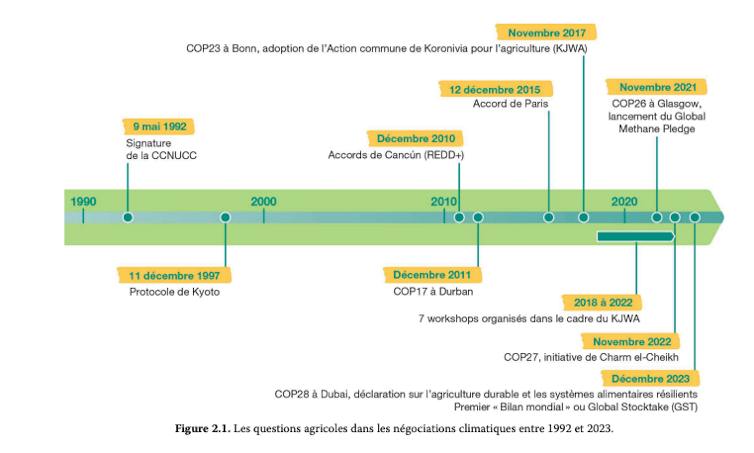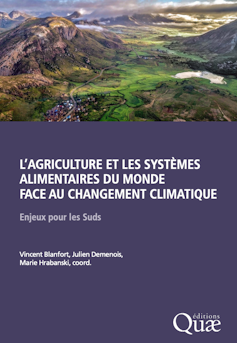Source: The Conversation – in French – By Camille Bouzereau, Chercheuse postdoctorale en linguistique, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Dans les romans policiers en français des années 1950-1970, écrits presqu’exclusivement par des hommes, les mots « gifle » et « gifler » ont souvent pour victimes des femmes qu’il s’agit de faire taire pour asseoir la domination masculine, comme le montre une étude linguistique.
Notre étude sur la gifle dans le polar s’inscrit au sein du projet POLARisation (2023-2026). Il regroupe des chercheuses et chercheurs en littératures, cultures populaires et médiatiques autour des récits criminels du XXe siècle et d’un grand corpus de fictions constitué avec Valentin Chabaux, ingénieur de Nanterre. Ce corpus numérique comprend 3015 romans écrits ou traduits en français, publiés entre 1945 et 1989 en France, chez plusieurs éditeurs et dans 8 collections de romans policiers.
L’intégralité des huit collections a été traitée de manière informatique (traitement automatique des langues ; linguistique de corpus) et nous avons d’abord cherché à extraire des patterns syntaxiques récurrents statistiquement, indiquant la spécificité du polar.
Des « patterns » autour de la gifle
Après avoir observé le vocabulaire récurrent qui entoure les termes de « bagarre », « coup de poing », « baffe », « gifle », nous avons constaté que les coups ont un genre : par exemple, la « baffe » (plus familier) est utilisée pour les conflits masculins et la « gifle » implique au moins un personnage féminin, alors qu’il s’agit de synonymes. Grâce à Adam Faci, postdoctorant en informatique, nous avons identifié un pattern qui a retenu notre attention. Il repose sur l’association récurrente d’un échange verbal et d’une gifle :
VERBE DE PAROLE + GIFLE + POUR + PRONOM + FAIRE TAIRE
Voici un extrait prototypique qui comprend cette séquence (nous développons ensuite) :
« C’était une scène terrible, où Mirabelle déversait un flot de grossièretés au point que Wessler, indigné, devait la gifler pour la faire taire. »
(Patrick Quentin, Puzzle pour acteurs, Presses de la Cité, « Mystère », 1971.)
L’analyse du texte confirme que dans ces occurrences les prises de parole féminines sont souvent suivies de gifles et que l’expression du but introduit par « pour » permet d’expliciter la finalité de la gifle : il s’agit presque toujours de « faire taire » le féminin. Plusieurs scénarios de la gifle sexiste sont repris en ce sens dans nos polars.
Parler au féminin dans les romans policiers
La gifle vient interrompre le discours féminin parce qu’il ne correspondrait pas au souci d’efficacité et d’action imposé par l’intrigue : elle doit mettre fin à l’inanité du personnage féminin (minoré, infantilisé, animalisé, jugé en crise) en même temps qu’elle signifie la domination et le sang-froid du détective ou de l’espion.
Avant la gifle, le discours féminin peut aussi se miner lui-même – stratégie de légitimation de la gifle masculine qui ne ferait que rendre service à un féminin arrivant au point de rupture :
« – Non, ça n’ira pas bien ! (Elle sanglotait dans son fauteuil, incapable de se retenir.) T… tu ne peux pas comprendre. T… tu ne sais pas comment ça se passe, ici. Elle va me mettre à la porte, et j… je ne peux vraiment pas… il faut que j… je…
Je la giflai, sèchement, deux gifles rapides en succession, de la paume et du dos de la main. »
(Jim Thompson, Nuit de fureur, Fleuve Noir, « Engrenage », 1983.)
Les points de suspension obligent à la répétition et, associés aux formes négatives, closent avant la fin de la phrase le discours d’un personnage ânonnant. La parenthèse renforce cet effet avec la négation « incapable de se retenir » : la narration vient interrompre elle-même le discours, pour commenter l’échec féminin à faire avancer l’intrigue. Dans un récit qui valorise la maîtrise de soi, cette incapacité est violemment sanctionnée – notons que l’homme qui gifle ici est maître de lui, et que la gifle semble un choix pragmatique, et non une réponse émotionnelle. La gifle devient même parfois un remède :
« – Non, il est mort, dit-elle, c’est le seul homme que j’ai aimé, le seul homme avec qui j’ai couché, nous étions amants, écoutez, nous étions amants et je ne le regrette pas parce que nous nous aimions, nous nous aimions, et à chaque fois c’était plus beau, oh mon Dieu, je voudrais être morte aussi…
Ses yeux étaient fixes, hagards ; des bulles de salive éclataient aux coins de sa bouche. Je la giflai, sans ménagement, assez fort pour lui retourner la tête et faire rougir sa joue. »
(Bill Pronzini, Où es-tu, militaire ?, Gallimard, « Série Noire », 1974.)
Le discours tenu par le personnage féminin est plein de répétitions signalant son incohérence, et il est marqué par une affectivité proche de l’hystérie, telle que définie par une médecine sexiste – l’interjection « Oh mon Dieu » suivie du vœu de mort. Les points de suspension révèlent aussi qu’il s’est définitivement enrayé. Les « bulles de salive », les yeux « hagards », peignent à grands traits un tableau clinique auquel la gifle vient remédier.
Le personnage féminin est ainsi minimisé, tant dans son discours que dans sa capacité à interagir à égalité avec le personnage masculin, et dans son érotisation : la femme fatale élégante et mystérieuse se transforme en hystérique dépenaillée (sans cesser parfois d’être sexualisée). La critique de cinéma et réalisatrice Laura Mulvey a d’ailleurs théorisé le « male gaze », ce « regard masculin » qui place le désir de domination de l’homme au centre du récit, à partir d’œuvres cinématographiques contemporaines de ces récits.
À lire aussi :
La littérature populaire, aux origines de la pop culture
Discours narrativisés, discours niés
Pour faire taire le personnage féminin, une autre possibilité est de réduire au maximum les propos rapportés en utilisant ce qu’on appelle en linguistique le discours narrativisé (DN), un discours qui laisse le lecteur imaginer ce que le personnage a dit à son destinataire.
Avec le DN, il est fait mention d’un discours qui a eu lieu, mais son contenu n’est pas précisé. Dans ce cadre, peu importe la teneur du propos rapporté. Soit le contenu du discours n’est qu’allusif (par exemple, ci-dessous, le terme « regrettables » rapportant le point de vue du narrateur et non celui du personnage féminin) :
« Par stupide gloriole, il lui avait raconté le déjeuner avec le diplomate. Elle avait très mal pris la chose et prononcé des mots regrettables. Il avait dû la gifler, encore une fois, pour la faire taire. »
(Jean Bruce, Noël pour un espion, Presses de la Cité, « Un mystère », 1956.)
Ou bien le contenu est porté par un cliché (ici, « glapir des injures ») :
« – Parce qu’elles m’emmerdent ! Aussitôt, les deux demoiselles se mirent à glapir des injures et Hernandez en gifla une pour lui imposer silence. »
(Charles Exbrayat, La haine est ma compagne, Librairie des Champs-Élysées, « Le Masque », 1981.)
Ce qui importe, c’est de dérouler le script de la gifle après la crise de nerfs. Dans ces contextes, la gifle est bien présentée comme un moyen de soumettre les personnages féminins – en état de sidération ou écrasés au sol :
« Ce spectacle redoubla l’hilarité d’Odile. Son rire devint un véritable hennissement. C’était la crise de nerf imminente. Mendoza le comprit et lui donna deux gifles droite, gauche, qui la firent vaciller. Soudain dégrisée, elle se mit à sangloter. »
(Jean-Pierre Conty, La Longue Nuit de Mr Suzuki, Fleuve Noir, « Espionnage », 1968.)
Des performativités brisées
Pour conclure, prenons un dernier exemple :
« – Vous n’avez pas le droit ! Margaret Boolitt, en larmes, retournant vers son mari, reçut, de la part de ce dernier, une autre gifle qui fit autant de bruit que la première. »
(Charles Exbrayat, Imogène et la veuve blanche, Librairie des Champs-Élysées, « Le Masque », 1975.)
Ici, Margaret Boolitt a la parole et s’exclame « Vous n’avez pas le droit ! ». Dans notre corpus, cet énoncé fréquent dans les défenses féminines échoue pragmatiquement : c’est une formule figée qui traduit l’impuissance féminine, un réflexe discursif consistant à vouloir s’abriter derrière une norme sociale, mais dans un contexte où cette norme est systématiquement violée.
Selon la philosophe Judith Butler reprenant John Langshaw Austin, la parole est performative (c’est-à-dire qu’elle a un impact sur le réel) quand elle est prononcée dans un cadre institutionnel légitime, par un locuteur habilité, et dont on reconnaît l’autorité. Or, dans les extraits étudiés, et bien souvent dans ces récits écrits par des hommes et pour les hommes, la performativité est brisée.
La parole féminine échoue précisément parce qu’elle ne remplit pas ces conditions de performativité. Comme le montre ce script de la gifle, la figure féminine dans le polar des années 1950-1970 est souvent dominée, contrôlée, et exclue des circuits de légitimation.
Cette représentation des femmes, giflées pour être réduites au silence, dans
des productions culturelles largement diffusées, est évidemment alimentée par les inégalités effectives entre les hommes et les femmes dans la société de cette époque, et a contribué en retour à alimenter le même imaginaire.
![]()
Camille Bouzereau a reçu des financements de l’ANR POLARisation & de l’Université Paris Nanterre.
Gonon Laetitia a reçu des financements de l’ANR pour le projet POLARisation auquel elle contribue.
– ref. Dans les polars des années 1950, des gifles pour réduire les personnages féminins au silence – https://theconversation.com/dans-les-polars-des-annees-1950-des-gifles-pour-reduire-les-personnages-feminins-au-silence-265088