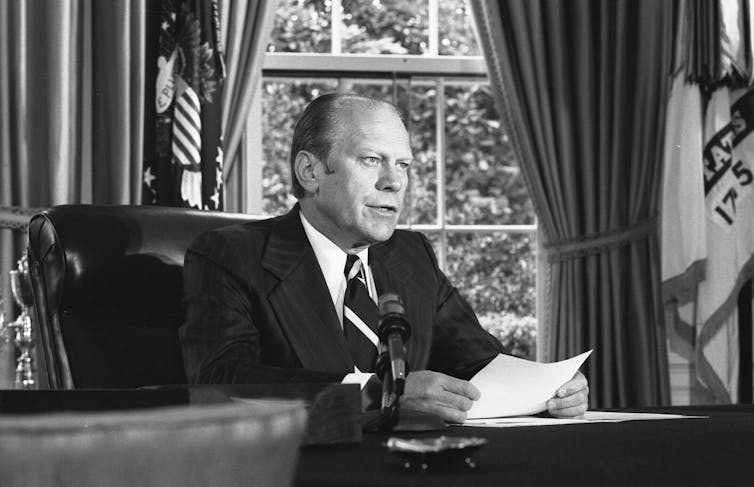Source: The Conversation – in French – By Marie Asma Ben-Othmen, Enseignante-chercheuse en Economie de l’environnement & Agroéconomie, Responsable du Master of Science Urban Agriculture & Green Cities, UniLaSalle
Le « bio » : une étiquette clairement identifiable et souvent rassurante. Pourtant, les réalités derrière ce label mondial divergent. Alors que les normes en Europe sont plutôt strictes, elles sont bien plus souples en Amérique du Nord. Dans les pays émergents, ce sont les contrôles qui sont inégaux. Autant d’éléments à même d’affecter la confiance accordée au bio par les consommateurs. Comment s’y retrouver ? L’idéal serait d’harmoniser les règles d’un pays à l’autre. Petit tour d’horizon.
Le « bio » est un label mondial qui peut s’appliquer à des produits venus d’Europe, de Chine ou d’Amérique du Sud. Il n’a pourtant rien d’universel. Derrière l’étiquette rassurante, on ne retrouvera pas les mêmes normes en fonction des pays de production.
Par exemple, alors que l’Europe impose des règles plutôt strictes, les États-Unis se montrent beaucoup plus souples. Dans certains pays émergents, comme le Brésil, ce sont les contrôles qui sont souvent moins sévères. Nous vous proposons ici un bref tour d’horizon, qui vous permettra, nous l’espérons, de mieux orienter vos choix de consommation.
À lire aussi :
Une agriculture 100% bio en France est-elle possible ?
L’absence de pesticides derrière le succès du bio français
En France, la consommation de produits biologiques a connu une croissance fulgurante. En 2023, après vingt années de progression continue, ce marché a été multiplié par 13 par rapport à son niveau initial.
Cette tendance s’explique par le fait que les consommateurs perçoivent le bio comme un produit plus naturel, notamment en raison de l’absence de traitements pesticides autorisés. La production bio doit respecter un cahier des charges plus attentif à l’environnement, ce qui favorise la confiance des consommateurs dans un contexte de plus en plus marqué par la défiance alimentaire.
Ce label demeure toutefois une construction réglementaire qui dépend fortement du contexte national. Cette dynamique positive se heurte aujourd’hui à des évolutions législatives à même de la fragiliser. La loi Duplomb, adoptée le 8 juillet 2025, illustre combien les choix politiques peuvent ébranler la confiance accordée à l’agriculture en réintroduisant la question des pesticides au cœur du débat. Cette loi propose en effet des dérogations à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes.
Même si elle loi ne concerne pas directement les producteurs biologiques, elle risque d’avoir des effets indirects sur le secteur. En réintroduisant des dérogations à l’usage de substances controversées, elle ravive la défiance du public envers l’agriculture conventionnelle. Dans ce contexte, les filières bio pourraient apparaître comme une valeur refuge pour les consommateurs, renforçant leur rôle de repère de confiance dans un paysage agricole fragilisé.
Dans l’Union européenne, un label bio garanti sans OGM
L’Union européenne (UE) a établi une réglementation stricte pour l’agriculture biologique dès 1991. Au-delà de la question des pesticides, qui se pose, comme on l’a vu plus haut, plus intensément en France, celle des organismes génétiquement modifiés (OGM) offre également une clé de lecture intéressante à l’échelle européenne.
En effet, le label bio européen interdit totalement le recours à OGM dans les produits labélisés bio, à toutes les étapes de sa chaîne de production. Cela signifie qu’il est interdit d’utiliser des semences OGM pour les cultures bio, pas d’alimentation animale issue des OGM pour l’élevage bio et pas d’ingrédients issus des OGM pour les produits transformés bio.
En outre, le cahier des charges européen du bio impose des pratiques agricoles strictes en limitant le recours aux intrants de synthèse. Ceci inclut les engrais azotés, les pesticides, les herbicides et les fongicides de synthèse. Seuls certains intrants naturels ou minéraux sont autorisés, à l’instar du fumier, compost et engrais verts. Ceci reflète la philosophie du bio, basée sur la prévention des maladies et des déséquilibres agronomiques, par le maintien de la fertilité des sols, la biodiversité et les équilibres écologiques.

JJ Georges, CC BY-SA
En France, le label français AB s’appuie ainsi sur le règlement européen, tout en ajoutant quelques exigences propres, comme un contrôle plus rigoureux de la traçabilité et du lien au sol.
Si les deux labels restent alignés sur les grands principes, le bio français se distingue par une mise en œuvre généralement plus stricte, héritée d’une longue tradition d’agriculture biologique militante.
Le bio en Europe se heurte aussi à un certain nombre d’enjeux actuels, notamment agronomiques. Il s’agit par exemple du besoin de renforcer la recherche sur les alternatives aux pesticides et autres intrants de synthèse, comme le biocontrôle, une sélection variétale adaptée et la gestion écologique des sols.
Enfin, force est de constater que l’UE a fait du bio un pilier de sa stratégie « de la ferme à la table » (« From Farm to Fork »). Celle-ci a pour objectif d’atteindre 25 % de la surface agricole utile (SAU) européenne en bio d’ici 2030.
Afin de garantir la fiabilité du label, l’UE a mis en place un système de contrôle centralisé et harmonisé de supervision des chaînes de valeur alimentaires. Celles-ci englobent les producteurs, les transformateurs, jusqu’aux distributeurs. Ces contrôles reposent sur des règles précises définies par le règlement européen 2018/848.
De son côté, le consommateur retrouvera les différents labels de certification bio, tels que le label européen EU Organic, le label national AB en France ou encore le Bio-Siegel en Allemagne. Même si tous ces labels reposent sur la même base réglementaire européenne, leurs modalités d’application (par exemple, le type de suivi) peuvent varier légèrement d’un pays à un autre. Chaque pays peut en outre y ajouter des exigences supplémentaires. Par exemple, la France impose une fréquence de contrôle plus élevée, tandis que l’Allemagne insiste sur la transparence des filières.
Une labélisation plus souple en Amérique du Nord
En Amérique du Nord, l’approche du bio est plus souple que celle de l’Union européenne. Aux États-Unis, le label USDA Organic, créé en 2002, définit les standards nationaux de la production biologique. Il se caractérise par une certaine souplesse par rapport aux standards européens, notamment en ce qui concerne l’usage des intrants, puisque certains produits chimiques d’origine synthétique sont tolérés s’ils sont jugés nécessaires et sans alternatives viables. Ceux-ci incluent, par exemple, certains désinfectants pour bâtiments d’élevage et traitements antiparasitaires dans la conduite de l’élevage.
Le Canada, de son côté, a mis en place sa réglementation nationale des produits biologiques – le Canada Organic Regime – plus tardivement que les États-Unis. Ce système est équivalent à celui des États-Unis, dans la mesure où un accord bilatéral de reconnaissance mutuelle permet la vente des produits bio canadiens aux États-Unis et vice versa.
Les deux systèmes présentent ainsi de nombreuses similitudes, notamment en ce qui concerne la liste des substances autorisées et leur flexibilité d’usage. Cependant, ils divergent du modèle européen sur plusieurs points.
Tout d’abord, alors que l’UE applique une tolérance quasi nulle vis-à-vis des OGM, les États-Unis et le Canada tolèrent, de façon implicite, la présence accidentelle de traces d’OGM dans les produits bio. En effet, selon le règlement de l’USDA Organic, l’utilisation volontaire d’OGM est strictement interdite, mais une contamination involontaire n’entraîne pas automatiquement la perte de la certification si elle est jugée indépendante du producteur. Le Canada adopte une position légèrement plus stricte, imposant des contrôles renforcés et une tolérance plus faible.
Cette différence a suscité des controverses au moment de l’accord de reconnaissance mutuelle, certains consommateurs et producteurs canadiens craignant de voir arriver sur leur marché des produits bio américains jugés moins exigeants sur la question des OGM. Celles-ci concernaient également les conditions d’élevage. En effet, alors qu’en Europe les densités animales sont strictement limitées et que les sorties en plein air sont très encadrées, en Amérique du Nord, certains systèmes de production biologique peuvent être beaucoup plus intensifs, menant à de véritables fermes industrielles biologiques, ce qui entraîne une perte de proximité avec l’idéal originel du bio.
Enfin, un autre contraste concerne les productions hors sol. Aux États-Unis, les fermes hydroponiques – qui cultivent les plantes hors sol – peuvent être certifiées USDA Organic, à condition que les intrants utilisés figurent sur la liste autorisée. En revanche, en Europe, l’hydroponie est exclue car elle ne respecte pas le lien au sol, considéré au cœur de la philosophie agroécologique.
À lire aussi :
« Les mots de la science » : A comme agroécologie
Dans les pays émergents, du bio mais selon quels critères ?
Dans les pays émergents, la question du bio se pose différemment. En effet, celle-ci dépend fortement des dispositifs et des critères mis en place par ces pays pour en garantir la crédibilité. À titre d’exemple, en Inde, au Brésil ou en Chine, les labels bio nationaux sont assez récents (la plupart ont été mis en place entre 2000 et 2010) et moins contraignants que leurs équivalents européens.
Alors que, dans l’UE, les contrôles sont effectués par des organismes certificateurs tiers accrédités et indépendants, au Brésil, les producteurs peuvent être certifiés via un système participatif de garantie (SPG), qui repose sur l’auto-évaluation collective des agriculteurs. En conséquence, ces labels peinent à construire une véritable confiance auprès des consommateurs.
Par ailleurs, dans de nombreux cas, les certifications biologiques sont avant tout conçues pour répondre aux standards des marchés internationaux afin de faciliter l’exportation vers l’UE ou l’Amérique du Nord, plutôt que pour structurer un marché intérieur. C’est, par exemple, le cas en Inde.
Cette situation laisse souvent les consommateurs locaux avec une offre limitée et parfois peu fiable. Dans ce contexte, les organismes privés de certification internationaux, comme Ecocert, Control Union ou BioInspecta occupent une place croissante. Ils améliorent la reconnaissance de ces produits, mais renforcent une forme de dépendance vis-à-vis de standards extérieurs, ce qui soulève des enjeux de souveraineté alimentaire mais aussi de justice sociale dans ces pays.
Le bio, un label global… mais éclaté
L’absence de reconnaissance universelle mutuelle entre les différents systèmes de certification biologique engendre de la confusion chez les consommateurs. Il crée également de fortes contraintes pour les producteurs.
En pratique, un agriculteur qui souhaiterait exporter une partie de sa production doit souvent obtenir plusieurs certifications distinctes. Par exemple, un producteur mexicain doit ainsi être certifié à la fois USDA Organic pour accéder au marché américain et EU Organic pour pénétrer le marché européen.
Cette multiplication des démarches alourdit les coûts et la complexité administrative pour les producteurs, tout en renforçant les inégalités d’accès aux marchés internationaux.
Du côté des consommateurs, l’usage généralisé du terme « bio » peut donner l’illusion d’une norme universelle, alors qu’il recouvre en réalité des cahiers des charges très différents selon les pays. Cette situation entretient une certaine ambiguïté et peut induire en erreur, en masquant les disparités de pratiques agricoles et de niveaux d’exigence derrière un label apparemment commun.
Comment s’y retrouver en tant que consommateur ?
Pour s’y retrouver dans la jungle du « bio », il faut donc aller au-delà du simple logo affiché sur l’emballage et s’informer sur la provenance réelle du produit et sur le cahier des charges du label précis qui le certifie.
Il est aussi essentiel de garder à l’esprit que bio ne signifie pas automatiquement « local » ni « petit producteur ». Certains produits certifiés biologiques proviennent de filières industrielles mondialisées.
Enfin, le consommateur peut jouer un rôle actif de « citoyen alimentaire », pour encourager davantage de transparence et de traçabilité, s’il favorise les circuits de distribution qui donnent accès à une information claire et détaillée sur l’origine et les modes de production. Il soutient alors une alimentation plus démocratique et responsable. C’est précisément cette implication citoyenne dans le système alimentaire qui peut favoriser l’essor d’une culture de l’alimentation locale et durable, fondée sur la confiance, l’attachement au territoire et la coopération entre producteurs et consommateurs.
Pour que le bio livre son plein potentiel en termes de transformation agroécologique des systèmes alimentaires mondiaux, peut-être faudrait-il, demain, envisager une harmonisation internationale du bio. C’est à cette condition qu’on pourra en faire un véritable langage commun pour les consommateurs, qui signifie réellement la même chose d’un pays à l’autre.
![]()
Marie Asma Ben-Othmen ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Pourquoi les labels « bio » ne se valent pas d’un pays à l’autre – https://theconversation.com/pourquoi-les-labels-bio-ne-se-valent-pas-dun-pays-a-lautre-267037