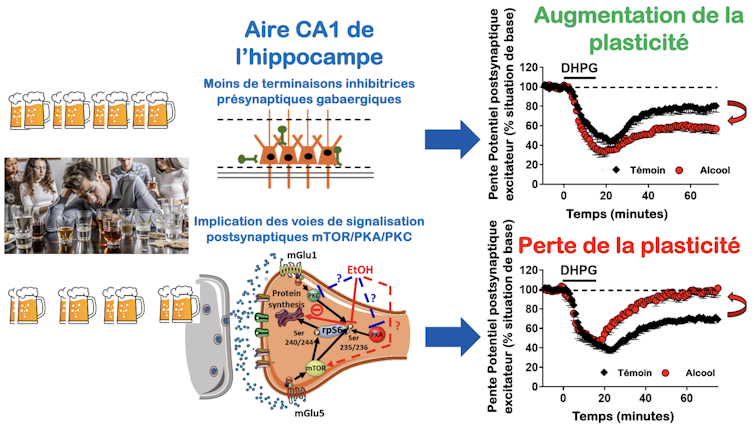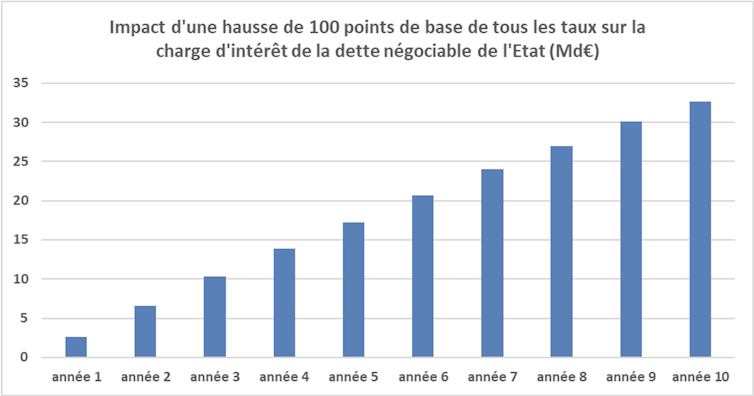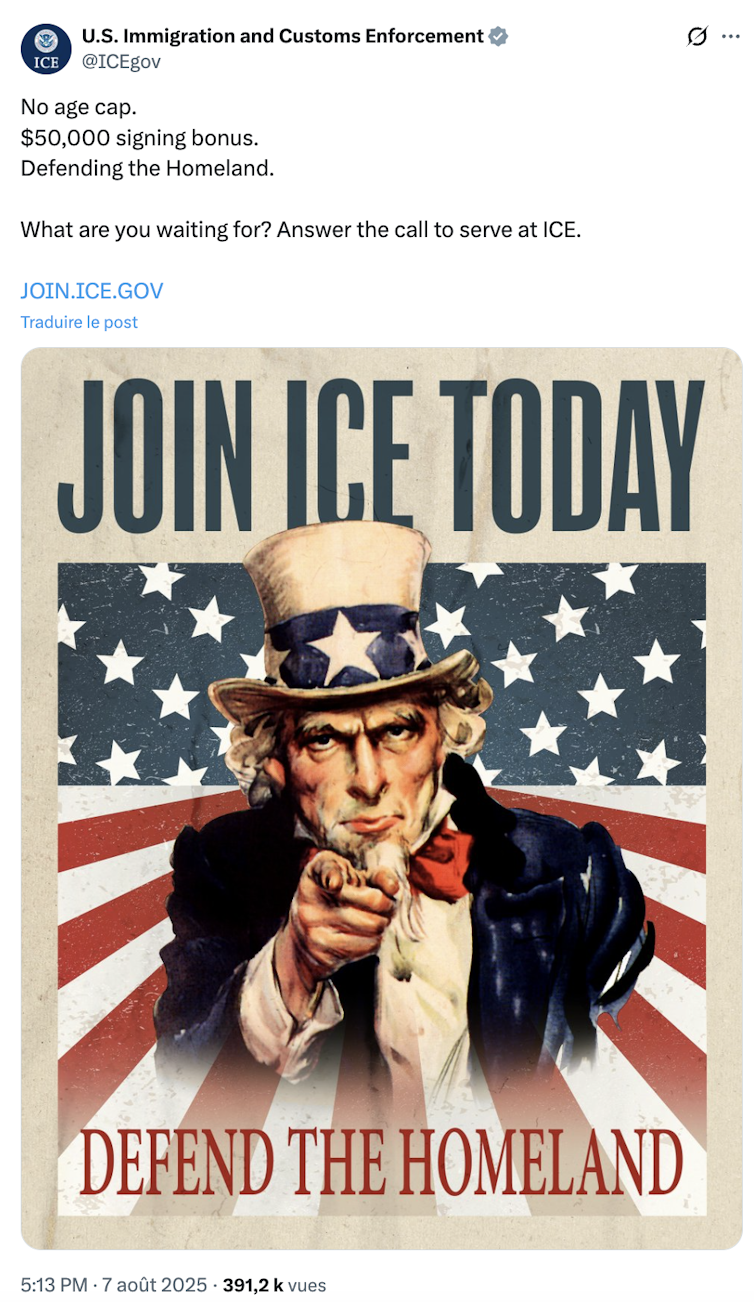Source: The Conversation – in French – By Wassim Tayssir, Doctorant en science politique, Université de Montréal
À Davos la semaine dernière, Mark Carney a marqué les esprits en livrant un diagnostic lucide sur l’état du système international. Le premier ministre canadien invite à repenser un ordre mondial qu’il juge dépassé, offrant ainsi une lecture réaliste des relations internationales contemporaines.
Salué pour son constat décomplexé sur la nouvelle donne internationale, le premier ministre appelle notamment à « cesser d’invoquer un ordre libéral fondé sur des règles » et à s’affranchir durablement de la « fiction » d’une hégémonie américaine bienveillante.
Ce manifeste de politique étrangère invite également au ralliement des « puissances moyennes », positionnant le Canada comme l’avant-poste d’un « arc de résistance » au trumpisme géopolitique. Le discours de Mark Carney a également résonné dans la sphère académique, en raison d’une articulation habile de plusieurs théories majeures de la discipline des Relations internationales.
Les approches libérales : une « fiction » géopolitique ?
En considérant qu’il fallait désormais « cesser d’invoquer l’ordre international fondé sur des règles », Carney remet en question une tradition clé du libéralisme en Relations internationales. Depuis le début du XXe siècle, les approches libérales ont cherché à créer un ordre pacifié et prévisible, du libéralisme wilsonien à l’après-Guerre froide avec l’« ordre libéral international » (Liberal International Order, LIO) théorisé par politologue américain John Ikenberry.
Ce concept désigne l’ensemble des structures idéologiques, normatives et institutionnelles mises en place par les États-Unis après 1945 : promotion de la démocratie, règles commerciales, alliances militaires comme l’OTAN, et gouvernance multilatérale via les organisations internationales.
Sans nier qu’il s’agissait d’un artefact destiné à pérenniser l’hégémonie américaine, Ikenberry note néanmoins que cet ordre international libéral a également bénéficié aux autres puissances du camp occidental, en garantissant les conditions sécuritaires et économiques de leur prospérité.
À lire aussi :
Mark Carney à Davos : virage à 180 degrés dans les relations avec les États-Unis
C’est le sens des propos de Mark Carney lorsqu’il affirme que « des pays comme le Canada ont prospéré grâce à l’ordre international libéral. Nous avons adhéré à ses institutions, vanté ses principes et profité de sa prévisibilité ».
Pour Carney cependant, « cette fiction était utile, mais partiellement fausse », car « les plus puissants y dérogeaient quand cela les arrangeait ». Les approches constructivistes l’avaient déjà souligné : derrière les bénéfices supposés mutuels se cachait souvent une relation de subordination à l’hégémon américain.
« Si les puissances hégémoniques renoncent même à faire semblant de respecter les règles pour défendre sans entrave leurs intérêts, les avantages du transactionnalisme deviennent difficiles à reproduire. Elles ne peuvent pas monnayer indéfiniment leurs relations », soulignait Carney.
À lire aussi :
« Carney a prononcé un discours courageux – parce que risqué », selon une spécialiste
Des effets supposément pacifiques à l’utilisation coercitive
Outre l’ordre international libéral, c’est également au regard de l’interdépendance économique que Mark Carney offre une lecture désenchantée. Ce dernier dénonce ainsi un système dans lequel « les grandes puissances agissent selon leurs intérêts en utilisant l’intégration économique comme une arme de coercition ».
Les débats sur les effets de l’interdépendance économique sont aussi vieux que la discipline des Relations internationales telle qu’elle émerge au début du XXe siècle. Dès 1910 en effet, l’écrivain et homme politique britannique Norman Angell soutient que cette l’interdépendance, en tant que vulnérabilité réciproque, rendrait la guerre irrationnelle.
Figure de proue du libéralisme de l’entre-deux-guerre, sa thèse sera sévèrement contestée à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Dans un ouvrage publié en 1939, l’éminent historien britannique Edward Hallett Carr théorise cette critique, qualifiant le libéralisme d’utopisme. De cette confrontation intellectuelle naîtra le premier grand débat des Relations internationales.
Ces débats ont été relancés à l’époque contemporaine avec l’apparition d’une littérature qui met en lumière les effets asymétriques de l’interdépendance économique — certains acteurs étant plus vulnérables que d’autres — et son potentiel coercitif, notamment sous l’influence de pressions domestiques.
Le discours de Mark Carney : une leçon de réalisme ?
En invitant à voir le monde « tel qu’il est, sans attendre qu’il devienne celui que nous aimerions voir », Carney illustre la fracture fondamentale entre libéralisme et réalisme en Relations internationales. Le libéralisme conçoit le système global tel qu’il devrait être : pacifié, encadré par des normes contraignantes et porteur de valeurs libérales. Le réalisme, lui, adopte une approche plus pragmatique, agnostique, et se concentre sur les rapports de force et les enjeux immédiats.
Les approches réalistes reposent sur quelques principes fondamentaux : le système international est anarchique ; les États en constituent les unités de base ; et leur objectif principal est de maximiser leur intérêt, défini en termes de capacités matérielles. Partant du postulat que l’intérêt égoïste des États guide entièrement le système, le réalisme reste sceptique face à tout cadre normatif censé réguler les relations internationales.
Pour les réalistes, une configuration hégémonique appelle trois stratégies possibles pour les États « de second rang » tels que le Canada :
-
L’équilibrage (balancing) : s’associer avec d’autres États pour contrebalancer l’hégémon
-
Le bandwagoning : s’associer à l’hégémon pour bénéficier de sa protection
-
Le hedging : « se couvrir » en multipliant les partenariats avec d’autres puissances pour distribuer les risques.
Alors que la politique étrangère canadienne s’inscrivait jusqu’alors dans une logique de bandwagoning à l’égard de la puissance américaine, le discours de Mark Carney suggère une inflexion stratégique majeure, en faveur d’une stratégie de hedging.
« Les grandes puissances peuvent se permettre d’agir seules. La taille de leur marché, leur capacité militaire et leur pouvoir leur permettent d’imposer leurs conditions. Ce n’est pas le cas des puissances moyennes. Les alliés chercheront à se diversifier pour parer à l’incertitude. Ils auront recours à des mécanismes de protection. Ils multiplieront leurs options », clamait-il.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Réalisme et valeurs : antinomiques ?
Dans son discours, Mark Carney propose un « réalisme fondé sur des valeurs », une combinaison pouvant apparaître contradictoire en raison du matérialisme agnostique du réalisme.
Mais l’histoire de la discipline des Relations internationales montre que les considérations idéologiques et matérielles peuvent coexister. Le sociologue français Raymond Aron soulignait en effet que la politique étrangère intégrait, au-delà des déterminations matérielles, des considérations de valeurs, notamment idéologiques. Dans cette veine, le chercheur et diplomate français Jean-Baptiste Jangène Vilmer faisait le plaidoyer en 2023, pour un « réalisme libéral ».
Carney résume cette approche ainsi : « Nous ne comptons plus uniquement sur la force de nos valeurs, mais également sur la valeur de notre force ».
Reste désormais à voir si ce discours stratégique sera accompagné d’effets concrets dans la conduite de la politique étrangère canadienne.
![]()
Wassim Tayssir ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Voir le monde tel qu’il est : le message (réaliste) de Carney à Davos – https://theconversation.com/voir-le-monde-tel-quil-est-le-message-realiste-de-carney-a-davos-274189