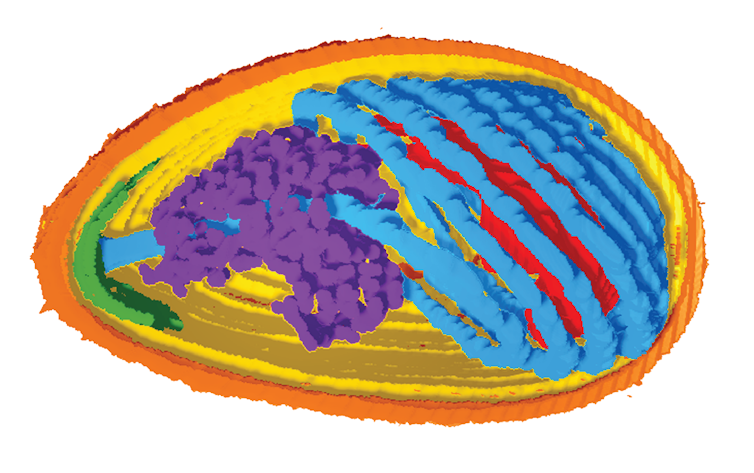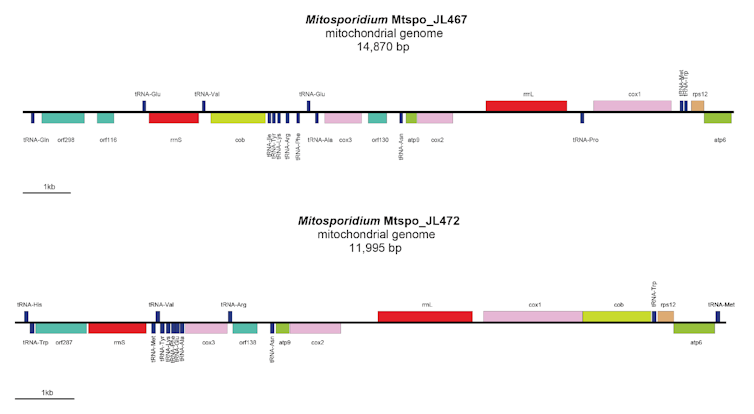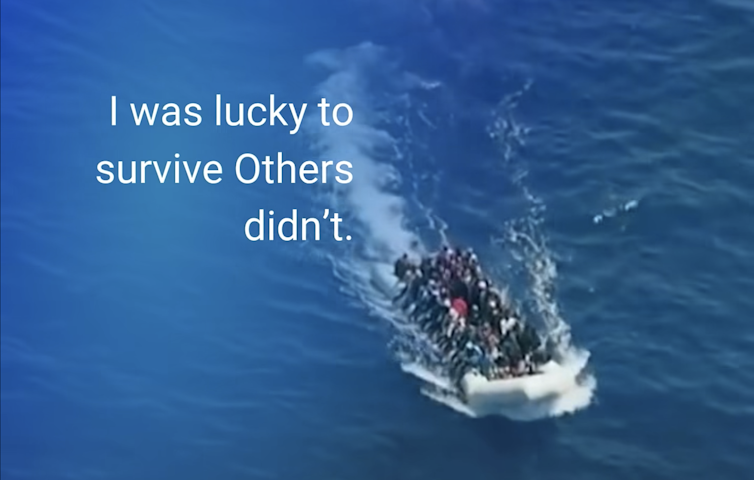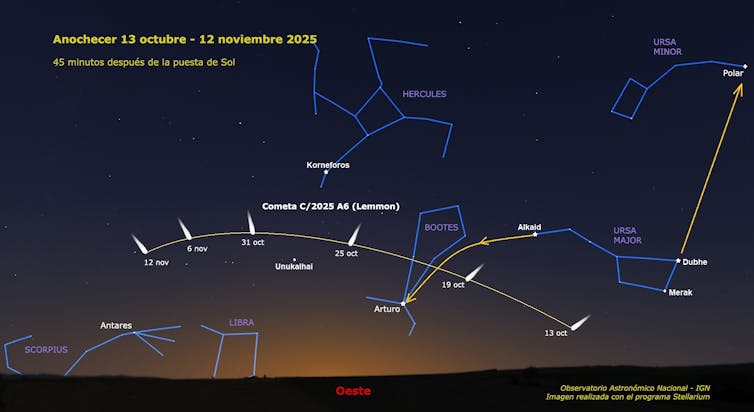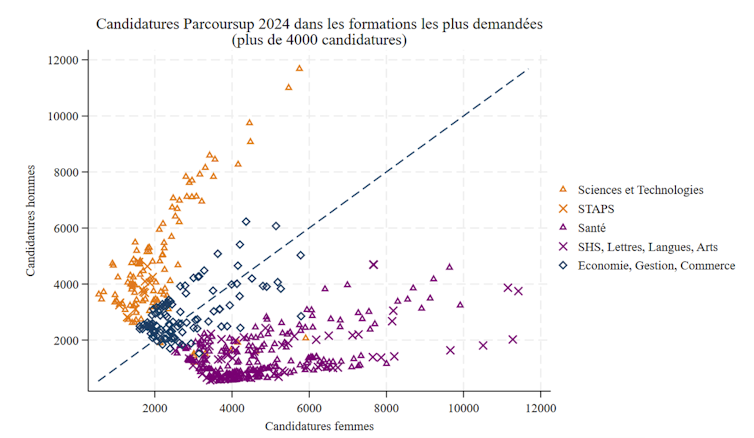Source: The Conversation – France (in French) – By Samson JEAN MARIE, Doctorant en anthropologie et géographie, Ingénieur agronome, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Entre promesse de résilience alimentaire et menaces écologiques silencieuses, le tilapia cristallise aujourd’hui les grands enjeux du développement de l’élevage de poissons dans les territoires insulaires. En Haïti par exemple, où il s’est largement développé, le tilapia est présenté comme une solution prometteuse pour renforcer la sécurité alimentaire. Toutefois, cette expansion, souvent promue sans garde-fous écologiques solides, soulève de vives préoccupations environnementales, notamment autour de la gestion de l’eau douce et des risques liés à la diffusion incontrôlée du tilapia dans les milieux naturels.
C’est un poisson que l’on retrouve aujourd’hui sur des îles du monde entier. On l’appelle tilapia, mais derrière ce nom vernaculaire se trouve en réalité un ensemble de cichlidés, des poissons tropicaux d’eau douce, principalement des genres Oreochromis, Tilapia et Sarotherodon, indigènes d’Afrique et du sud-ouest de l’Asie. L’élevage du tilapia est aujourd’hui pratiqué dans plus de 135 pays, de la Chine et de l’Indonésie, dans le Pacifique, au Brésil, au Mexique et à Haïti. Cet engouement s’explique par sa capacité à croître rapidement (atteignant 400 ou 500 grammes en cinq à huit mois en étang), à se nourrir de ressources variées et à s’adapter à des milieux divers, autant d’atouts qui facilitent son élevage par rapport à bien d’autres espèces de poissons d’eau douce.
Importé d’Afrique dans les années 1950, le tilapia (Oreochromis mossambicus) a été largement diffusé à travers Haïti, notamment à partir des années 1980, avec l’appui de la Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, au point de devenir l’un des poissons d’élevage les plus utilisés dans les projets d’aquaculture rurale.
Aujourd’hui, Haïti dispose ainsi de plusieurs initiatives aquacoles d’envergure variable, allant des stations expérimentales aux exploitations privées commerciales comme Taïno Aqua Ferme sur le lac Azuéi. Toutefois, malgré ces efforts, la pisciculture demeure marginale : moins de 4 % des agriculteurs haïtiens y sont engagés, et la consommation annuelle de poisson (4,5 kg/an) reste inférieure à la moyenne caribéenne.
Parmi les freins récurrents figurent l’accès irrégulier aux jeunes poissons et aux aliments (coûts, importations), les contraintes d’eau et d’énergie, l’accompagnement technique limité, l’insécurité et des chaînes du froid et d’écoulement insuffisantes, soit autant d’obstacles qui fragilisent les modèles économiques des petites exploitations.
Malgré ce bilan pour le moins mitigé, certains, à l’instar de l’ancien ministre de l’agriculture Patrix Sévère, ont continué de nourrir l’ambition « de voir tous les plans d’eau du pays peuplés de tilapia ». En voulant « passer de la parole aux actes », l’actuel ministre de l’agriculture Vernet Joseph promettait en août 2024 d’introduire dans quatre plans d’eau du pays (le lac de Péligre, l’étang Bois Neuf, le lac Azuei et l’étang de Miragoâne), trois millions de jeunes tilapias ».
L’opération, selon lui, devait permettre, en deux mois, la production « de 25 tonnes de poissons ». Aujourd’hui, cependant, le projet est suspendu à la suite d’un avis consultatif initial de Caribaea Initiative (organisation consacrée à la recherche et la conservation de la biodiversité caribéenne) soulignant les risques écologiques, notamment pour les espèces de poissons endémiques de l’étang de Miragroâne. Aucune décision officielle n’a encore été actée quant à la poursuite ou non du projet, lequel resterait également conditionné à la mobilisation de financements, « selon un cadre du ministère de l’agriculture ».
Des expériences contrastées en contexte insulaire : l’exemple de Santo (Vanuatu)
À plus de 13 000 kilomètres de là, dans le sud de l’île de Santo au Vanuatu (archipel du Pacifique Sud), une expérience parallèle fortuite permet cependant de tirer des leçons précieuses. En avril 2020, le cyclone Harold a frappé de plein fouet cette île volcanique, provoquant le débordement de nombreux bassins piscicoles artisanaux. Des milliers de tilapias se sont ainsi échappés et ont colonisé les cours d’eau naturels, entraînant une transformation brutale des écosystèmes aquatiques. Les résultats préliminaires des enquêtes menées dans le cadre d’une thèse, conduite au sein du projet « Climat du Pacifique Sud, savoirs locaux et stratégies d’adaptation » (Clipssa), auprès d’une centaine d’usagers de cinq cours d’eau de l’île, révèlent que 87 % des personnes interrogées déclarent avoir constaté une diminution, voire une disparition, de nombreuses espèces de poissons et de crustacés autochtones depuis l’introduction involontaire du tilapia.
« Il y avait des crevettes, des poissons noirs [black fish], des anguilles […]. Maintenant, il n’y a presque plus que du tilapia », témoigne ainsi une habitante du sud-ouest de l’île.
« On ne pêche plus comme avant. Le tilapia est partout, il mange les œufs des autres poissons et tous ceux qu’ils trouvent », ajoute un pêcheur sur la côte est de l’île.
Les études menées par des chercheurs chinois et thaïlandais rapportent que l’introduction de deux espèces de tilapia dans leurs pays respectifs a également entraîné une réduction significative de la biodiversité des poissons natifs. Ces résultats sont corroborés par les données du Global Invasive Species Database, qui soulignent que le tilapia figure parmi les 100 espèces envahissantes les plus problématiques au monde.
Toutefois, il convient de nuancer ce constat. Une introduction maîtrisée de tilapia dans un écosystème ne conduit pas systématiquement à des effets négatifs. Les recherches du biologiste kenyan Edwine Yongo au sujet de la Chine et de Daykin Harohau aux îles Salomon montrent que, dans certaines conditions, l’élevage de cette espèce peut contribuer au contrôle des algues nuisibles, grâce à son régime alimentaire et à ses activités de fouissage des sédiments. Ce processus contrôlé peut ainsi améliorer la qualité de l’eau, tout en soutenant la sécurité alimentaire locale, notamment dans les contextes insulaires ou ruraux.
En somme, c’est donc moins l’espèce en elle-même que les modalités de son introduction et de son suivi qui déterminent si elle devient un facteur de dégradation écologique ou, au contraire, un levier de régulation et de sécurité alimentaire.
Quelles leçons pour Haïti ?
L’expérience de Vanuatu, tout comme les travaux menés en Chine et aux îles Salomon, offre ainsi à Haïti une précieuse grille de lecture pour penser l’avenir de l’élevage du tilapia sur son territoire. Si ce poisson peut devenir un levier de sécurité alimentaire, sa prolifération incontrôlée pourrait également menacer les écosystèmes aquatiques déjà fragiles et nuire à la biodiversité locale. Introduire massivement un poisson « pour nourrir la population locale » sans tenir compte de ces équilibres pourrait donc s’avérer contre-productif, en concurrençant les espèces locales, en perturbant les chaînes alimentaires et, in fine, en fragilisant les moyens d’existence de nombreux ménages. Son introduction dans le lac Miragoâne en Haïti pourrait par exemple entraîner un désastre écologique et conduire à l’extinction de tout un groupe d’espèces de petits poissons du genre Limia, endémiques de ce plan d’eau et que l’on ne trouve donc nulle part ailleurs en Haïti ou dans le monde.
Des exemples d’élevages circulaires ou multitrophiques, c’est-à-dire associant plusieurs niveaux de la chaîne alimentaire (poissons, mollusques filtreurs, algues) afin de recycler les nutriments, menés en Chine, au Sénégal ou d’autres types de projets pilotes en Haïti (comme Taïno Aqua Ferme, Caribean Harvest), montrent qu’il est possible de développer une aquaculture durable, à condition de :
-
maîtriser l’élevage en bassins clos ou cages flottantes sécurisées, de préférence dans des lacs artificiels, afin d’éviter tout risque pour les grands lacs naturels comme le lac Miragoâne, qui abrite une communauté de poissons endémiques ;
-
recourir à des espèces adaptées. Le rapport rédigé par Gilles, Celestin et Belot (2021) à la demande de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) propose un modèle plus durable, adapté aux spécificités haïtiennes : l’élevage du tilapia ouest-africain Sarotherodon melanotheron, une espèce qui se nourrit surtout de débris organiques et d’algues en décomposition et qui tolère de fortes variations de salinité ;
-
valoriser les sous-produits agricoles (son de riz de l’Artibonite, pelures de banane-plantain, tourteaux d’arachide, drêche de sorgho séchée) et limiter la dépendance à des aliments importés ;
-
renforcer la formation technique des éleveurs pour garantir le bon fonctionnement des systèmes d’élevage ;
-
protéger les installations d’élevage contre les évènements météorologiques et climatiques extrêmes.
Poisson miracle pour certains, espèce à risque pour d’autres, le tilapia incarne à lui seul les dilemmes du développement aquacole en Haïti. Tirer les leçons des expériences internationales, notamment celles de Santo au Vanuatu, c’est comprendre qu’une expansion sans garde-fous écologiques pourrait transformer une solution alimentaire en problème écologique. L’avenir de la pisciculture haïtienne ne se jouerait pas seulement dans les bassins : il dépendra aussi de choix politiques éclairés, de modèles durables, et d’une écoute attentive des écosystèmes comme des communautés locales.
![]()
Samson JEAN MARIE ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Le tilapia, un poisson dont le succès pose question, des Caraïbes au Pacifique – https://theconversation.com/le-tilapia-un-poisson-dont-le-succes-pose-question-des-cara-bes-au-pacifique-265895