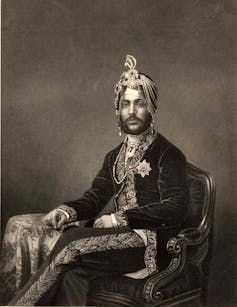Source: The Conversation – France in French (3) – By Coline Arnaud, Chercheuse au Laboratoire centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay

Si sa consommation baisse en France, le pain reste un aliment de base et son approvisionnement, les évolutions de son prix font l’objet d’une grande attention politique. Cette place centrale trouve sa source dans l’histoire. Pour bien la comprendre, il est important de revenir sur son rôle dans les sociétés du Moyen Âge.
« Est-ce la fin de la baguette ? » Le constat du média CNN, reposant sur une enquête récente de la Fédération des entreprises de boulangerie française, est sans appel : la consommation de pain a baissé dans l’Hexagone de plus de 50 % depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Pourtant, son approvisionnement continue de faire l’objet d’une attention constante de la part des États, notamment dans un contexte d’accroissement des conflits armés et de crises sanitaires. Pour mieux comprendre la valeur sociale, politique et symbolique de cet aliment dans nos sociétés contemporaines, il est nécessaire d’interroger son rôle au fil des époques, en revenant notamment sur le sens de cet aliment au Moyen Âge.
Si le pain est considéré par la recherche contemporaine comme un ingrédient majeur de la survie de l’humanité, c’est parce que son usage simultané dans plusieurs sociétés, par ailleurs éloignées sur les plans géographique et culturel, constitue une forme essentielle de diversification alimentaire (au-delà des protéines et des végétaux). Les débuts du pain évoluent au gré des découvertes archéologiques, mais les premières galettes de riz, bulbe de jonc, maïs ou encore blé sont identifiées dès la fin du Paléolithique. Ce rôle central se perpétue au fil des siècles, dans l’Antiquité et jusqu’au Moyen Âge.
En Europe, le XIVe siècle marque progressivement l’instauration de sociétés de cour à la relative pérennité dont le schéma féodal, séparant le peuple, le clergé et la noblesse, s’organise autour du pain. Faisant parfois curieusement écho à l’organisation politique de notre monde actuel, la société médiévale se divise ainsi entre ceux qui reçoivent, ceux qui produisent, ceux qui donnent, dans un jeu de distinctions et de pouvoirs qui n’exclut ni la nuance ni l’ambiguïté.
Le pain et la couronne : un fragile équilibre
Les têtes couronnées de la fin du Moyen Âge le savent à leurs dépens, le pain est l’ingrédient premier d’une société apaisée. La célèbre maxime romaine « Panem et circences » (« Du pain et des Jeux ») synthétise à elle seule le contrat tacite qui lie le dirigeant à ses administrés. Le premier protège, le second travaille.
La paix sociale s’achète ainsi par un approvisionnement régulier et suffisant en pain. Ce dernier représente de très loin l’aliment le plus consommé par tous et, par conséquent, la part la plus importante du budget alimentaire des familles. C’est pourquoi, le roi cherche dès le XIIIe siècle à contrôler l’influente corporation des talemeliers (ancien nom des boulangers) par un encadrement de ses statuts qui régule également les conditions d’exercices et de production du pain.
L’équation est complexe et l’équilibre délicat pour parvenir à une denrée à la composition fiable, au poids raisonnable et au prix juste. La police du pain mise en place par Charles V en 1372 applique des taxes fluctuantes sur les matières premières, le produit fini, les ventes et se montre sans pitié sur les fraudes.
La profession est assujettie à des taxes d’installation, à des contrôles réguliers et à un encadrement permanent de la valeur marchande du pain. Par décret, seuls trois types de pains peuvent être fabriqués : le pain mollet (à la fine fleur de froment), le pain cléret (composé de farines de blé et de seigle) ou bourgeois, et le pain brun ou de « retraites » (uniquement constitué de farine complète, dense et roborative).

Rolf Kranz/Wikimédia, CC BY-SA
Néanmoins, ces restrictions sont rapidement contournées par les boulangers qui répondent à la demande de l’aristocratie pour un pain socialement différencié, qui lui permet, notamment de se distinguer de la bourgeoisie des villes, elle-même avide des mêmes privilèges que la noblesse.
C’est ainsi que des pains de fantaisie apparaissent, vendus en marge des recettes autorisées. Ces derniers s’appuient sur l’échelle de valeurs chromatiques qui régit alors l’appréciation de cet aliment en établissant une hiérarchie des consommateurs.
Les pauvres doivent ainsi se satisfaire d’un pain noir de son ou de sarrasin, à la mie épaisse et à la croûte dure, quand les plus riches se régalent de pains de Gonesse, fabriqués à partir d’une fine fleur de froment, au blutage serré. Littérature, iconographie et chansons participent à la promotion de ce système pyramidal qui valorise le gosier délicat d’un nanti par rapport aux rudes besoins des paysans.
« Charité bien ordonnée… » : collecter et distribuer le pain
Rappelons d’abord que les relations entre l’Église et le pain sont nombreuses, ne serait-ce que parce que la symbolique chrétienne s’appuie en grande partie sur la métaphore du pain comme signe de vie et d’espoir. La mise en place du sacrement de l’Eucharistie, au XIIIe siècle, confirme cette importance.
L’institution ecclésiastique incarne une forme de passerelle entre la couronne et le reste de la population à travers, par exemple, l’exercice de la charité. Les distributions de pains font en effet partie intégrante du quotidien des monastères. Ceux-ci centralisent les dons des nobles et des riches communautés marchandes qui assurent ainsi leurs saluts par leur générosité.
Les communautés religieuses entreposent ces dons alimentaires puis organisent les collectes en effectuant un tri dans les bénéficiaires. Les femmes, les enfants et les malades sont prioritaires au détriment de tous ceux qui ne contribuent pas à la vie économique et spirituelle de la communauté.
Cette charité du pain rythme ainsi les calendriers juif et chrétiens et constitue un ensemble de rituels importants qui participe à la relation de dépendance entre pauvres et riches, entre survie, devoir moral et achat d’une probité.
Le pain des pauvres
L’iconographie médiévale, de la tapisserie aux enluminures, offre un aperçu informé de la place de chacun au cœur du système féodal. Les populations rurales constituent la cheville ouvrière du pain à travers semences et moissons. Le travail des champs se conçoit autour de la vie de la cité, cette dernière garantissant le stockage et la protection du grain dans des granges dîmières, propriétés de la commune, gardées par des soldats qui contrôlent chaque sac entrant et sortant. Ces espaces sont de véritables ruches où se croisent paysans, commerçants, édiles et militaires.
Cette relation d’interdépendance encourage les villes, comme la cité-État de Sienne, en Italie du Nord, à promouvoir un chemin vertueux et sécurisé du pain. Celui-ci devient rapidement une métaphore plus générale d’une philosophie politique plaçant l’individu au cœur d’un système de réciprocité et d’équilibre collectif.
Mais le pain des pauvres, c’est aussi, en écho aux conflits actuels, celui de la révolte et du soulèvement. Les atroces récits des famines qui jalonnent la seconde partie du Moyen Âge (1030-1033, puis 1270, 1314-1318 et périodiquement jusqu’en 1347) marquent les esprits et fournissent un terreau propice à l’effroi collectif et à la contestation.
À lire aussi :
Le pain, une longue histoire d’innovations techniques et sociales
Le blé ne manque pourtant pas toujours sur le territoire français ou dans les pays voisins. Mais son acheminement, depuis des territoires parfois éloignés, et sa distribution font l’objet de spéculations financières qui influencent le cours du grain et vont jusqu’à faire tripler le prix du pain.
Les meneurs des révoltes sont rarement les bénéficiaires de la charité ecclésiastique. Sans être nantis, ces paysans relativement aisés sont les premiers touchés par l’instabilité monétaire générée par la flambée du prix du blé et les levées d’impôts qui en découlent.
Les cibles de ces révoltes sont plurielles, à l’instar de tout mouvement contestataire : les « riches » qui se nourrissent au-delà de la satiété, les collecteurs de taxes, les usuriers et plus largement ceux qui incarnent une opulence indécente en des temps d’incertitudes chroniques.
L’Ancien Régime hérite et perpétue la plupart de ces représentations et de ces fonctionnements politiques. La couronne de France multiplie contrôles et régulations sur la profession, mais les famines qui jalonnent les XVIIe et XVIIIe siècles alimentent révoltes, suspicions et colères.
Prélude à la Révolution, la « guerre des farines » de 1775 synthétise trois siècles de cheminements politiques, sociaux et intellectuels autour de la question décidément centrale du pain pour tous.
![]()
Coline Arnaud a reçu des financements de la Bibliothèque nationale de France dans le cadre d’une bourse de recherche de “chercheuse invitée” en 2017.
– ref. Mettre du pain sur la table : au Moyen Âge, un enjeu politique – https://theconversation.com/mettre-du-pain-sur-la-table-au-moyen-age-un-enjeu-politique-270331