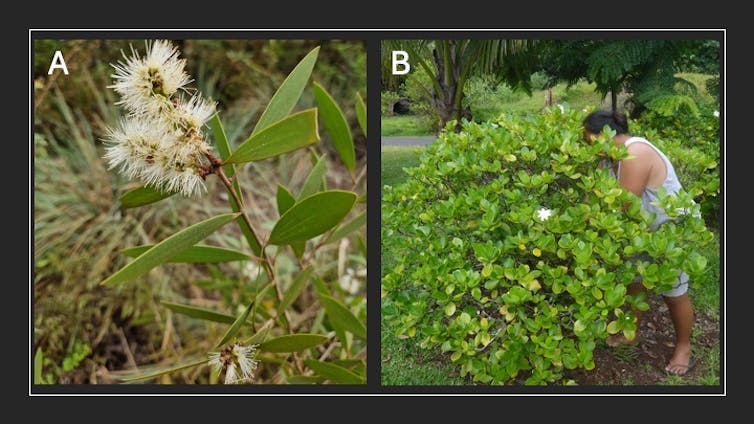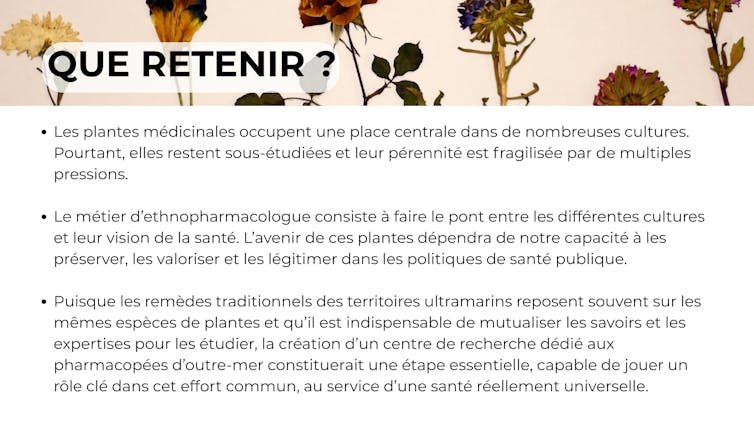Source: The Conversation – France in French (3) – By Arnaud Haquet, Professeur de droit public, Université de Rouen Normandie
Promis depuis plus de quarante ans, le « statut de l’élu local » a vu le jour, ce lundi 8 décembre. Très attendue par les élus, cette loi révèle pourtant un paradoxe : comment donner un statut à une fonction dont les contours restent flous et dont les conditions d’exercice sont profondément inégales ? À travers ce texte se révèle le profond malaise de l’engagement politique local.
Les élus locaux disposent désormais d’un « statut ». Une proposition de loi a été approuvée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et au Sénat en première lecture – un tel consensus, dépassant les clivages politiques, demeure suffisamment rare pour être souligné. En seconde lecture, les députés ont validé, le lundi 8 décembre, le texte tel qu’amendé par le Sénat. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur avant les élections municipales de mars 2026.
Une très longue attente
Les élus des collectivités territoriales (communes, départements et régions) réclament depuis longtemps ce statut, qui a leur a été promis par le législateur depuis le début des années 1980. Lors du lancement de la décentralisation, le législateur s’était engagé à créer ce « statut ». L’article 1er de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions prévoyait que des « lois détermineront […] le statut des élus ». Mais le législateur n’a jamais réalisé cet engagement.
Les élus locaux sont ainsi restés dans l’attente d’un statut qui s’est au fil du temps chargé d’une dimension idéalisée. Elle a nourri l’espoir que l’adoption de ce statut améliorerait leur situation.
L’adoption prochaine d’un statut de l’élu local pose néanmoins la question de sa définition. À vrai dire, cette question aurait dû être posée depuis longtemps. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, les nombreux rapports qui ont été publiés sur le sujet n’ont jamais défini le statut de l’élu local. Ils ont exprimé le besoin d’un statut sans le définir.
Qu’est-ce qu’un statut ?
La définition courante d’un statut renvoie à un texte qui précise les droits et obligations des membres d’une communauté, souvent professionnelle, en fonction des missions qui leur sont confiées. Il fixe également les conditions d’accès à ces fonctions. Il existe ainsi un statut des fonctionnaires dans le code général de la fonction publique ou celui du salarié dans le Code du travail.
Dès lors, s’il n’existe pas de statut des élus locaux, l’on devrait supposer qu’aucun texte ne précise les droits et obligations des élus des collectivités territoriales. Mais est-ce le cas ?
Un statut déjà constitué
Curieusement, non. Les droits et obligations sont déjà fixés par le Code général des collectivités territoriales (CGCT).
- Des droits
Le titre II du CGCT, consacré aux « garanties accordées aux élus locaux », énumère les droits dont ils bénéficient. Parmi eux figurent une indemnité de fonction, variable selon la taille de la collectivité et la nature des responsabilités ; une protection sociale et un dispositif de retraite ; des autorisations d’absence et des crédits d’heures permettant de quitter son entreprise pour l’exercice du mandat ; une possibilité de suspendre son contrat de travail avec droit à réintégration ; un droit à la formation, tant pour exercer son mandat que pour préparer son retour à l’emploi, etc. Tous ces droits ont été progressivement introduits dans le CGCT par le législateur.
- Des devoirs
De même, des obligations des élus figurent dans plusieurs codes (et notamment dans le Code pénal). Depuis 2015, elles sont également résumées dans la « charte de l’élu local », inscrite à l’article L. 1111-1-1 du CGCT. Elle rappelle que l’élu doit exercer ses fonctions « avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité », poursuivre « le seul intérêt général », ou encore prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Cette charte doit être lue par le maire, ou le président de la collectivité, à l’intention de tous les élus lors de l’installation du nouveau conseil (municipal, départemental ou régional).
Les conditions d’accès aux mandats locaux sont, quant à elles, définies principalement par le code électoral.
Dès lors, si tous les éléments constitutifs d’un statut figurent déjà dans le CGCT, pourquoi le législateur s’apprête-t-il à instaurer formellement ce statut ? Et pourquoi les élus s’en félicitent-ils ?
Une réponse au malaise de l’élu local
Investi d’une portée symbolique, idéalisé et élevé au rang d’enjeu majeur, l’adoption du statut de l’élu local est perçue comme une réponse aux préoccupations des élus locaux.
Ils expriment très régulièrement leur lassitude face à des difficultés persistantes. Les collectivités doivent assumer des compétences insuffisamment financées. Les élus dénoncent par ailleurs l’accumulation de normes générant un sentiment d’insécurité juridique. S’y ajoutent, pour les maires et présidents, des inquiétudes liées à leur responsabilité financière ou pénale, ainsi qu’aux violences dont certains se disent victimes.
Ces facteurs pèsent lourdement sur leur moral et contribuent à l’augmentation du nombre de démissions en cours de mandat. Selon un rapport du Sénat, près de 1 500 maires ont démissionné depuis le dernier renouvellement de 2020 (chiffre de février 2024).
Les gouvernements se sont inquiétés de ce malaise. C’est pourquoi la proposition de loi créant un statut de l’élu local a été soutenue dès son dépôt par les Premiers ministres qui se sont succédé durant la procédure législative (Michel Barnier, François Bayrou et Sébastien Lecornu, qui a salué l’adoption prochaine du texte lors du Congrès des maires le 20 novembre 2025).
Pourquoi ce nouveau texte est-il qualifié de statut de l’élu local ?
Un argument fréquemment avancé – très discutable – consiste à dire que la reconnaissance de droits et obligations dispersés dans la législation ne suffit pas. Un statut suppose un texte spécifique définissant la nature du mandat et regroupant les droits et les devoirs.
La proposition de loi vient combler cette absence. Elle formalise en effet le statut de l’élu local dans une nouvelle section du CGCT, énumérant de manière générale les principaux droits et obligations des élus locaux (en reprenant la « charte de l’élu local »).
Le texte comporte, par ailleurs, une disposition qui peut sembler relever de l’évidence. Elle précise que « tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres ». Cette précision n’est pourtant pas anodine parce qu’elle a longtemps été mise en avant pour justifier la difficulté à concevoir un statut de l’élu local.
Une précision révélatrice d’un modèle de statut
La question de savoir si le « métier d’élu » ne pouvait pas être assimilé à une profession a constitué un obstacle à l’adoption d’un statut de l’élu local. Ainsi, la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux n’a pas utilisé le terme de « statut », mais de « garanties », « pour ne pas accréditer l’idée d’une professionnalisation de l’exercice des mandats locaux » (selon le sénateur Jean-Pierre Sueur).
Le débat sur la professionnalisation concerne surtout les exécutifs locaux (maires et adjoints, présidents et vice-présidents), qui sont de véritables administrateurs de leur collectivité, et sont soumis à ce titre à des régimes de responsabilité pénale et financière exigeants. On peut, en effet, les considérer comme des « managers » qui perçoivent en contrepartie de leur action des indemnités de fonction assimilées à une rémunération (soumises à l’impôt, ainsi qu’à la CSG et à la CRDS). Il peut donc paraître réducteur d’affirmer qu’ils n’exercent pas une forme d’activité professionnelle.
À l’inverse, le terme est peu adapté pour les conseillers sans délégation, dont la participation se limite aux séances du conseil et qui, pour la plupart, ne perçoivent aucune indemnité.
En réaffirmant que le mandat local se distingue d’une activité professionnelle, la proposition de loi renforce l’idée selon laquelle il s’agit d’une activité d’intérêt général exercée, en principe, à titre bénévole, conformément au principe selon lequel « le mandat de maire, d’adjoint ou de conseiller municipal est exercé à titre gratuit » (art. L. 2123-17 CGCT).
Cette affirmation ignore la très grande diversité des situations des élus locaux et des niveaux d’indemnisation. Si le conseiller municipal d’une petite commune ne perçoit rien, le conseiller départemental ou régional a droit à une indemnité mensuelle brute qui varie entre 1 500 euros à 2 700 euros brut selon la taille de la collectivité (CGCT, art. 3123-16 et art. 4135-16). De même, si le maire d’une petite commune ne peut recevoir plus de 1 000 € brut, les maires d’une ville, d’un président de département ou de région peuvent recevoir 5 600 € brut (CGCT, art. L. 2123-23 ; art. 3123-17 ; art. L. 4135-17) avec des possibilités de majoration de l’indemnité.
Il existe donc une forte disparité entre, d’une part, les élus qui ne peuvent assumer leur mandat qu’en exerçant une activité professionnelle ou en étant à la retraite et, d’autre part, ceux qui peuvent s’y consacrer pleinement.
La loi créant un statut de l’élu local est-elle symbolique ?
Cette loi est largement symbolique, parce que, tout bien considéré, elle officialise un statut qui existait déjà.
Elle apporte certes quelques ajustements. Pour les droits, elle augmente légèrement les indemnités des maires des petites communes. Elle étend aussi la protection fonctionnelle à tous les élus locaux et elle clarifie la notion de conflit d’intérêts en la limitant à la recherche d’un « intérêt privé » (et non à celui d’un « intérêt public »).
Pour les devoirs, elle prévoit l’obligation pour l’élu local de s’engager « à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République ». Cette disposition peut surprendre en ce qu’elle traduit une forme de défiance à l’égard de certains élus, que le législateur semble juger insuffisamment attachés aux principes républicains. Une telle obligation n’est en effet prévue pour aucune autre catégorie d’élus, qu’il s’agisse des députés, des sénateurs, ou même du président de la République.
Est-ce là le statut tant attendu par les élus locaux ? Leur offrira-t-il la protection et la reconnaissance qu’ils espéraient ? On peut en douter.
![]()
Arnaud Haquet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Statut de l’élu local : ce que change la nouvelle loi – https://theconversation.com/statut-de-lelu-local-ce-que-change-la-nouvelle-loi-268029