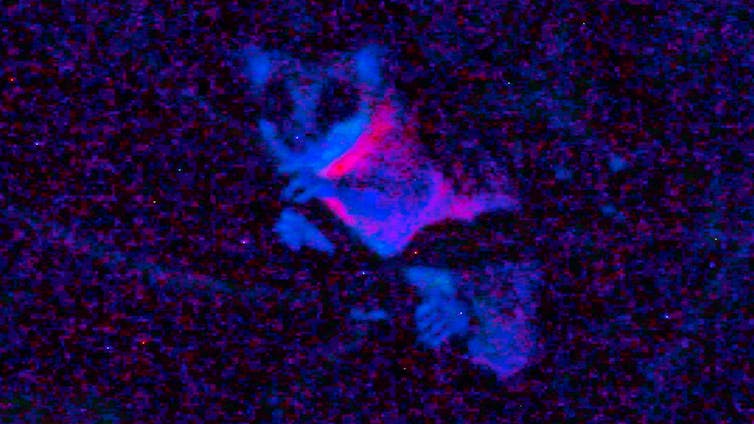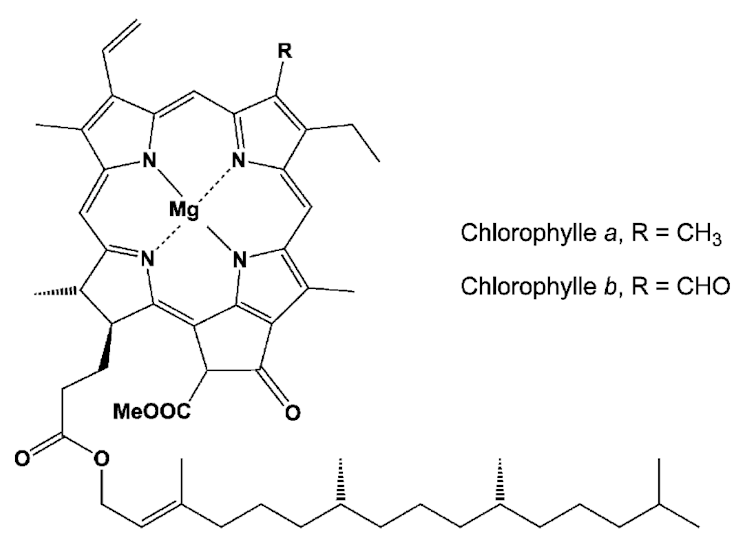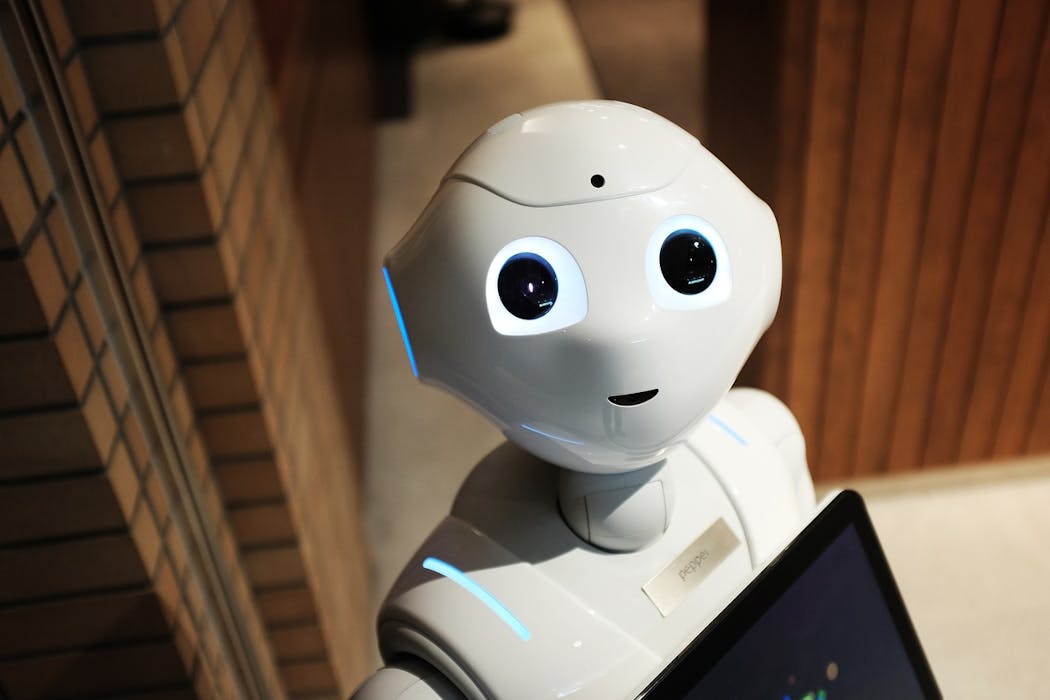Source: The Conversation – in French – By Jennifer LP Protudjer, Associate Professor and Endowed Research Chair in Allergy, Asthma and the Environment, University of Manitoba
Une assiette de biscuits fraîchement sortis du four, un verre de lait de poule joliment décoré… Pour beaucoup, ces images évoquent des souvenirs chaleureux et l’anticipation des fêtes de fin d’année.
Mais pour les personnes ayant des restrictions alimentaires, ces friandises et autres gourmandises des fêtes peuvent aussi susciter d’autres émotions. Durant cette période riche en repas et en célébrations, il peut être difficile de profiter des fêtes tout en évitant certains aliments.
Les hôtes bien intentionnés préparent souvent une sélection de friandises aux saveurs de saison. Mais sans communication claire, étiquetage précis et mesures pour éviter la contamination croisée, se servir dans les plateaux ou les buffets peut comporter des risques.
En tant que chercheuse spécialisée dans les allergies, je m’intéresse principalement aux conséquences d’un diagnostic d’allergie alimentaire pour les personnes, les familles et les communautés, ainsi qu’aux types de soutien les plus efficaces dans ce domaine.
De plus en plus de Canadiens surveillent leur alimentation, notamment pour des raisons telles que le coût des aliments, la santé et des restrictions médicales. Celles-ci peuvent consister à réduire le sel ou les sucres raffinés, ou à éviter certains glucides comme le lactose ou le gluten, dans le cas des personnes souffrant d’intolérance au lactose ou de maladie cœliaque.
Mais pour les 7 à 9 % de Canadiens souffrant d’allergies alimentaires, il est vital d’éviter certains aliments en raison du risque de réaction allergique sévère. La forme la plus grave, l’anaphylaxie, peut mettre la vie en danger.
À lire aussi :
Votre alimentation influence-t-elle vos rêves ? Ce que disent nos recherches sur la nourriture et les cauchemars
Allergies et restrictions alimentaires pendant les fêtes
Une étude canadienne montre que, contrairement à Halloween ou Pâques, périodes durant lesquelles les enfants « chassent » les bonbons, le nombre de visites aux urgences pour cause d’anaphylaxie pendant les fêtes d’hiver reste similaire au reste de l’année. Mais cela ne signifie pas que les restrictions alimentaires n’ont pas d’impact.
Celles-ci peuvent obliger à éviter de nombreux aliments. Santé Canada a identifié 11 allergènes prioritaires : le lait, les œufs, les arachides, les noix, les crustacés et les mollusques, le poisson, la moutarde, les graines de sésame, le soja, les sulfites et le blé et triticale. Beaucoup de ces aliments figurent couramment dans les recettes ou comme plats individuels pendant les fêtes.
Dans une série d’entretiens avec 21 familles, nous avons constaté que celles confrontées à des allergies apprennent rapidement à « refuser poliment » certains aliments pour éviter d’être perçues comme difficiles. Néanmoins, elles signalent tristesse, anxiété et dépression lorsqu’elles tentent de gérer les événements familiaux et sociaux. Dans certains cas, les familles qui gèrent plusieurs allergies alimentaires se sentent isolées, tandis que d’autres rapportent ne pas être invitées à des fêtes à cause de leurs restrictions.
Il existe de nombreux moyens pour les personnes ayant des restrictions alimentaires et pour les hôtes d’atténuer ces difficultés.
Mesures pratiques
Pour les personnes ayant des restrictions alimentaires, certaines mesures permettent de rendre les visites festives plus agréables et sécuritaires.
Il est important de communiquer clairement, de préférence par écrit, vos restrictions à l’hôte au moment d’accepter l’invitation. Indiquer précisément quels aliments poseront problème permet à l’hôte de réfléchir au menu et de poser des questions calmement, loin de l’agitation de la fête.
Vous pouvez aussi apporter une friandise compatible avec vos restrictions ou prendre une collation avant l’événement pour ne pas être affamé si les options sûres sont limitées. En cas de doute sur un aliment, il vaut mieux ne pas le consommer, même si vous l’avez déjà mangé auparavant, car les ingrédients peuvent changer.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Les personnes allergiques doivent prendre des précautions supplémentaires : emporter un auto-injecteur d’épinéphrine et s’assurer qu’une personne de confiance saura le trouver et l’utiliser en cas de réaction.
Food Allergy Canada propose d’autres conseils pour manger à l’extérieur. Il faut aussi connaître les facteurs aggravants possibles : certaines maladies, comme l’asthme ou les troubles cardiaques, ainsi que l’alcool, l’exercice physique, les médicaments ou le stress émotionnel peuvent influencer la gravité de la réaction.
À lire aussi :
Que peut-on faire pour lutter contre les allergies ?
Recevoir pendant les fêtes
Accueillir des invités peut être un plaisir, mais comme le souligne l’Association canadienne de psychologie, des attentes de perfection peuvent augmenter le stress. Lorsque vous invitez des personnes, renseignez-vous sur leurs restrictions alimentaires et tenez-en compte lors de la préparation des menus. Des plats simples et faciles à servir aident vos invités à faire leur choix. Avoir une liste des ingrédients à portée de main et étiqueter chaque plat avec des ustensiles dédiés est également utile.
La période des fêtes rime souvent avec le partage de mets festifs. En privilégiant la joie et la convivialité, il est possible de créer des souvenirs durables. En veillant aux besoins des personnes ayant des restrictions alimentaires, nous pouvons faire en sorte que chacun profite pleinement des festivités en toute sécurité.
![]()
Jennifer LP Protudjer reçoit des financements de la Canadian Allergy, Asthma and Immunology Foundation, des Instituts de recherche en santé du Canada, de Research Manitoba, de la Health Sciences Centre Foundation (Manitoba), du Children’s Hospital Research Institute of Manitoba, de l’Université du Manitoba et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
JLP Protudjer est cheffe de section en santé affiliée et co‑responsable du volet recherche pour la Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology, et siège au comité directeur du Plan d’action national canadien sur les allergies alimentaires. Elle déclare avoir reçu des honoraires de conférence de Ajinomoto Cambrooke, Novartis, Nutricia, ALK Abelló, FOODiversity et du Texas Children’s Food Allergy Symposium.
Elle est rédactrice associée pour la revue Allergy, Asthma & Clinical Immunology, membre du comité de rédaction de Pediatric Allergy & Immunology et du Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
– ref. Voici comment gérer les allergies et les restrictions alimentaires pendant les fêtes – https://theconversation.com/voici-comment-gerer-les-allergies-et-les-restrictions-alimentaires-pendant-les-fetes-271463