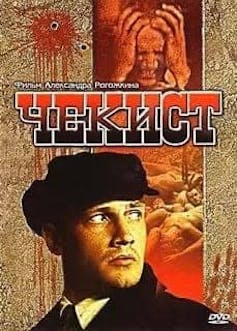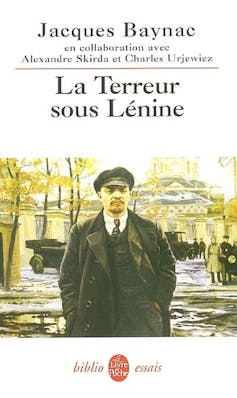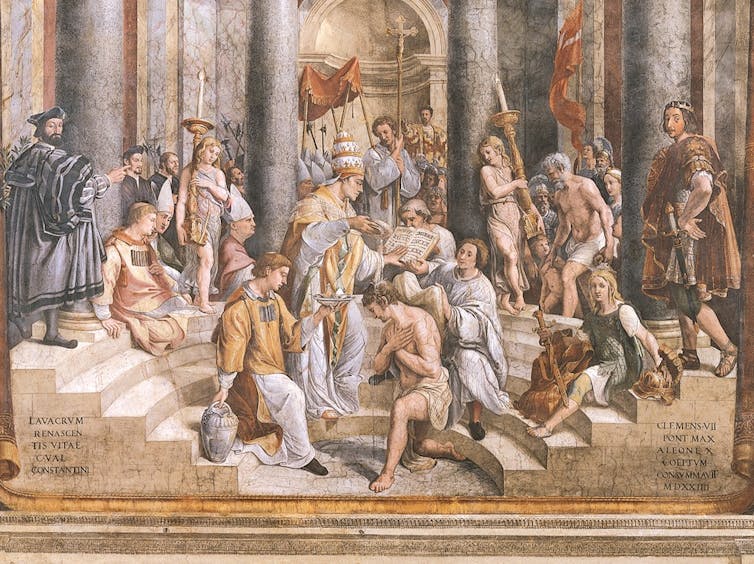Source: The Conversation – France (in French) – By Angèle Richard, Stratégie et Innovation, Université Savoie Mont Blanc
Alors que les Alpes subissent de plein fouet le changement climatique, la transformation du modèle économique des stations reste compliquée, souvent entravée par des tensions et des intérêts divergents. Une nouvelle méthode participative propose de dépasser ces blocages grâce à une approche originale : l’utopie. De quoi stimuler l’imagination pour bâtir une vision partagée d’un futur plus désirable. Celle-ci a été expérimentée au cours d’ateliers où les différentes parties prenantes d’une station de montagne ont été invitées à créer leur propre carte postale de montagne à l’horizon 2050.
Les Alpes françaises comptent parmi les régions les plus exposées au changement climatique. Les stations de montagne y sont directement confrontées, notamment face à la raréfaction de la neige. En mars 2024, la Cour des Comptes constatait l’insuffisance des stratégies d’adaptation mises en place dans ces stations. Celles-ci doivent impérativement transformer leur business model, encore largement centré sur le « tout-ski ».
Cette transformation est nécessaire pour préserver leur performance dans une perspective soutenable. Mais transformer un territoire est plus complexe qu’un simple changement d’offre touristique. Comment amorcer cette transformation ? Avec quelles parties prenantes ? Comment construire une vision commune, quand chacun perçoit la montagne à travers son propre prisme et ses propres intérêts ? Dans quelle direction stratégique s’engager ?
Ces questions sont d’autant plus cruciales que plusieurs tentatives d’innovations en la matière ont déjà échoué, notamment du fait de résistances ou de conflits d’intérêts entre les différentes parties prenantes concernées par ces innovations : exploitants, commerçants, élus, touristes…
Un exemple emblématique de ce type de conflits d’intérêts est la question de l’eau. En effet, elle est utilisée à la fois pour garantir les conditions d’enneigement des domaines skiables (ce qui permet de maintenir l’attractivité touristique en hiver) et pour répondre aux besoins des populations locales et des milieux naturels en montagne.
L’une des principales difficultés tient à la capacité de construire un alignement partagé entre les différents acteurs de la montagne. Cette quête doit reposer sur une proposition de valeur commune. Pour ce faire, nous avons adopté avec des collègues, dans une étude récemment publiée, une méthode de prospective originale basée sur ce qu’on appelle des « scénarios utopistes ».
L’intérêt ? Stimuler l’imaginaire collectif en insistant davantage sur les représentations partagées. Nous avons expérimenté la démarche à l’échelle d’une station de montagne à travers des ateliers participatifs, où ces différents interlocuteurs ont été encouragés à concevoir leur propre « utopie », sous la forme d’une carte postale fictive à l’horizon 2050.
L’utopie, une méthode prospective qui favorise le dialogue
Pour surmonter les difficultés évoquées précédemment, il faut avoir recours à des méthodes capables de faire dialoguer toutes les parties prenantes pour créer ensemble une nouvelle proposition de valeur. La prospective stratégique répond précisément à cet enjeu. En élaborant des scénarios exploratoires, elle crée un espace de réflexion où chacun peut se projeter plus librement face aux enjeux du changement climatique.
Les scénarios utopistes, en particulier, permettent l’émergence d’imaginaires collectifs capables de dépasser les représentations individuelles et leurs blocages cognitifs, comme la peur du changement. L’utopie permet d’apporter un regard critique sur l’existant tout en ouvrant la voie à un futur commun plus désirable. Elle peut alors devenir un guide d’action et contribuer à reconfigurer les relations.
La méthode des scénarios utopistes que nous proposons, déployée dans le cadre d’ateliers participatifs, peut avoir un pouvoir transformateur sur les représentations individuelles et collectives de ce que peut être un modèle d’affaires soutenable pour les stations de montagne.
À lire aussi :
Une brève histoire de l’utopie
La démarche consiste à :
-
d’abord proposer une relecture de l’existant à partir des représentations individuelles,
-
puis faire émerger d’autres représentations collectives plus soutenables, à travers le dialogue et l’imagination.
-
à partir de celles-ci, plusieurs propositions de valeur sont élaborées par les participants pour favoriser l’alignement entre les acteurs. L’idée est de construire des propositions qui fédèrent davantage qu’elles divisent.
-
un enjeu clé est de renforcer la désidérabilité de ces orientations futures et de redonner du sens au processus de transformation.
À lire aussi :
Penser l’avenir : qu’est-ce que la « littératie des futurs » ?
Quand imaginer ensemble aide à se projeter
Mais avant même d’envisager la création de scénarios utopistes, la priorité est d’ouvrir le dialogue. Cette première étape est décisive : elle permet de faire émerger des représentations individuelles fondées sur leurs intérêts, attentes, besoins et préoccupations respectives.
Cette étape permet d’identifier un enjeu véritablement partagé, capable de servir de point d’ancrage à la transformation du business model existant. Parmi les thématiques évoquées lors de nos ateliers, figurait notamment la quête d’un développement économique fondé sur la sobriété en ressources naturelles, tout en restant en harmonie avec l’environnement montagnard.
Une fois ces enjeux clarifiés, les parties prenantes ont été invitées à imaginer ensemble ce que pourrait être la proposition de valeur d’un futur business model pour la station. Pour nourrir cette réflexion, elles ont chacune conçue une utopie, sous la forme d’un parcours client situé en 2050, incarnée par une carte postale fictive. Cet exercice permet d’esquisser une nouvelle proposition de valeur et d’en explorer la désirabilité, en mobilisant l’imagination et les capacités de projection dans le futur.
Cet exercice a donné naissance à plusieurs directions possibles. Citons par exemple les propositions suivantes, qui ont émergé lors des ateliers :
-
un tourisme axé sur le bien-être et la reconnexion au vivant,
-
un écotourisme valorisant l’engagement actif du touriste dans la découverte du patrimoine territorial,
-
ou encore un tourisme expérientiel centré sur l’authenticité et l’immersion dans les savoir-faire locaux.
Toutes ces représentations collectives ont ensuite été discutées de manière critique afin d’anticiper leurs limites potentielles telles que la surcharge d’activités, les tensions autour des ressources ou encore les risques de surfréquentation.
Malgré cette prise de recul, ces idées ont été majoritairement perçues comme désirables et mobilisatrices. Le recours aux scénarios utopistes a permis aux participants de relâcher les contraintes du présent, de mobiliser leur imaginaire et de se projeter dans un futur vu comme moins anxiogène.
L’utopie pour briser la glace ?
Les scénarios utopistes apparaissent ainsi comme un levier stratégique intéressant pour penser de nouveaux business models soutenables :
-
D’abord parce qu’ils aident à prendre de la distance par rapport au modèle actuel. Ils offrent un espace de réflexion afin d’imaginer ceux du futurs, tout en restant ancré dans des enjeux réels et tangibles.
-
Ces visions ne relèvent pas nécessairement de fictions déconnectées : l’utopie permet de transposer ici un idéal déjà observé ailleurs, sur d’autres territoires, dans d’autres secteurs ou encore d’autres industries.
-
Enfin, en rapprochant les représentations individuelles, elle tend à réduire les risques d’échecs et de tensions liés aux divergences d’intérêts, souvent responsables de blocages dans des démarches de co-création de valeur.
Ainsi, nous constatons que les scénarios utopistes permettent de « briser la glace » entre les différentes parties prenantes. En effet, ils offrent un appui stratégique précieux pour initier un projet de transformation, parce qu’ils facilitent l’entrée en relation et le dialogue entre les acteurs du territoire. Ils favorisent ainsi l’émergence de représentations collectives partagées.
Néanmoins, pour que ces visions communes de business models soutenables puissent devenir opérationnelles, une phase d’ajustement intermédiaire reste nécessaire. Dans les premières phases d’un projet de transformation, le défi principal reste de mobiliser autour d’un enjeu commun et séduisant. Sous cet angle, les scénarios utopistes peuvent jouer un rôle mobilisateur et fédérateur en amont.
À lire aussi :
Entre utopie et dystopie, créer un langage végétal
![]()
Angèle Richard est membre de l’Institut de Recherche en Gestion et Economie. Elle a reçu des financements de la Chaire Tourisme Durable de l’Université Savoie Mont Blanc.
Romain Gandia et Élodie Gardet ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
– ref. Quelles cartes postales hivernales en 2050 ? Imaginer ensemble un futur désirable pour les stations de montagne – https://theconversation.com/quelles-cartes-postales-hivernales-en-2050-imaginer-ensemble-un-futur-desirable-pour-les-stations-de-montagne-271872