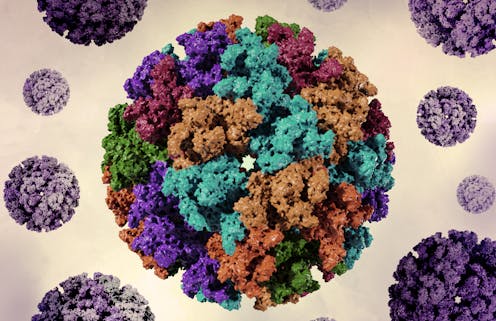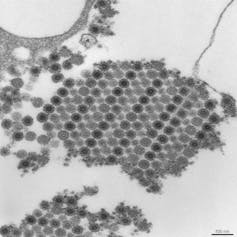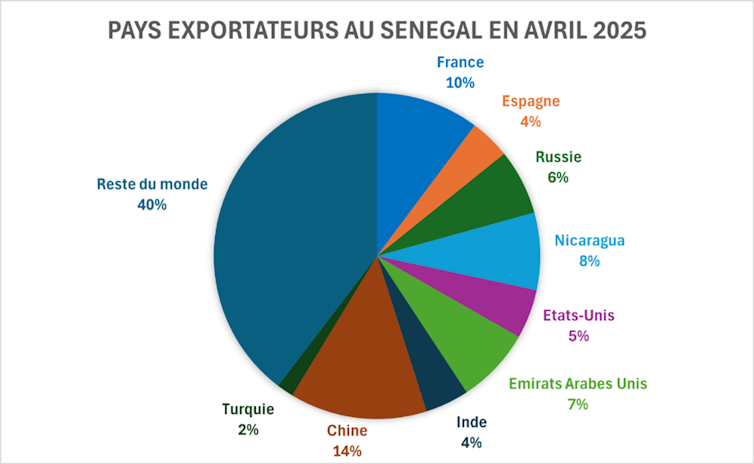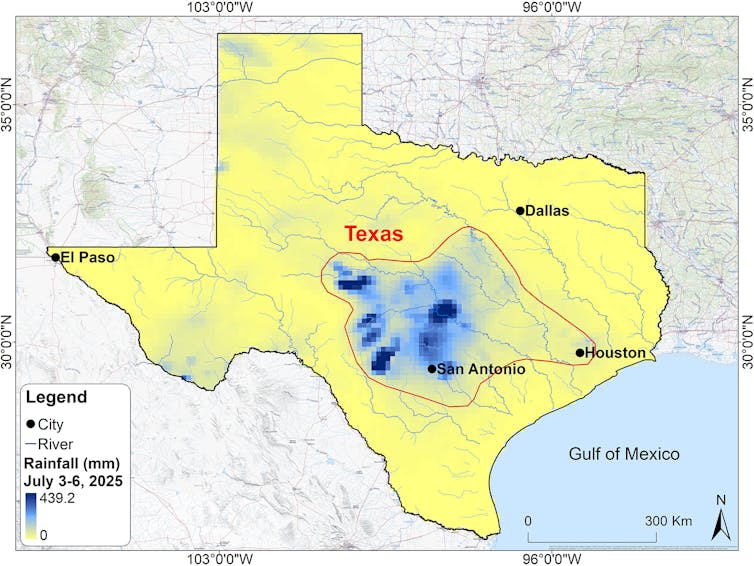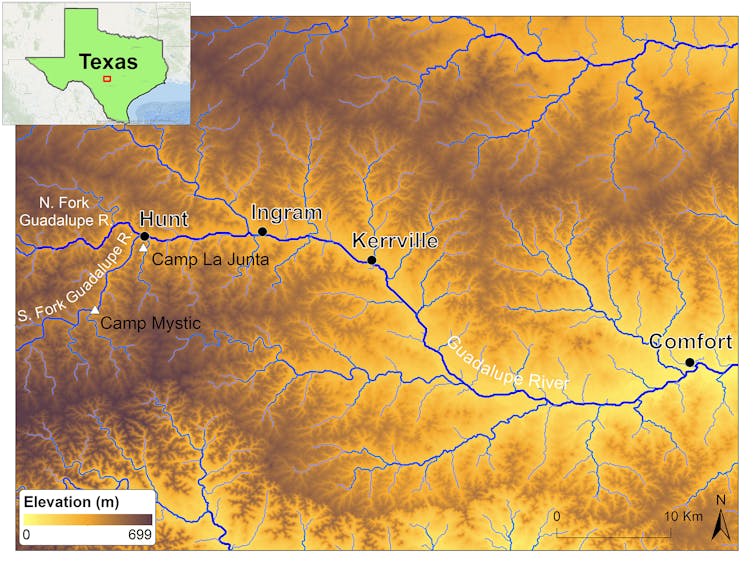Source: The Conversation – in French – By Nicolas Postel, Professeur de Sciences Economiques- Titualire chaire Socioeconomie des communs, Université de Lille

Économiste, sociologue, mais aussi philosophe, Karl Polanyi est un penseur critique des excès du capitalisme des années 1920. Dans la Grande Transformation (1944), il décrypte le lien entre un capitalisme sans limite et les totalitarismes. Une œuvre à redécouvrir d’urgence, alors que l’on peut craindre que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Que nous arrive-t-il ? Pour de nombreux citoyens et chercheurs en sciences sociales, le début de l’année 2025 a été le temps d’une sidération, souvent refoulée. Les premiers mois du mandat de Donald Trump nous secouent d’autant plus que, dans le même, temps, jour après jour, les informations les plus alarmantes se succèdent sur l’accélération des effets du réchauffement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. L’analyse que propose Karl Polanyi peut nous aider à sortir de cette sidération, en nous donnant des clés de lecture de la situation que nous vivons et des voies permettant de sortir de l’ornière.
Karl Polanyi (1886-1964) est un analyste extrêmement précieux des rapports problématiques qu’entretient notre système économique avec la société et la biosphère. Dans la Grande Transformation, son ouvrage majeur (1944), il propose à la fois une histoire du capitalisme et une mise en évidence de sa singularité à l’échelle du temps long de l’humanité.
Le capitalisme constitue en effet une réponse très singulière à la question économique – question dont aucune société ne peut s’affranchir et que Polanyi définit comme : un « procès institutionnalisé d’interaction entre l’homme et son environnement qui se traduit par la fourniture continue des moyens matériels permettant la satisfaction des besoins ».
Trois bouleversements
À première vue, cette définition peut sembler banale. Mais si on confronte cette définition à notre impensé économique, c’est bouleversant pour trois raisons :
(1) L’économie est un process institutionnalisé, cela nous dit clairement que la réponse que donne toute société à la question de la satisfaction des besoins (aux conditions de sa reproduction) est d’abord collective, sociale, politique. Il n’y a pas d’économie « avant » les institutions collectives. Exit donc, nos illusions sur l’économie comme étant le lieu d’une émancipation par l’égoïsme rationnel ! Il n’y a, à l’origine, ni Homo œconomicus, ni concurrence libre et non faussée, ni loi de marché. L’économie est d’abord et toujours une question d’institutions et donc de choix collectifs et politiques. Là se joue la liberté des acteurs : participer à la construction des institutions qui forment une réponse collective à la question de la vie matérielle.
À lire aussi :
Le débat sur la valeur travail est une nécessité
(2) Un process « entre l’homme et son environnement » : cette définition pose ici immédiatement la question de l’insertion de la communauté humaine dans la nature, dans la biosphère, dans son lieu de vie. Seconde surprise, donc : la question écologique n’est donc pas « nouvelle »… C’est même la question fondatrice de l’économie pour Polanyi.
(3) Il s’agit de satisfaire « des besoins » et non pas des désirs insatiables d’accumulation… Là encore, cette dimension substantive de l’économique nous est devenue invisible, enfouie sous un principe d’accumulation illimitée qui nous a fait oublier la question de « ce dont nous avons vraiment besoin », au point paradoxalement de conduire nos sociétés contemporaines à assurer le superflu mais plus le nécessaire. Nous sommes, de fait (c’est ce que nous indique le franchissement des « limites environnementales »), sortis d’une trajectoire de reproductibilité des conditions de vie authentiquement humaine sur terre, alors même que nous accumulons des biens et services inutiles.
Marché autorégulateur
Cette sortie de route est un effet pervers du déploiement, depuis la révolution industrielle, d’un système de marché autorégulateur qui sert de base au mode de production capitaliste. C’est le second apport de Polanyi. Pendant des millénaires, la communauté humaine est parvenue à se reproduire de manière résiliente en pratiquant des formes d’économie socialement encastrées et cohérentes avec notre milieu de vie.
Polanyi repère ces formes sociales d’économie : l’économie domestique (autarcique) du clan ; la réciprocité entre les différentes entités progressivement mises en relation et pratiquant de manière ritualisée du don contre don ; la redistribution qui se met en place à un stade plus avancé de communautés humaines organisées autour d’un centre puissant et légitime, habilité à prélever des ressources et à les repartir, selon des critères considérés comme justes, entre les différents membres de la communauté… et le commerce, ou marché-rencontre, aux marges de la société (le mot donnera marché) dans lequel les acteurs diversifient leur consommation et négocient de gré à gré, en dehors de toute logique concurrentielle, le « juste prix ».
Ces formes économiques insérées, mises au service de la société, sont balayées par le capitalisme. Lorsque le phénomène industriel émerge et, avec lui, la promesse de l’abondance, il apparaît très clairement nécessaire de plier la société aux besoins de l’industrie. Il faut alimenter la machine productive en flux continu de travail, de matière première, et de financement permettant l’investissement. Pour que cette dynamique capitaliste fonctionne, il devient donc « nécessaire » de traiter le travail (la vie humaine), la terre (la biosphère) et la monnaie de crédit (indispensable à l’investissement) comme s’ils étaient des marchandises « produites pour être vendues ». C’est nécessaire, mais c’est faux, évidemment.
La société au service de l’économie ou l’inverse
Là est le mythe fondateur de nos sociétés qui se comprend assez vite dans les expressions désormais courantes : « ressources humaines », « ressources naturelles », « ressources monétaires ». Mais ressources pour qui ? pour quoi ? Pour la production de richesse ! Voilà ce qui constitue une inversion remarquable : la société et son environnement naturel se voient artificiellement « mises au service » de l’économie… et non l’inverse. La biosphère et la société doivent se soumettre, enfin, à « la loi » de l’économie !
Ce mythe – souligne Polanyi – travaille et détruit la société si l’on ne prend pas garde de « protéger » la vie humaine, la nature et le monnaie de cette logique concurrentielle. C’est ce que vécut Polanyi : l’effondrement de la société viennoise de l’entre-deux-guerres et de sa vie intellectuelle brillante (Einstein, Freud, Wittgenstein, Hayek, Popper… sans parler d’écrivains comme Zweig ou Schnitzler) qui s’abîma en quelques mois, dans le nazisme.
Karl Polanyi, juif, dut fuir en Angleterre. Il passera sa vie à saisir les causes de cet effondrement. Il perçoit alors que le fascisme révèle au fond « la réalité d’une société de marché » : c’est le produit d’un libéralisme économique débridé. L’échec des contre-mouvements qui, au long du XIXe siècle, cherchèrent à limiter l’emprise du marché sur la société (les paysans attachés aux communaux, les artisans attachés au travail libre, puis les prolétaires à celle d’un respect des droits humains, les nations attachées à l’étalon-or…) se traduit par une crise sociale majeure.
Une réaction sociale convulsive
Dans cette société dominée par la concurrence de tous contre tous, chaque individu est renvoyé à son intérêt propre, désocialisé.
L’espace commun de délibération se réduit, s’étiole, disparaît. Mais la société ne disparaît pas : elle se régénère maladivement, de manière dysfonctionnelle non plus par la raison et l’existence d’un dessein commun, mais par le sang, la « race », et l’homme providentiel. Le totalitarisme, c’est cette réaction sociale, presque convulsive, maladive et qui est le symptôme d’une société disloquée sous l’effet du libéralisme.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Polanyi pense, lorsqu’il présente cette analyse dans l’immédiat après-guerre, que cet effondrement appartient au passé. Les sociétés occidentales vont se reconstruire en pleine connaissance de cause. C’est le sens de la « grande transformation » (le titre de son livre) qui s’opère avec, notamment, les accords de Philadelphie (fondateurs, en 1944, de l’Organisation internationale du travail) qui actent la nécessité de « protéger » le travail contre la logique concurrentielle, et ceux de Bretton Wood qui actent la constitution d’un système monétaire international réduisant le rôle des marchés et plaçant la question du financement dans la main des États.
Les institutions collectives, politiques, reprennent la main sur l’économique et lui assignent des règles qui, partiellement, « dé-marchandisent » le rapport à la monnaie et au travail (mais pas à la nature). Le monde occidental connaît alors un cycle long de prospérité et de paix. Les Occidentaux voient leur qualité de vie augmenter au fur et à mesure que la production se déploie, grâce à la redistribution des gains de productivité, au point que hausse du PIB et hausse du bonheur finissent par se confondre dans l’esprit public… au détriment des rentiers qui voient leur avoir diminuer.
Réencastrement partiel
Mais ce réencastrement de l’économie dans la société est partiel. La sphère domestique continue d’être niée, la nature d’être pillée, le travail d’être aliéné dans son contenu (c’est la période taylorienne).
Au début des années soixante-dix, les détenteurs de patrimoine financier, lésés par l’État social, sonnent l’heure de la révolte, et parviennent à démanteler le système monétaire international et à réactiver la puissance des marchés financiers. Ceci tandis que les populations mondiales dénoncent l’épouvantable exploitation des ressources mondiales au seul profit de l’Occident et que les salariés dénoncent le taylorisme. Le compromis de l’après-guerre ainsi mis en critique s’étiole et laisse la place à une phase dite néolibérale. C’est cette phase de remarchandisation très rapide qui, aujourd’hui, nous amène au bord du gouffre.
Le néolibéralisme a débuté sa révolution par la remarchandisation de la monnaie et la redynamisation du pouvoir des marchés et des actionnaires, la seconde phase se traduit par la remarchandisation du travail (le droit du travail est allégé, les protections sociales affaiblies), et de la nature (marché de l’énergie, marché carbone, brevetabilité du vivant, accaparement foncier…). Cette remarchandisation, qui oublie totalement les leçons de l’histoire, nous conduit au bord d’un précipice écologique et social.
Monétairement, socialement, politiquement, écologiquement, tout notre système se fissure. Ces failles structurelles entraînent un immense désarroi social et… la résurgence de mouvements néo-fascistes, néonazis, nationalistes autoritaires… Selon une mécanique extrêmement proche de celle que décrit Polanyi. La crise politique de nos démocraties est donc d’abord une crise de notre économie, ou, plus précisément, de la pression qu’exerce l’économique (dans sa version marchande) sur le social et la biosphère.
Retour aux sagesses anciennes ?
Au-delà du diagnostic, Polanyi nous donne des ressources pour agir. Il nous permet de percevoir la résilience des structures de « l’ancien monde » dans nos vies et nos économies. Les sagesses anciennes n’ont pas disparu : nous pratiquons à très grande échelle la redistribution, une large part de nos échanges sociaux est fondée sur la réciprocité (et notamment au sein de l’économie sociale et solidaire), et chacun sait l’importance vitale de notre foyer familial.
Nous vivons, des temps polanyiens, et ils ont leur part de noirceur. Mais, si l’on suit Polanyi, la liberté – celle qui consiste à choisir ensemble un horizon commun – est devant nous. Notre extraordinaire capacité de production – héritage indéniable du capitalisme – doit nous permettre de nous poser sereinement la question de nos besoins, et cela nous amènera à consommer moins !
Moins de nourriture, moins de psychotropes, moins de déplacements professionnels, et plus de temps libre : ce ne serait tout de même pas triste ! Polanyi ne nous propose pas de solutions clés en main, mais montre un chemin : retrouver le goût de la délibération collective et la défendre contre l’établissement d’un principe de concurrence généralisée – celui de la gouvernance actionnariale – qui détruit la société, nourrit le totalitarisme et se heurte violemment aux limites planétaires.
![]()
Nicolas Postel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Polanyi, pour mieux comprendre ce qui nous arrive – https://theconversation.com/polanyi-pour-mieux-comprendre-ce-qui-nous-arrive-257393